Rüdiger Stolzenburg a presque la soixantaine. Chargé de cours à l’université de Leipzig, il n’a aucune chance de voir sa carrière universitaire progresser – son champ de recherches, le librettiste et topographe Weiskern, n’intéresse personne, et de toute façon c’est le département tout entier qui est menacé. Sa vie privée n’est guère plus enthousiasmante, bien qu’il collectionne les femmes, jeunes, voire même très jeunes, et piétine allègrement l’amour de la seule femme qui tienne vraiment à lui. De plus le fisc vient de lui notifier un redressement d’impôts qu’il ne peut absolument pas payer.
Rüdiger croit voir sa chance tourner quand une proposition lui parvient via Internet : un collectionneur cherche un acquéreur pour des manuscrits inédits et inconnus de Weiskern. Pris d’une passion furieuse pour ces textes, il remue ciel et terre pour trouver l’argent, et envisage même de se laisser acheter en échange d’un diplôme.
Christoph Hein analyse à sa manière sobre et incisive la façon dont la chute du Mur et la réunification ont profondément modifié le cours de la vie des Allemands de l’Est. Son héros, naïf, mal à l’aise avec les règles d’une société dans laquelle chacun est en concurrence avec tous pour conquérir sa place au soleil, est l’éternel perdant de ce nouvel ordre du monde.
-
"Coup de cœur pour Le noyau blanc que je qualifierai de comédie amère et que je trouve d'une qualité assez exceptionnelle"
Christophe Gilquin -
"Très beau livre au style simple...et parfait, plein de fraîcheur et de découvertes. Université de Leipzig. Rüdiger, fort sympathique, enseigne à mi-temps pour un salaire ridiculement modeste, poursuit des recherches (non rentables) sur des manuscrits très rares, d'où une situation financière bien modeste, mais... quoique proche de la soixantaine, célibataire, il a toujours une jeune et jolie femme à portée de main. Cela compense bien des difficultés de la recherche et de l'enseignement...ce que vous découvrirez avec plaisir en manipulant ce "noyau blanc"...."
Alexandre -
"Ce qui frappe dans ce beau roman, c'est la justesse de ton et la précision de l'écriture.
Si bien qu'on reste accroché à ce personnage qui est pourtant loin d'être un héros. Et on comprend mieux ce que c'est de vivre dans l'Est de l'Allemagne aujourd'hui..."
-
"Ça fait mouche sur le lecteur que je suis" Voir la vidéo ici
William IrigoyenArte.tv -
"Je voulais un personnage né dans un autre monde." Lire l'entretien ici
Frédérique FanchetteLibération -
Lire l'article ici
Pierre MauryLe Soir -
"L'écrivain de l'ancienne RDA, plongé dans le nouvel ordre des choses, n'a rien perdu de sa perçante acuité. Obstinément rigoureux, tranquillement implacable." Lire l'article ici
Jean-Claude LebrunL'Humanité -
"Par le prisme original de la vie d’un universitaire – anti-héros romanesque, ou héraut d’un nouveau réalisme – , Christoph Hein offre une peinture très noire de l’Allemagne de l’Est contemporaine." Lire l'article ici
Alexia KalantzisLa Petite Revue -
"Réaliste, caustique, cruel, le portrait d'un perdant de la mondialisation." Lire l'article ici
Bernard QuirinyTrois couleurs -
"Ce grand perdant de la reunification réveille le vilain qui sommeille en chaque lecteur." Lire l'article ici
Vocable allemand -
"Un mélange de réflexions désabusées sur le vieillissement et le cours actuel des choses, emportées dans une suite de scènes rapides et de dialogues abrupts." Lire l'article ici
René FuglerDNA -
"Si le roman est drôle et caustique, il est aussi allègrement pessimiste, avec un parfum de testament culturel, montrant que l'intégrité est la valeur des « ratés », mais que ceux-ci ne sont pas toujours les victimes d'une société obnubilée par l'argent." Lire l'article ici
Pierre DeshussesLe Monde des livres -
"Hein offre un portrait pathétique du travailleur intellectuel moderne, espèce en voie d'extinction au milieu d'un monde gouverné par la violence décomplexée et l'argent-roi." Lire l'article ici
Bernard QuirinyL'Opinion -
"En déroulant des épisodes quasi kafkaïens, l’auteur arrive à rendre captivante la vie globalement insignifiante d’un (anti) héros évoluant à la marge du système." Lire l'article ici
Blog Voyages au fil des pages
Le petit avion à destination de Bâle décolle en retard, il va arriver chez Gotthardt presque deux heures plus tard que l’horaire prévu. Toutes les places sont occupées, on se sent désagréablement à l’étroit. Stolzenburg, coincé par le coude de son voisin, laisse ses documents dans sa serviette, il ne veut pas les étaler sur la minuscule tablette. Dans ce vol à bas coût, on ne propose pas de journaux et il regrette de ne pas avoir acheté un quotidien à l’aéroport. Quelques minutes après le décollage, deux stewards en tenue décontractée poussent un chariot dans le couloir central étroit et vendent des boissons, des sandwichs et des montres, mais seul l’homme assis à côté de lui se fait servir un jus de tomate qu’il paie avec sa carte de crédit, ce qui l’oblige à se lever pour attraper son portefeuille dans le compartiment à bagages au-dessus d’eux.
Stolzenburg regarde par le hublot, le front appuyé contre la vitre, il contemple les nuages qui s’amoncellent au-dessous d’eux. Il pense à Henriette et à Lilly, puis à sa fille. La semaine prochaine il veut prendre rendez-vous avec sa banque, il est client depuis des dizaines d’années dans le même établissement et même s’il ne lui a pas fait gagner beaucoup d’argent, il espère qu’on saura apprécier sa fidélité et qu’on lui consentira un prêt-relais à un taux à la mesure de sa bourse. Il a peu de chances, il ne se fait pas d’illusions, mais ça vaut la peine d’essayer. Weiskern, Aberte lui traversent l’esprit. Il y a longtemps qu’il aurait dû adresser un nouveau courrier à Jürgen Richter, l’éditeur. Il faut bien qu’un jour quelque chose me rapporte de l’argent, se dit-il. Il sursaute et regarde son voisin, pendant un moment il craint d’avoir parlé à haute voix, mais l’homme ne lui prête aucune attention, concentré, il déchiffre les inscriptions sur la canette de jus de tomate. Stolzenburg appuie à nouveau sa tête contre le hublot et fixe les nuages. Il voit la surface portante à gauche et deux hélices, ou plutôt les deux cercles en mouvement que forment les pales en rotation devant la large surface de tôle. Soudain l’une des hélices tressaute, pendant un instant il distingue l’une des pales du rotor, puis elle se remet à tourner, la vitesse rend le métal arqué invisible. Pendant quelques secondes le rotor a arrêté sa rotation, il est resté immobile, les pales ne tournaient plus autour du moyeu. Était-ce un incident extraordinaire, ou un processus normal, se demande Stolzenburg avec étonnement sans quitter des yeux les hélices en train de tourner. Quelques secondes plus tard, le rotor tressaute à nouveau, brièvement, puis s’arrête, les pales immobiles. Retenant son souffle, Stolzenburg attend que l’hélice se remette à tourner, que la pression de l’air la mette en mouvement, comme le vent quand il fait tourner les ailes d’un moulinet, mais le métal reste en position verticale, sans bouger, seule l’hélice voisine dessine encore la rotation tremblotante dans l’air. Stolzenburg en reste abasourdi, sa bouche est comme desséchée. Il regarde les autres passagers, aucun d’eux ne remarque quoi que ce soit, l’avion continue son vol, rectiligne, imperturbable, les deux stewards debout à l’avant à côté de la porte de la cabine de pilotage discutent, eux non plus ils n’ont rien remarqué. La respiration de Stolzenburg s’accélère, il sent la panique monter en lui et se force à rester calme, à ne pas crier, à ne rien dire. Puisque personne ne s’inquiète, tout doit être normal. Il continue à fixer l’hélice immobile, sa respiration est de plus en plus rapide, irrégulière, ses mains s’agrippent aux bras de son fauteuil, il transpire. C’est la fin, se dit-il, pendant un vol banal, en route vers une conférence banale et mal rémunérée à l’École des beaux-arts de Bâle qu’il va probablement payer de sa vie. Il regarde prudemment les autres passagers, ils bavardent, l’homme à côté de lui verse une bonne rasade d’épices dans le jus de tomate auquel il n’a toujours pas touché, apparemment il est le seul, l’unique, lui, Stolzenburg, à avoir remarqué les signes avant-coureurs de la catastrophe imminente. Peut-être les pilotes n’en ont-ils pas non plus conscience, bien que dans le cockpit les petites lampes rouges devraient clignoter, les signaux de détresse retentir, mais à l’avant il ne se passe rien, on n’ouvre pas la porte avec violence, on ne donne aucune consigne, aucun ordre, il n’y a pas de cris. Il s’efforce de rester calme, toussote à plusieurs reprises, sa gorge aussi est desséchée. Il regarde par la fenêtre, l’hélice ne bouge pas, ce genre d’avion peut apparemment voler avec seulement trois hélices. Peut-être que la deuxième hélice n’est pas absolument indispensable, une hélice de secours en cas d’urgence. Mais comme elle a cessé de fonctionner, c’est une urgence, seulement personne ne le remarque à part lui. Intensément, presque avidement, il fixe le morceau d’acier figé à l’avant de la surface portante, comme si du regard il pouvait mettre en mouvement l’hélice, la faire tourner. Se signer, prier, voilà ce qui conviendrait, se dit-il. Sans le vouloir il presse ses mains, les joint dans une crispation nerveuse, il ferme les yeux le temps d’une oraison jaculatoire. Quand il les ouvre immédiatement après et fixe l’hélice immobilisée, la deuxième hélice toussote, tressaute à plusieurs reprises, reste un instant sans bouger, puis vacille et se remet lentement en mouvement, prend de l’élan, tourne régulièrement, mais lentement, lui semble-t-il, et finit par s’arrêter définitivement. Les deux hélices du côté droit ne fonctionnent plus, les taquets de leurs pales en métal sont figés à l’avant de la surface portante. L’avion continue à glisser parfaitement calme, nullement déséquilibré. Stolzenburg, le regard rivé aux hélices immobiles, s’attend à tout moment à ce que l’appareil se mette sur l’aile, se renverse et, hurlant comme un vieux bombardier de combat, se précipite dans le vide. Blême, terrorisé, il observe les passagers, personne n’a rien remarqué, on continue à papoter joyeusement, l’homme à côté de lui boit à petites gorgées son jus de tomate, les stewards rangent sans s’en faire des prospectus dans un coffre à bagages et plaisantent. Stolzenburg veut crier, il ouvre la bouche, il expulse de l’air, mais il est tellement paralysé par la peur qu’il n’arrive pas à produire le moindre son. Il saisit le bras de son voisin, essaie de lui faire remarquer l’hélice arrêtée, d’un doigt il montre le hublot et râle. Effrayé, le voisin repose son verre avec le reste de jus de tomate sur la tablette et appelle le steward. Il maintient d’une main le verre tandis qu’il contemple soucieux Stolzenburg qui se racle la gorge à plusieurs reprises, il veut s’éclaircir la voix pour pouvoir à nouveau parler. L’avion continue à glisser régulièrement, en position parfaitement horizontale, on ne perçoit pas la moindre vibration ni la moindre irrégularité. L’avion doit disposer d’une incroyable capacité de compensation pour être à même de corriger ou de remplacer le non-fonctionnement intégral d’un côté de l’appareil. Hors d’haleine et désorienté, Stolzenburg prend conscience que l’avion continue à voler régulièrement, que le vol se poursuit dans le calme. Il n’y a pas de manœuvre visible, décelable, pas de va-et-vient, pas de mouvements incontrôlés de l’appareil. Peut-être l’avion peut-il atterrir en toute sécurité même si deux de ses hélices ne fonctionnent plus. Il voit le steward s’avancer vers lui dans le couloir central, souriant aux passagers à droite et à gauche.
– Vous désirez ? demande-t-il à l’homme à côté de lui qui lui indique Stolzenburg.
Stolzenburg montre le hublot sans dire un mot.
– Que désirez-vous ? répète le steward.
Stolzenburg a du mal à saisir la question, à y répondre. Il regarde le jeune homme sans comprendre, il secoue la tête et fixe par le petit hublot la surface portante de l’avion.
2
Un son le réveille. Une porte refermée prudemment, puis les pas légers de quelqu’un qui cherche à éviter de faire du bruit. Avant d’ouvrir les yeux, il remarque une lueur. Son amie est debout près du lit. Elle tient quelque chose à la main, il n’arrive pas à savoir quoi, et ses cheveux sont ceints d’une couronne de feuillage sur laquelle trône une bougie allumée. Une silhouette, comme on en voit en Suède, se souvient-il, une déesse de la lumière ou une beauté estivale, il ne veut pas se casser la tête avec ça. Il tend la main, caresse la cuisse nue de la femme, sourit, épuisé.
– Patrizia, dit-il dans un sourire, c’est toi.
– Joyeux anniversaire, dit-elle.
Elle s’accroupit prudemment sur le lit pour que la bougie ne bascule pas, et l’embrasse sur la joue.
– Tous mes vœux, lui chuchote-t-elle à l’oreille, je suis heureuse d’être avec toi aujourd’hui, Rüdiger. Et j’espère que tu es heureux toi aussi.
– C’est bien, très bien, répond-il en refermant les yeux.
– Notre petit-déjeuner est prêt. Viens sur le balcon.
– Oui, laisse-moi encore une minute.
– Regarde. C’est pour toi.
Il entrouvre les yeux, voit quelque chose de sombre, de noir. Un pull-over, pense-t-il, ou une chemise.
– Magnifique, dit-il en refermant les yeux et, en détournant la tête :
– Encore un petit moment, cinq minutes, je t’en prie.
La jeune femme sort de la chambre sur la pointe des pieds.
Un quart d’heure plus tard, Stolzenburg fait son apparition sur le balcon en peignoir de bain. Il bâille largement, lève les bras vers le ciel, s’étire. Pour finir il dépose un baiser sur le front de la jeune femme. Il contemple la table dressée, la couronne tressée avec des rameaux et des feuilles de châtaignier. Il saisit l’objet en lin noir ceint d’un ruban rouge, en défait le nœud. C’est un peignoir japonais, un kimono orné d’un seul idéogramme blanc.
– Très beau, dit-il, merci.
Il s’assied et lui tend sa tasse à café.
– Cinquante-neuf, dit-il, rends-toi compte, j’ai cinquante-neuf ans. Et pourtant je ne souhaitais pas devenir si vieux.
– Pas un poil de graisse, pas une seule ride, je ne sais pas de quoi tu te plains. Tu as belle allure. Tu es le plus bel homme que j’aie eu.
– Tu es vraiment un amour. – Et après quelques brefs instants de silence, il ajoute son prénom : – Patrizia.
– Excuse-moi de t’avoir réveillé, mais je voulais prendre mon petit-déjeuner avec toi.
– Pas si grave, grommelle-t-il en saisissant un petit pain. Tu es allée à la boulangerie ? Si tôt ?
– Oui, je voulais te faire une surprise. Pour un anniversaire, il faut des petits pains tout frais.
– Parfait.
– Mais maintenant il faut que j’y aille, sinon je vais arriver en retard, dit-elle en se levant.
– Tu es un ange.
Des deux mains, il saisit ses fesses, l’attire à lui et presse son visage contre son ventre.
– C’est bien que tu sois ici.
– On se voit ce soir ?
– Ce soir ? répète-t-il.
Il lui caresse les fesses et passe la main dans son entrejambe.
– Demain, je fais une conférence à Bâle, dit-il, il faut que je parte aux aurores.
– Je pourrais t’accompagner à l’aéroport.
– Je ne sais pas encore. On se téléphone, ma mignonne. Je t’appelle quand je sors de la fac.
Lorsqu’il entend la porte de l’appartement claquer, il s’appuie contre le dossier de sa chaise.
– Oui, c’est bien, dit-il à haute voix, et c’est une fille sympa.
Il se dit qu’au moment où elle s’était approchée du lit pour le réveiller, il l’avait appelée par son nom. Encore dans un demi-sommeil et tout de suite le bon prénom, c’était déjà une performance. Habituellement il se cantonnait dans une formulation moins engageante, plus banale, par exemple “ma chérie”, ou “mon amour”, “mon cœur”, ça évitait les histoires. Un prénom erroné peut facilement gâcher toute une matinée, la dame ne cessant de lui mettre sous le nez la confusion de prénoms. Il se ressert une tasse de café et saisit les journaux que Patrizia a achetés pour lui, reste une demi-heure sur le balcon avant d’aller sous la douche.
Avant de sauter sur son vélo et de se rendre à l’université, il s’assied à son bureau, jette un coup d’œil à ses e-mails, à son compte en banque avec l’espoir insensé qu’un virement inattendu soit arrivé, peut-être une erreur de la banque à son avantage comme pour fêter son anniversaire, puis il passe en revue les documents dont il a besoin pour son séminaire. Au moment de partir, il les fourre dans son sac à dos, avec son notebook et son portable, se coiffe encore une fois. Près de la porte d’entrée il se regarde dans la glace, scrute scrupuleusement son visage, recule d’un pas, se tourne sur le côté pour examiner son ventre de profil.
– Cinquante-neuf, murmure-t-il en secouant la tête.
Il n’est pas mécontent de sa silhouette, il se trouve absolument séduisant, il a belle allure, mais c’est évident, il n’est plus un jeune homme. Le plus bel homme que j’aie eu. Bon, c’est sympa de le dire, mais c’est un compliment ambigu. Il ne sait pas avec qui elle était auparavant.
Encore dans l’appartement il met son casque de cycliste, un objet monstrueux, un accessoire effrayant. Fritz, son copain du billard, a dit que lorsqu’il en était coiffé on avait l’impression qu’il sortait de la guerre des étoiles ou d’un film fantastique. Avec ce casque il a l’impression d’être déguisé, d’être un personnage défiguré et grotesque, et à chaque fois qu’il est prêt à s’asseoir sur la selle, il le retire rapidement, mais il est tellement raisonnable qu’il le repose quand même sur sa tête, il sait que son âge ne lui permet plus de sortir indemne de la moindre chute. Il craint de se casser quelque chose, voilà pourquoi il est devenu prudent, beaucoup plus prudent que quelques années auparavant.
À dix heures moins vingt il est à l’université, et il attache soigneusement son vélo à un panneau de circulation. Dans le couloir du premier étage des étudiants le saluent d’un signe de tête. Il se rend au secrétariat pour prendre dans son casier le courrier et les nouvelles informations, mais quand il entre et salue Sylvia, elle se lève, fait le tour de son bureau et lui tend cérémonieusement la main pour lui souhaiter un bon anniversaire.
– Oui, une fois de plus, dit-il embarrassé, un an de plus. Je te remercie de tes vœux, je peux en avoir besoin.
Il feuillette d’un mouvement du pouce la pile de papiers, en retire la seule enveloppe dont l’adresse est écrite à la main et l’ouvre.
– Alors, ce soir on va faire une petite fête ? demande Sylvia.
Surpris, il la regarde. Il flotte dans sa voix quelque chose qu’il ne peut pas déchiffrer. Elle sait peut-être quelque chose, une nouvelle désagréable, finalement elle est l’assistante du directeur du département, et est donc au courant d’informations qui ne sont pas destinées à ses oreilles. S’attend-elle à ce qu’il l’invite à venir boire une coupe de champagne, ou même à une fête donnée pour son anniversaire, il n’en sait rien. Avec ses collègues de la fac il n’a jamais entretenu de relations privées, il se refuse catégoriquement à mélanger les relations privées et professionnelles. Pour finir, il lâche comme si ça allait de soi :
– Non, je ne crois pas. Qu’y a-t-il donc à fêter ? J’ai un an de plus, ce n’est ni un mérite ni une performance. Un an de plus, tu devrais m’adresser tes condoléances, Sylvia !
– Ne fais pas ta coquette, Rüdiger ! Ce sont les meilleures années pour les hommes de ton âge. Vous vous en sortez mieux que les femmes. Nous vieillissons, vous mûrissez.
Schlösser, le patron du département, sort de son bureau et le délivre de l’obligation gênante de servir à la secrétaire une réponse banale mais néanmoins galante. Schlösser jette un bref regard dans sa direction, puis il dépose sur le bureau de Sylvia une lettre et lui demande d’y répondre.
– Je voudrais que tu écrives une lettre de refus aussi claire qu’amicale, dit Schlösser. Je sais que tu trouveras les mots justes.
La secrétaire lui chuchote quelque chose, Schlösser ne comprend pas, pose une question, elle recommence à chuchoter en dirigeant son regard vers Rüdiger.
– Merci, ah oui, dit-il en s’avançant vers lui la main tendue pour lui souhaiter un bon anniversaire.
Rüdiger Stolzenburg ne le remercie pas, il se tait et lui lance un regard plein d’espoir. Pour finir il lâche :
– Et ? C’est tout ?
– Que veux-tu dire ? Je ne sais pas de quoi tu parles.
– Oh ! Les années précédentes, tu as toujours ajouté quelque chose, une toute petite phrase, une remarque sympathique qui ne tirait pas à conséquences. Déjà oublié ? Même l’année dernière j’ai eu l’occasion d’entendre cette jolie phrase.
Schlösser lui jette un regard embarrassé.
– Bon, eh bien tu me disais que je n’aurais pas éternellement ce poste à mi-temps. Que tu voulais au moins essayer. Jusqu’ici, chaque année, c’était mon cadeau d’anniversaire. Et aujourd’hui ? Il me manque quelque chose, Frieder. Est-il définitivement exclu que je sois titularisé ? Mon admission dans la fonction publique n’est-elle plus à l’ordre du jour ?
Schlösser a un sourire gêné :
– Viens un moment dans mon bureau, Rüdiger, dit-il en le prenant par les épaules pour l’y conduire. Assieds-toi. Tu veux boire quelque chose ?
– Merci. Il faut que j’aille à mon séminaire.
– Alors nous allons faire court. Je n’ai pas de poste à temps plein pour toi, et tu le sais. J’ai sans cesse essayé de l’obtenir. Tu sais bien que j’ai fait tout ce que je pouvais. Et aujourd’hui, c’est la triste vérité, aujourd’hui je me bats pour que les postes de mes collaborateurs ne soient pas supprimés. Aujourd’hui il faut que je me réjouisse que ton demi-poste et celui de Veronika soient maintenus. J’ai besoin de toi. J’aurais en réalité besoin de toi à temps plein, de vous deux à temps plein, mais on ne me l’accorde pas. C’est la vérité et les choses m’ont tout l’air de vouloir rester ainsi.
– J’ai cinquante-neuf ans, Frieder.
– À la présidence de l’université on connaît ton âge. Au-delà de cinquante, de cinquante-cinq ans, la titularisation est exclue, ça grève le budget de la caisse de retraites.
– Cinquante-neuf ans ! Ici un demi-poste, là quelques conférences, des articles et recensions pour me maintenir la tête hors de l’eau, je ne m’étais pas imaginé ça. Je suis ici depuis quinze ans, et depuis quinze ans je t’entends dire que tu veux transformer ce mi-temps en poste, me nommer conseiller scientifique. Non, pardon, je ne t’ai entendu le dire que pendant quatorze ans, car aujourd’hui, cette phrase tu ne l’as pas prononcée !
– Et tu ne l’entendras plus non plus ! Entre nous, au conseil d’administration certaines voix s’élèvent pour réclamer la fermeture de notre département. Voilà où nous en sommes. Les sciences humaines, les lettres ne rapportent pas d’argent, nous n’avons pas de sponsors, nous ne trouvons pas assez de financements privés, nous sommes perçus comme un boulet. Nous sommes un boulet. La filière “éthique” n’attirait pas un nombre d’étudiants suffisant, et nous l’avions, comme c’était souhaité, transformée en licence, le master de philosophie va être supprimé, nous sommes obligés de fermer la filière d’ethnologie, je suis content que les sciences de l’information et de la communication marchent bien. Même si notre studio vidéo ne rapporte pas suffisamment d’argent, contrairement à ce que nous avait assuré Veronika. Il ne réussit même pas à s’autofinancer. Il nous faut biaiser pour qu’il ne soit pas fermé, car nous en avons besoin, il attire des étudiants. Et si je perdais la tête et demandais qu’au lieu de ce demi-poste soit enfin créé le poste nécessaire pour toi, et un pour Veronika, je ne ferais que signer l’arrêt de mort de notre département. Un pas de plus vers sa disparition. Car nous pourrions vite nous retrouver sans rien du tout et tu n’aurais même plus ton demi-poste.
– Peux-tu imaginer à quel point ces vaines promesses réitérées pendant plus d’une décennie m’écœurent ? Ça me les brise, Frieder. Tu peux bien ricaner, c’est exactement comme je le dis. Ce n’est pas agréable de prendre de l’âge et de n’être arrivé à rien.
Schlösser garde les yeux fermés et se masse les tempes.
– Que tu n’es arrivé à rien, ce n’est pas vrai. Tu es le meilleur dans mon équipe. Tu as de l’expérience, tu sais t’y prendre avec les étudiants, tu publies plus que les autres, moi y compris, et tes articles sont toujours lisibles. Et au cas où tu voudrais quitter ton poste, ce que je ne souhaite pas, ce que je n’ose pas m’imaginer, je suis fichu. Car tu me manqueras doublement. La vérité, Rüdiger, est que ton poste, ce foutu demi-poste que tu occupes, ne sera plus pourvu, il sera supprimé. Il n’a pas survécu à la dernière évaluation, et il n’est actuellement maintenu que sous la rubrique “doit disparaître”, il peut être supprimé à tout moment. Voilà ma situation. Notre situation.
Schlösser laisse retomber ses mains et ouvre les yeux.
– Et je préfère ne pas penser à ce qui va se passer dans un an. Lorsque j’ai été nommé, je croyais que c’était la réussite. Mon ambition était apaisée, on ne pouvait plus me mettre dehors, j’avais atteint l’objectif désiré. Cinq ans plus tard, c’était la fin pour nous les germanistes, et j’ai remué ciel et terre pour que presque tous nous soyons recasés, ou presque, sans gros dégâts, dans le département des études théâtrales. Et aujourd’hui, je ne suis plus certain de pouvoir rester ici jusqu’à ma retraite. Depuis six mois on parle au conseil d’administration de faire une nouvelle évaluation, l’université doit continuer à faire des économies, de plus en plus, toujours plus, peu importe à quel prix, et tu sais aussi bien que moi ce que ça signifierait pour nous. Je ne peux plus compter sur quelque chose qui ressemble à la solidarité, aux réunions de la présidence chacun pense d’abord à soi, et nous, nous avons de toute façon la réputation d’être des fleurs exotiques, une sorte de discipline de luxe. Nous ne recevons pas de subventions, d’aucun fonds. La société cobac ne nous a pas financé le moindre poste de professeur. C’étaient des promesses en l’air, ou la boîte a des difficultés de trésorerie. Pour faire court, nous ne sommes qu’une source de dépenses pour l’université. Tu connais la suite. Nous ne sommes plus représentés au conseil d’administration, nous ne sommes plus que des membres consultatifs, nous n’avons plus de droit de vote, notre programme peut être supprimé sans autre forme de procès. Et moi je ne peux rien faire. Désormais je ne peux plus rien, ni pour moi ni pour toi. Et tout cela tu le sais aussi bien que moi.
– Sommes-nous une université ou une société de services qui doit s’organiser en fonction des désirs des clients ?
– Si le nombre des inscriptions continue à baisser, nous serons rayés d’un trait de plume, sans être remplacés.
– Et ce bazar s’est appelé un jour Alma Mater, Culture et Savoir, la mère nourricière !
– Elle ne nourrit plus, en tout cas ni ses professeurs ni ses chargés de cours.
– Bon, eh bien j’y vais, dit Stolzenburg en s’extirpant avec ostentation de son siège, mes étudiants avides de savoir m’attendent. Et nous voulons les envoyer au chômage avec une bonne culture. C’est notre devoir de pédagogues, n’est-ce pas ?
Schlösser lui jette un regard désapprobateur.
– Croisons les doigts, Rüdiger. Tu vas demain à Bâle ? Salue Gotthardt de ma part.


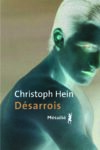








-100x150.jpg)

