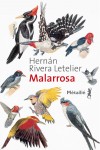Hernan Rivera Letelier revient à l’imaginaire de la pampa et des mines avec cette histoire touchante et amusante, dans laquelle ses personnages attachants jouent leur vie au nom de l’orgueil, de l’amitié, du courage. Et, surtout, de l’amour.
-
"On retrouve ici l'univers fascinant du désert des mines de nitrates d'Atacama, ou l'écrivain chilien a longtemps vécu et travaillé."Jean-Louis Kuffer24 HEURES
-
"Sous sa plume fleurit une douce folie commune à beaucoup de grands représentants de la littérature sud-américaine, une écriture généreuse où l'imaginaire de la pampa et la puissance de l'onirisme ne cèdent jamais rien au désespoir."Marie-Valentine ChaudonLA CROIX
-
"L'auteur du magnifique Soulier rouge de Rosita Quintana, Hernan Rivera Letelier, renoue avec sa terre natale, ce désert de l'Atacama dont il connaît le moindre sortilège. Ce territoire désolé lui inspire une nouvelle histoire irrésistible qui s'achève sur un match d'anthologie. La fable est un régal."Frédérique BréhautLE MAINE LIBRE
-
"Le romancier chilien réussit une fois de plus à faire entendre sa voix propre. Une voix canaille où le rire le dispute à la tendresse."Delphine PerasLIRE
En attendant le retour de la Rouquine, Expedito González nous a appris que la p’tite mère était amnésique, qu’elle ne se rappelait même pas son prénom et n’avait aucun papier. Il l’avait rencontrée deux mois plus tôt, errant dans un village du Sud et, depuis qu’il l’avait invitée à dîner, elle ne lui lâchait plus les basques. La seule piste sur laquelle il comptait pour découvrir son identité, c’était le mot “Tocopilla” qu’elle répétait toujours dans ses rêves. Ce port leur permettrait peut-être de trouver la clé du mystère ou même de retrouver un membre de sa famille.
– On voudrait se marier, nous a-t-il dit, et sans papiers c’est impossible.
Pendant que l’homme parlait, le vieux Tiroyo s’est approché de don Agapito Sánchez pour lui dire tout bas :
– J’ai l’impression d’avoir déjà vu cette souris quelque part.
A la fin de la journée, le Virtuose a cédé un peu de terrain :
– Pour vous remercier de nous avoir si bien traités, on va rester ici deux jours de plus.
Mais, pour le moment, je ne peux pas vous dire si ce sera jusqu’à dimanche. On verra plus tard. Ça dépendra de l’état de la p’tite mère et, surtout, de la façon dont les gens vont se comporter au niveau de leur contribution, a-t-il dit en se carrant sur sa chaise et en exhalant avec ostentation la fumée de sa cigarette.
Ce soir-là, le couple a dormi sur la table de billard de
la salle du Syndicat ouvrier.
Bonjour, mesdames et messieurs ; bonjour, chers auditeurs ; et vous, patients en tous genres, bonjour ! Vous écoutez comme toujours votre ami Farfán le Moko, le reporter sportif le plus rapide de Coya Sur, le plus rapide du désert salpêtrier, phénylanine hydrolase et fils de purge, le reporter le plus rapide du monde après le maître Darío Verdugo, bien entendu. Me voici avec vous, tôt le matin, en ce dimanche baigné de soleil schizophrénique, de soleil cataleptique, me voici, mesdames et messieurs, dégoulinant, ruisselant, exsudant une sueur merdique épaisse comme une potion, me voici accompagné comme toujours de mon fidèle outil de travail (ce micro caché hier soir dans le Rancho Huachipato par des cheminots purulents), me voici, mesdames et messieurs, toujours aussi désireux de vous rapporter en détail les préparatifs de cette mémorable joute sportive qui sera la dernière partie disputée sur nos terres, la dernière que notre chère sélection jaune et blanche jouera à domicile et, pour nous, la dernière avant la fin du monde. Voilà pourquoi je suis là, en plein désert, sous ce soleil d’albumine, suant comme une bête dans mon costume noir, ce costume mortuaire, preuve de ma douleur et de mon chagrin en cette journée si particulière pour nous. Je suis là, au bord de ce terrain si cher à nos cœurs, si plein de bons souvenirs, de jours inoubliables mais aussi de tant de malheurs, pourquoi ne pas le dire, je suis là, dans la seule compagnie des ombres des vautours qui planent tels des chancres dans le ciel comme pour annoncer la mort, comme s’ils présageaient l’abandon et la désolation qui vont s’abattre sur ce terrain de jeu d’où je vous parle, complètement seul, je vous l’ai dit, mis à part l’ombre de ces oiseaux de mauvais augure et la silhouette rachitique du petit homme qui vient d’arriver pour délimiter le terrain ; oui, madame ; oui, monsieur ; oui, chers auditeurs, nous voyons maintenant arriver le vieillard, courbé comme un paysan ramassant des patates, poussant sa brouette remplie de salpêtre, notre précieux or blanc, avec lequel il va tracer les lignes ; oui, aimables patients, voici le toujours excessif Silvestre Pareto, excellent traceur de terrain mais aussi, d’après les langues vipérines, le plus implacable des empoisonneurs
de chiens au service du Bureau de bienfaisance. Il a tué plus de toutous avec ses boulettes empoisonnées que les nazis n’ont tué de juifs, là-bas, dans les Allemagnes, il a fait crever plus de clébards que la peste noire n’a tué de chrétiens au Moyen Age. Pourtant, ce vieillard est au fond un brave type ; regardez ce petit bonhomme aussi silencieux et efficace qu’un staphylocoque, toujours serviable, toujours élégant, toujours prêt pour la bataille, regardez-le travailler comme tous les dimanches sur son petit lopin de terre (c’est ainsi qu’il appelle notre citadelle sportive, en souvenir peut-être des prairies de son Sud natal). Regardez-le tracer et chouchouter le terrain où, comme il le dit lui-même en pleurant et en reniflant chaque fois qu’il prend une cuite, il voudrait être enterré le jour où il passera l’arme à gauche, le jour où il lâchera la rampe, le jour où il mangera les pissenlits par la racine, le jour où sa sainte femme finira par l’empoisonner en lui servant au déjeuner ses propres boulettes à la strychnine (c’est ce que lui disent pour le taquiner les poivrots du coin). Oui, madame ; oui, monsieur, sous le soleil purulent, notre ami Silvestre Pareto commence à tracer le rond central avec une poigne digne d’un chirurgien entaillant la panse d’une parturiente pour procéder à une césarienne, il trace à l’œil nu ce cercle dont le centre est l’endroit précis où cet otopurulent voudrait qu’on enterre ses restes mortels larbinophiles, phénylalanine hydrolase et fils de purge.



-100x150.jpg)
-100x150.jpg)