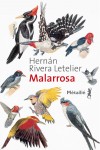En 1907, de grandes grèves éclatent dans les mines de nitrate du désert d’Atacama, les mineurs entreprennent une grande marche à travers le désert en direction de la petite ville de Santa María de Iquique, où ils pensent négocier.
Leurs familles les accompagnent. Hernán Rivera Letelier aussi avec ces personnages dont il a le secret: Olegario le mineur amoureux de l’image féminine qui figure sur son paquet de cigarettes, Gregoria l’énergique veuve au grand cœur,
Idilio l’amoureux du vent constructeur de cerfs-volants et la jeune Liria María. Tous ces protagonistes pleins de force et d’innocence traversent le désert et sont inexorablement entraînés vers le dénouement tragique et réel qui verra plus de trois mille d’entre eux impitoyablement massacrés à la mitrailleuse.
Hernán Rivera Letelier mêle épopée sociale et vies romanesques dans un récit à plusieurs voix magnifique et poignant. Amitiés, conflits, solidarité et amours en sont la trame. Il complète ici le cycle romanesque de cet univers prodigieux que fut le monde des mines d’Atacama, qu’il chante dans une écriture rude et magique qui n’appartient qu’à lui.
-
« En 1907, des milliers de mineurs affluent de toutes les compagnies salpêtrières basées dans le désert chilien d'Atacama vers la ville côtière d'Iquique, [...] décidés à faire entendre leurs revendications salariales. [...] L'hommage d'Hernan Rivera Letelier à ces fleurs noires, les morts de l'école de Santa Maria, est avant tout coloré, parfumé, allègre, comme son langage, baroque. »Sabine AudrerieLE FIGARO
I
Sur le toit de la maison, découpés sur la lumière de l’aube, les vautours ressemblent à un couple de petits vieux en frac, tout rabougris et les mains dans les poches.
Statiques comme des personnages de girouette et nimbés de relents de pourriture, ils semblent dormir profondément l’un près de l’autre. Pourtant, quand on leur jette les premiers morceaux de carne depuis l’intérieur de la maison par un trou percé dans le toit, ils arquent nerveusement leurs têtes rouges et, avec des grognements gutturaux de charognards, se livrent à de bruyantes agapes sur les plaques de zinc.
Tout en écoutant le crissement des serres ripant sur la tôle, Olegario Santana, encore en tricot de corps, finit de dévorer son propre morceau de viande saignante accompagné d’oignons hachés menu comme pour un dindon, aux dires de son ami Domingo Domínguez. Puis, après avoir bu un grand bol de thé bien amer, il penche son visage sur le fourneau de briques et allume sa deuxième Yolanda de la journée (il fume la première au lit, dans le noir). Les coudes sur la table nue, il profite des dernières minutes pour fumer avec parcimonie tout en contemplant le visage de la femme dessinée sur le paquet de cigarettes.
À cinquante-sept ans, Olegario Santana n’a jamais vu un visage aussi beau chez une femme en chair et en os. De plus, il ne sait pas pourquoi diable le seul prénom de Yolanda fait naître en lui l’image d’une femme fatale, une de ces femelles éperdues de passion évoquées par les vieux dans les salpêtrières pendant qu’ils triturent les pierres sous un soleil aussi ardent que leurs délires. La seule femme qui soit passée dans sa vie est une veuve rencontrée à Agua Santa avec laquelle il a vécu à la colle, sans joies ni peines, pendant quatorze longues années. Elle était morte quatre ans plus tôt de la peste bubonique ramenée à Iquique par le Columbia, le « bateau maudit » comme les gens avaient surnommé le vapeur contaminé. La femme, une grosse matrone bolivienne qui avait dix ans de plus que lui, mauvaise haleine et une docilité plutôt insipide (forniquer avec elle ou avec une brebis ahurie ne faisait pas grande différence), était morte sans même lui laisser la compagnie d’un souvenir agréable contre lequel blottir son chagrin d’homme seul. Depuis lors, il ne partage avec personne le cilice de son matelas de feuilles de maïs et, dans le triste désordre de sa maison à l’abandon, mijote volontairement à petit feu dans sa poussiéreuse solitude; solitude méticuleuse adoucie depuis peu par la présence passagère de ses deux vautours apprivoisés, des volatiles aussi aigris et silencieux que lui.
Catalogué bourru et taciturne, personne ne sait grand-chose du passé d’Olegario Santana. Un surin d’acier dont il se sert pour dénuder la mèche des explosifs et qu’il a brandi plus d’une fois dans les bagarres entre mineurs – beaucoup assurent qu’il a déjà plus d’un chrétien sur la conscience – donne à penser à ses collègues qu’il a participé à la campagne héroïque de 1879. Mais lui n’en parle pas et n’adhère à aucune des associations d’anciens combattants qui prolifèrent dans les villages et les campements salpêtriers. Considéré comme un des meilleurs ouvriers de San Lorenzo – personne ne peut rivaliser avec lui dans le maniement de la masse de vingt-cinq livres – on le voit jour après jour fouiller, triturer, entasser et charger les blocs de minerai avec une détermination et un acharnement de pénitent illuminé. On l’a rarement vu accoudé au comptoir de l’auberge et jamais dans les bals et les veillées artistiques de la salle des fêtes. S’il boit, c’est enfermé chez lui. Il a deux ou trois amis proches et un seul habit du dimanche: un costume noir avec gilet dans la poche duquel on découvre avec surprise l’éclat de sa chaîne de montre en or, accessoire arboré avec une grande ostentation par les mineurs. Personne ne sait où passe son salaire. Sa seule prodigalité notoire, ce sont ses quarante Yolanda quotidiennes qui tachent de nicotine ses dents et ses fines moustaches noires.
À six heures et demie du matin, vêtu de sa blouse de travail et de son pantalon de droguet rapiécé de toutes parts, Olegario Santana coiffe son panama et, sa bouteille d’eau pendue à l’épaule, se dirige à grandes enjambées vers la mine. Dehors, un azur opalescent métallise déjà le ciel et, à en juger par la tiédeur de l’air et la luminosité de l’aube, il va faire une chaleur du diable. En le voyant dans la rue, les vautours quittent le toit et prennent leur envol pour le suivre sur le chemin du travail, planant en cercles lents au-dessus de sa tête.
La compagnie salpêtrière San Lorenzo, dans le canton de San Antonio, se compose du campement du haut et du campement du bas et la maison d’Olegario Santana, faite comme toutes celles des ouvriers de plaques de tôle disjointes et de planches de pin Oregon, se trouve au dernier numéro de la dernière rue du campement du bas. Plus loin, il n’y a plus que l’infinie solitude des sables et l’illusion fatidique des mirages du désert.
Peu après son arrivée en rase campagne, le mineur éprouve une étrange impression. Les sens en alerte, il s’arrête à mi-chemin. Tout en tournant lentement sur lui-même pour ausculter, sourcils froncés, la courbe de l’horizon, il sort, allume et exhale la fumée grisâtre d’une autre de ses Yolanda fripées. Le silence minéral des dunes résonne, plus aigu qu’à l’ordinaire. Pas un crissement de roues de charrette ne parvient à ses oreilles, pas l’ombre d’un ouvrier ne se découpe sur les sentiers poussiéreux. Pensif, il reprend sa route après avoir tiré une deuxième taffe de sa cigarette. Il y a aujourd’hui quelque chose qui cloche. Soudain, pratiquement arrivé aux premières nitrières, un groupe d’hommes apparaît derrière les tas de minerai. On l’entoure, on le regarde d’un air soupçonneux et on l’interroge d’un ton revêche: ce foutu cinglé ne sait-il pas que la grève générale a été déclarée hier soir à San Lorenzo? « Hier, mardi 10 décembre 1907 », lui répète-t-on d’un air moqueur au cas où le petit vieux aux vautours ne connaîtrait même pas la date du jour.
Olegario Santana l’ignorait en effet.
Après l’avoir mis au courant des événements on le somme, comme tous ceux rencontrés ce matin-là, de nous accompagner dans la tournée des nitrières pour convaincre les autres ouvriers de cesser le travail et de prendre part au conflit. Après quoi, on irait tous ensemble à l’administration demander une augmentation de salaire. Dans cette grève, tout le monde doit mettre la main à la pâte. Plus on fera de boucan devant la porte de ce gringo de merde, meilleur ce sera pour le mouvement. « Par conséquent, même les vautours sont bons à grossir nos rangs », dit en regardant le ciel et en éclatant d’un rire rauque l’aîné des frères Ruiz, notoirement connu pour être l’un des ouvriers les plus intraitables et les plus indisciplinés de la compagnie salpêtrière San Lorenzo.
Visiblement surpris, Olegario Santana dévisage les hommes un par un. Excepté ceux qui travaillent dans les mines avoisinantes, il ne connaît que de vue la plupart d’entre eux. Pourtant, de toute évidence, ils ont entendu parler de lui puisqu’ils viennent de mettre les vautours sur le tapis. Calmement, il tire une dernière taffe du mégot de sa cigarette en grognant qu’il n’est pas un salaud de briseur de grève, change sa bouteille d’eau d’épaule et s’en va avec eux parcourir les autres nitrières.
Dans le ciel, les vautours se laissent entraîner de plus en plus haut par les courants d’air tièdes et s’éloignent vers l’intérieur du désert en quête de charogne tandis que leurs ombres s’entrecroisent sur le sol, barbouillant la blancheur infinie des immensités salpêtreuses.
C’est par un jour glacé de juillet qu’Oligario Santana avait trouvé les vautours à l’intérieur de sa tranchée, quand ils n’étaient encore que des oisillons laids et chétifs. Pour lui faire une farce (certains l’avaient surnommé Olegario le Vautour à cause de son nez crochu et de son habitude de s’habiller toujours en noir), les plus vieux des mineurs les avaient mis dans une boîte à chaussures pour les déposer là en guise de cadeau pour sa fête: c’était la Sainte-Anne. Lui, à la fois pour suivre la plaisanterie et combattre les accès de mélancolie de sa solitude pénitentielle, les avait ramenés chez lui. Après leur avoir confectionné un nid dans la cour, il avait commencé à leur donner à manger à la main. Pour apaiser leur soif, il imbibait d’eau des bouts de coton et la laissait tomber goutte à goutte dans leurs becs. À en juger par leur plumage clairsemé, ils n’avaient pas plus de deux mois. Ensuite, quand les petits avaient grandi, il les avait installés sur le toit avec une vieille cuvette d’eau à leur portée et, par le trou d’une plaque de tôle, s’était mis à leur jeter des lambeaux de viande, des bas morceaux avariés que le boucher du magasin d’alimentation lui vendait vingt centavos le kilo.
Après quelques laborieuses tentatives de vol, un samedi matin, à la sortie du travail, les vautours lui avaient fait la surprise de s’élever à l’unisson en une parfaite manœuvre de décollage. Glissant doucement dans l’air, ils l’avaient suivi jusqu’à son travail. Depuis lors, chaque jour de la semaine, les volatiles l’accompagnent sur le chemin menant aux nitrières. « Voilà Olegario », disent les vieux quand ils aperçoivent les vautours dans le ciel. Le reste du temps, pendant qu’il fait sa dure journée de travail, les volatiles se perdent derrière les collines en quête de nourriture. Au crépuscule, à l’heure où le soleil se couche, ils réapparaissent pour faire avec lui le chemin du retour. Quand Olegario Santana reste plus longtemps à entasser le minerai et arrive à la maison à la nuit tombée, il trouve les deux vautours installés tranquillement l’un près de l’autre sur le toit. Un après-midi, après une journée particulièrement pénible où, par-dessus le marché, un ouvrier était mort, atteint par une explosion de poudre, le mineur était arrivé chez lui la rage au cœur et avait voulu les chasser du toit à coups de pierres. Mais les cris et le scandale des voisins l’en avaient empêché. Les vautours s’élevaient, voltigeaient un moment et, imperturbables, revenaient ensuite se poser sur les tôles. Ses collègues l’avaient chambré tout le reste du mois: « Vous êtes un peu leur maman, mon vieux. »
Le parcours des grévistes à travers le désert est fructueux. À la vérité, les ouvriers ne se font pas prier longtemps pour suspendre leurs activités et, avec des cris joyeux, rejoignent progressivement le groupe. À mi-chemin, dans la cohue des travailleurs, Olegario Santana tombe sur deux de ses rares amis à San Lorenzo. Domingo Domínguez, le piqueur, quasiment le seul à lui rendre visite de temps en temps, et José Pintor, un charretier connu des habitants de San Lorenzo pour être un anar chronique « du genre à lire le journal à table », comme disent les vieux mineurs. Dès qu’il l’aperçoit dans la foule des ouvriers, Domingo Domínguez s’approche de lui en souriant de toutes ses dents fraîchement étrennées et lui souffle à l’oreille son haleine perpétuellement alcoolisée pour lui murmurer que la nuit dernière, dans le campement du haut, on avait vu José Brigg en personne, l’anarchiste le plus célèbre de la salpêtrière Santa Ana et de tout le canton de Tarapacá. « C’est du sérieux, ami Olegario », lui dit-il tout bas.
À neuf heures du matin, alors qu’un soleil épais coule sur nos fronts, le tapage des ouvriers émergeant du côté des nitrières est tout simplement glorieux. Nous tous, piqueurs, charretiers mais aussi chulleros, falqueadores, punteros, cateadores, sacaboneros, c’est-à-dire tous les « boucanés » comme on appelle ceux qui travaillent en plein soleil, nous entrons en un seul et même tourbillon de poussière dans la rue principale du campement pour nous diriger vers le bâtiment de l’administration en brandissant nos outils de travail et en rugissant d’une voix rauque: « Vive la grève, bordel, ras-le-bol des emmerdements, c’est maintenant ou jamais! » Les clameurs des grévistes remplissent l’air des ruelles de San Lorenzo et se glissent par les fissures des maisons de tôle; le vacarme fait s’ouvrir portes et fenêtres où des femmes et des enfants émerveillés font des signes d’adieu aux hommes qui marchent d’un air résolu dans le cortège prolétaire des insurgés.
Réunis sur l’esplanade de l’administration, sans cesser de crier nos revendications, nous avons soudain entendu, interloqués sous le coup de l’émotion, s’arrêter les chaînes de transformation: les concasseurs, les fours, les poulies rotatives et chacun des moteurs, des tours et des fraiseuses des ateliers. Et ensuite, dans le silence titanesque de la ferraille, nous avons vu apparaître un nuage crasseux d’ouvriers, le visage dur et décidé. C’était les mécaniciens, « les gueules noires » comme on appelait les camarades travaillant sur les machines. Les uns venaient vers nous, le visage, les mains et les vêtements barbouillés de cambouis, les autres, torse nu, encrassés de la tête aux pieds, marchaient d’un pas ferme sur les quatre semelles superposées de leurs godillots grinçants. Tourneurs, forgerons, derripiadores, chancheros, acendradores, canaleros, arrinquines étaient là et même les galibots, pour la plupart, des enfants d’âge scolaire, criant eux aussi, en chœur et le poing levé: « Vive la grève, bordel, on est avec vous, camarades. Quoi qu’il arrive. » Exaltés et émus, on sentait couler dans nos veines non pas du sang mais du salpêtre en fusion.
La police et les vigiles de la compagnie, sbires du gringo Turner, impuissants devant l’excitation tumultueuse des travailleurs, se contentaient d’observer de loin et d’enregistrer mentalement nos visages. Nous étions plus de huit cents grévistes réunis autour des frères Ruiz, lesquels ne cessaient de nous haranguer et de nous encourager à ne pas courber l’échine devant le capitalisme: « Chers camarades, nos revendications sont justes, l’heure est venue de mettre un terme à l’exploitation et à la rapine effrénée de ces profiteurs de patrons. » Et nous, euphoriques, vociférant à en perdre la voix, nous approuvions à grands cris en brandissant pelles, masses, barres à mines et marteaux comme autant d’étendards.
Les frères Ruiz avaient, disait-on, entendu un jour don Luis Emilio Recabarren parler dans le port de Tocopilla et contracté à cette occasion l’esprit de la révolution. Sans aucune expérience des mouvements ouvriers, ils avaient pourtant planifié la grève. Ni agitateurs professionnels, ni profiteurs, ni fainéants, ni êtres immoraux – comme les propriétaires des salpêtrières cataloguaient tous ceux qui osaient élever la voix pour réclamer leurs droits – mais des ouvriers exploités, comme les autres, ils avaient préparé le conflit avec une telle conviction et de manière si discrète que même parmi beaucoup d’entre nous, les travailleurs, comme dans l’administration de la compagnie, la nouvelle avait causé une grande surprise.
Depuis longtemps, les ouvriers du salpêtre présentaient des revendications salariales et sociales non seulement à San Lorenzo mais dans toutes les compagnies de tous les cantons du désert de Tarapacá. Avec, pour unique réponse le mépris des administrateurs, le renvoi immédiat sans la moindre considération pour la famille et une terrible répression contre les meneurs de la rébellion, comme les autres qualifiaient l’acte légitime de demander une augmentation de salaire. Maintenant, les choses étaient différentes. On savait, par les journaux d’Iquique, que plusieurs corporations de dockers de ce port salpêtrier s’étaient également mises en grève. On n’était donc plus tout seuls. Si la cherté de la vie occasionnée par la baisse de la monnaie était mauvaise pour l’ensemble du pays, elle était angoissante et dramatique pour les mineurs. Le change de la livre à huit pences avait quasiment diminué nos salaires de moitié tandis que le prix des articles vendus dans les magasins d’alimentation, appartenant eux aussi aux patrons des compagnies, avait doublé. Une seule miche de pain valait un peso entier! C’est-à-dire le quart de notre salaire journalier mon pote, putain de merde!
Tout ça, on l’a dit au gringo Turner quand, arborant ses superbes bottes de cheval, sa casquette de safari (il ne l’enlevait jamais, même pour prendre son thé de cinq heures) et sa bouffarde entre les dents, il a daigné nous faire face sous le porche de l’édifice. Protégé par le chef des vigiles, le fusil pointé sur nous, tandis que la chaleur de midi faisait crépiter les tôles, le gringo nous a écoutés comme on écoute au loin aboyer les chiens. Durcissant l’expression méprisante de son visage joufflu et sans cesser de mâchouiller sa pipe, il nous a dit avec son putain d’accent étranger ce que nous savions d’avance – ce que disaient toujours les administrateurs de toutes les compagnies chaque fois que les travailleurs osaient demander des augmentations de salaire – à savoir que les œuvres de bienfaisance n’étaient pas de sa compétence, qu’il devait consulter l’administration centrale à Iquique et que demain ou peut-être après-demain, il pourrait nous donner une réponse. Sous toute réserve.



-100x150.jpg)
-100x150.jpg)