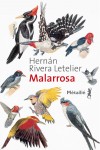Elle devait s’appeler Malvarrosa mais, à cause d’une erreur de l’officier de l’état civil ou parce que son écervelé de père était trop soûl en allant la déclarer, elle finit par s’appeler Malarrosa.
Cette petite fille marquée par le destin dès sa naissance accompagne son père dans les bouges où se déroulent ses parties de cartes et parcourt avec lui les hameaux environnants au gré des rencontres pugilistiques entre Oliverio Trébol et les “champions” locaux.
Elle vit au milieu de personnages hauts en couleur, campés avec une truculence toujours teintée de tendresse : Saladino, père irresponsable et joueur poursuivi par la guigne, Oliverio Trébol dit Tristesburnes, le gros bras au cœur tendre, sans oublier Isolina del Carmen Orozco Valverde, l’institutrice d’âge canonique qui ne désespère pas de ramener tout ce beau monde dans le droit chemin.
Au fil des mois, ses vêtements masculins ne peuvent plus dissimuler les rondeurs naissantes de Malarrosa. Alors, avec une lucidité et une détermination extraordinaires, ce sera elle qui, pour la première fois, décidera de son destin.
Fidèle à sa vocation de chantre du désert et de l’épopée du salpêtre, Hernán Rivera Letelier a choisi pour toile de fond l’agonie de Yungay, un de ces innombrables villages du Nord qui ont disparu comme autant de mirages.
-
Plus d'infos ici.Pascale ArguedasCALOU
-
Plus d'infos ici.YvLE BLOG DE YV
-
« Dans ce décor hallucinant, l’écrivain chilien bâtit un irrésistible roman peuplé de personnages inoubliables qui rêvent de voir la mer… »Frédérique BréhautLE MAINE LIBRE
-
« Malarrosa maquille les morts et son art portera chance à son père. Elle changera son destin. Avant de choisir le sien. Séduisant. »Hervé BerthoOUEST France
-
« Une leçon d’espoir et de littérature. »Marianne DubertretLA VIE
Tel un prodigieux mirage dans le désert, le train franchit le milieu du jour en traînant une tapageuse cargaison d'oiseaux ; alouettes, chardonnerets, linottes, grives, pinsons, canaris, mésanges, rouges-gorges et tout ce que le sud de la patrie compte d'oiseaux chanteurs s'entassent dans de fragiles cages d'osier, des centaines de volatiles aux plumages et aux couleurs les plus variées traversent à trente kilomètres à l'heure le paysage le plus aride du monde dans un charivari hallucinant de trilles et de gazouillis.
“C'est une embauche d'oiseaux”, disent les vieux, faisant allusion à ces troupeaux de paysans ramenés périodiquement du sud du pays à qui on fait miroiter la promesse illusoire qu'on ramasse l'argent à fleur de terre dans les mines de salpêtre.
L'épouse de l'administrateur d'une compagnie s'était mis en tête d'avoir une gigantesque volière dans son jardin. La dame possédait déjà une piscine, un terrain de tennis, des plantes et des fleurs mais elle voulait maintenant une volière “pour exorciser ce silence qui me brise le cœur, mon bien-aimé”.
Monsieur l'administrateur qui, pour lui rendre hommage, avait donné à la mine le prénom de sa femme, commanda un millier d'oiseaux chanteurs de la campagne chilienne, une cargaison qui fut transportée en bateau, déchargée dans le port de Coloso et amenée dans le désert sur une plate-forme accrochée à la queue du train de voyageurs. C'est pourquoi, ce matin-là, les passagers partirent pour le désert en traînant derrière eux un tohu-bohu d'oiseaux d'espèces les plus diverses. Le malheur se produisit peu avant leur arrivée à destination. Le train dérailla, la plate-forme se renversa (elle fut la seule à basculer), les cages dégringolèrent, s'ouvrirent, se brisèrent et, comme le racontèrent les voyageurs, les yeux encore ébahis, dans les tavernes de Yungay, ce fut incroyable : un tumulte d'oiseaux en fuite – chevêches, cailles, perruches, pluviers, grues, merles, calandres et tous les oiseaux que compte le sud de la patrie, Dieu m'en est témoin, mon pote – s'égaillèrent dans les cieux du désert, bariolant l'espace et striant de leurs trilles le dur diamant de la mi-journée.
“Un tourbillon d'oiseaux”, disaient les vieux en riant.
Cela se passa dans le canton d'Aguas Blancas. Et, à l'époque où Malarrosa apprenait à faire ses premiers pas, il était encore possible, dit-on, d'apercevoir soudain le plumage coloré d'un de ces fugitifs posé sur les fils du télégraphe. Après leur journée sous un soleil de plomb, les mineurs arrivaient dans les bistrots en racontant le miracle d'un passereau venu gazouiller dans la salpêtrière pour y chercher de l'eau. Parfois, à l'heure indolente de la sieste, un merle ou un cardinal entrait par la fenêtre dans un lupanar et les putes les plus jeunes, excitées comme des pensionnaires de couvent, les poursuivaient de chambre en chambre, toutes nues et en criant, pour essayer de les capturer avec leurs négligés de soie. Le père de Malarrosa racontait que sa petite fille avait un jour attrapé un canari (un chardonneret selon sa mère) surpris à picorer les graines des ramilles d'un balai.
Et puis, au bout d'un certain temps, on ne trouva plus que des oiseaux morts. Dans les terrils, sur la voie ferrée, dans les jardins d'enfants et même dans les vieux cimetières du désert, les gosses découvrirent les petits corps poussiéreux de rouges-gorges, de litornes ou d'alouettes, décolorés peu à peu par le soleil comme les fleurs de papier.
1
Elle devait s'appeler Malvarrosa. Un prénom choisi en l'honneur de sa mère, Malva Martina, et de sa grand-mère extralucide, Rosa Amparo. Cependant, à la suite d'une erreur de l'officier d'état civil ou parce que son écervelé de père était tellement bourré en allant l'inscrire qu'il pouvait à peine bredouiller un mot, elle finit par s'appeler Malarrosa. Si le prénom a une influence sur le caractère et le destin d'un être humain comme le prétendent les devins de l'onomastique, elle était destinée à être une enfant heureuse, un peu crédule si on veut, avec de jolies fossettes comme toutes les Malvarrosa du monde, mais une seule lettre ôtée de son prénom bouleversa toutes les prévisions et la transforma en ce qu'elle finit vraiment par devenir : une gamine farouche, silencieuse, solitaire, avec d'épais cheveux noirs et des yeux couleur de mirage.
Bien que née dans la compagnie San Gregorio, Malarrosa vécut dès l'âge de trois ans à Yungay, un village surgi près de la gare ferroviaire du même nom dans la canton d'Aguas Blancas, la région du désert d'Atacama qui, de par son paysage inhospitalier, ressemble le plus à une planète inhabitée. Elle avait l'air apathique ; pourtant depuis son plus jeune âge elle regardait déjà la mort en face, sans sourciller ni baisser les yeux et avec plus de cran qu'elle n'en montrerait ensuite devant le regard inquisiteur de la vieille institutrice irascible, mademoiselle Isolina del Carmen Orozco Valverde.
En effet, non seulement elle avait survécu à la tuerie de San Gregorio, été témoin d'un grand nombre de morts violentes dans les tripots et les taudis où la traînait son père, poussé par la passion du jeu, non seulement elle avait vu agoniser et mourir sa grand-mère et son grand-père maternels à deux mois d'intervalle et assisté au décès prématuré de ses deux frères, deux petits anges jumeaux morts “d'effeuillement” disait sa mère, quatre jours après leur naissance (elle avait confectionné leurs petites ailes dorées, les œillets destinés à être déposés dans leurs menottes glacées, découpé des lunes et des étoiles pour les coller sur le drap couvrant le mur au pied duquel on les avait veillés, chacun d'eux assis sur sa petite chaise de paille) ; mais en plus, trois ans plus tôt, sa mère avait rendu le dernier soupir dans ses bras, après une longue agonie, rongée de l'intérieur par la tuberculose qui n'avait laissé d'elle qu'une enveloppe raidie et transparente.
“Elle est morte comme un petit oiseau”, dit-elle seulement à la première voisine venue l'aider à préparer la veillée funèbre.
Depuis qu'elle avait attrapé le canari qui picorait les ramilles du balai dans la cour de sa maison – elle l'avait mis dans une boîte à chaussures percée de trous jusqu'au jour où il était mort de mélancolie –, avec ses craies de couleur elle peignait et dessinait exclusivement des oiseaux et toutes ses comparaisons, ses souvenirs et ses rêves étaient en rapport avec eux.
Quand le malheur se produisit, son père tentait sa chance aux cartes dans une des compagnies salpêtrières (le chef de gare essaya vainement de le localiser par télégraphe), Malarrosa, sans verser une larme, se chargea donc seule de toutes les démarches liées aux funérailles de sa jeune mère. Elle lui ferma les yeux pour toujours, choisit pour l'habiller une de ses deux robes du dimanche (celle en taffetas violet avec les petits volants dont elle prenait tant de soin), coiffa sa longue chevelure et la rassembla d'un seul côté du visage, ainsi que sa mère aimait à le faire quand son mari était absent, et l'installa dans le cercueil, les mains croisées sur la poitrine, comme elle l'avait vu sur la photographie d'une impératrice d'un lointain pays de légende. Ce fut elle aussi qui farda son pâle petit visage de morte avec du rouge et de la poudre de riz pour la rendre belle et charmante afin que Dieu l'accueille dans son Royaume avec les couleurs et la beauté de sa jeunesse (pendant les après-midi indolents du désert, pendant qu'elle l'épouillait délicatement, sa mère lui parlait souvent du jour où elle avait été élue Reine des Moissons dans son village du Sud). Malva Martina était si bien pomponnée et si sereine dans l'encadrement de son cercueil qu'elle souleva l'admiration de toutes les femmes venues assister à sa veillée funèbre.
“Cette gamine a le don de ressusciter les morts, disaient les matrones, émerveillées. Regardez, on dirait qu'elle a donné un souffle de vie à la défunte.”
Les gens étaient si épatés par ses talents de maquilleuse que, depuis ce jour-là, on sollicita les services de Malarrosa dans tous les foyers où survenait un décès, qu'il s'agisse d'un homme ou d'une femme. Avec ses pinceaux, sa poudre de riz, ses rouges à lèvres et ses fards, la gamine réalisait de véritables miracles sur la pâleur cireuse de la rigidité cadavérique.
“Dieu nous garde cette petite, elle a un don”, disait-on, et cette sorte de vertu était tellement appréciée que l'institutrice octogénaire qui prédisait sa propre mort à qui voulait l'entendre lui fit promettre – elle lui donna même d'avance quelques pièces d'argent péruviennes – qu'elle seule et personne d'autre lui “rosirait les joues” sur son lit de mort.
Malgré sa tristesse, Malarrosa fit preuve d'assez de lucidité et d'entêtement pour installer la chambre mortuaire de sa mère dans la salle à manger de leur maison et non dans le salon du Club Yungay comme le souhaitaient certaines pimbêches chez qui la défunte faisait le ménage deux fois par semaine. Elle recouvrit elle-même le grand miroir biseauté que sa mère aimait tant, retourna les rares chromos restants (son père avait commencé à vendre les meubles de la maison pour rembourser ses dettes de jeu), se procura des bancs supplémentaires, reçut sans pleurer les condoléances de personnes connues et inconnues, disposa les fleurs de papier, suspendit les couronnes aux clous du mur et, pendant la nuit, avec l'aide de quelques pieuses voisines qui lui prêtèrent tasses, sucriers, petites cuillères et tous les ustensiles de cuisine nécessaires, prépara le chocolat chaud et le servit, avec la gravité d'une veuve de militaire, à ceux qui assistaient à la veillée.
Le lendemain, sans avoir fermé l'œil, elle prit la tête du cortège en portant la croix de bois avec une force de caractère admirable. Au cimetière, personne ne la vit pleurer. Bien au contraire, elle jeta les premières poignées de terre dans la fosse le cœur inébranlable, reçut les dernières condoléances avec sérénité et un immense courage et repartit chez elle avec un stoïcisme déconcertant chez une enfant de dix ans.
“Cette façon de côtoyer la mort sans broncher lui vient de famille”, disaient les voisines et elles racontaient, agitées et fébriles, ce que la grand-mère de la petite fille évoquait souvent de son vivant : dans sa jeunesse, là-bas dans les campagnes de son Sud natal, elle avait exercé quelque temps le métier de pleureuse. Il s'agissait de pleurer pendant la veillée funèbre d'un inconnu ; plus le mort était riche et plus les pleurs se devaient d'être plaintifs et déchirants. Il fallait verser des larmes à s'en briser le cœur. D'après doña Rosa Amparo, elle était l'une des plus demandées à des kilomètres à la ronde. Avec sa tunique gris-bleu, confectionnée spécialement pour ces occasions, elle arrivait dans les veillées funèbres aux heures de grande affluence, présentait ses plus sincères condoléances à la famille, s'installait près du cercueil et, les manches bourrées de mouchoirs, se mettait à pleurer de manière inconsolable. Dans ses moments d'inspiration et quand la fortune du défunt en valait la peine, elle accompagnait ses larmes de gémissements et de convulsions tout en se frappant la poitrine de désespoir et en s'arrachant de grandes mèches de cheveux. D'après les femmes, dans les files d'attente des magasins d'alimentation, la grand-mère racontait, en agitant fièrement son éventail, que “certains se mettaient même à applaudir”.
Quand le père revint à la maison, sa femme était déjà sous terre depuis trois jours. Tous les voisins, y compris les taulières et les cocottes des rares maisons closes du village encore en activité ainsi que les amis flambeurs du veuf, s'étaient spontanément cotisés pour couvrir les frais des obsèques.
Dès lors, c'est-à-dire depuis trois ans, Saladino Robles, joueur minable – et d'une malchance chronique –, insignifiant de corps et d'esprit et boiteux du pied droit, traînait sa fille par la main où qu'il aille, faisant de son mieux pour essayer de l'élever et de la protéger. En réalité, c'était exactement le contraire. C'était elle qui jouait pour lui le rôle de mère. Malarrosa s'inquiétait de sa santé, prenait soin de ne pas le laisser à la merci des intempéries quand il était rond comme une queue de pelle, de le faire manger suffisamment pour qu'il ne commence pas à cracher le sang comme sa mère et surtout de tenir toujours son linge propre. Et, dans la fièvre des nuits de jeu, elle restait là sans fermer l'œil, veillant comme une lionne à ce que rien de fâcheux n'arrive à son petit papa. À son insu, elle cachait même un petit couteau sous ses vêtements pour le défendre dans les possibles échauffourées entre joueurs belliqueux et se défendre elle-même contre les poivrots libidineux et les gommeux pervers qui, dans les bouges, essayaient de la tripoter et lui offraient de l'argent pour qu'elle les suive dans les coins sombres. Malgré tout, et même s'il y avait entre eux plus de différences que de similitudes – la seule chose qu'elle avait héritée de lui, c'était la couleur de puna de ses yeux en amande –, même s'il lui faisait porter des salopettes et des chemises de garçon, et ne l'appelait jamais par son prénom, Malarrosa adorait son père.
Et si, depuis le jour de son baptême, une succession de malheurs avait inexorablement suivi ses pas, les aléas de sa véritable histoire commencèrent peu avant ses quatorze ans, très exactement la nuit où Amable Marcelino, le meilleur et le plus redouté des joueurs de poker du canton d'Aguas Blancas, fut abattu d'une balle dans un bouge de Yungay, à seulement deux mètres de l'endroit où, assise sur un petit banc de bois, elle essayait de recoller les morceaux de plâtre de sa tirelire en forme de poule.
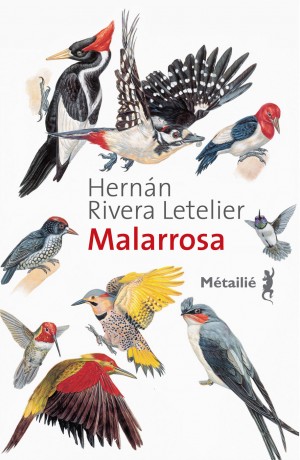


-100x150.jpg)
-100x150.jpg)