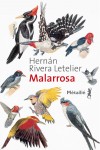Elle s’appelle Golondrina del Rosario, elle joue du piano et enseigne la déclamation poétique, elle est toute délicatesse et sensibilité. Il s’appelle Bello Sandalio, il est roux et trompettiste de jazz dans les bordels de la région. Ils se sont rencontrés une nuit de passion, elle s’est donnée à lui… Ils vivent dans une colonie minière du désert d’Atacama où l’on attend une visite présidentielle, mais la fanfare des « damnés de la terre », menée par le barbier anarchiste, prépare un autre type de réception. L’auteur de La Reine Isabel chantait des chansons d’amour s’est donné pour tâche de chanter » son » désert “ où les seules fleurs sont l’ombre des pierres ” et d’en raconter l’épopée infernale à travers des personnages qui vont à l’essentiel : la vie et la mort, la douleur et la folie, la force de l’amour, des rêves et de l’utopie. La plume de Hernan Rivera-Letelier est parfois narquoise, souvent drôle et toujours chaleureuse. Touchant à l’essence même de l’existence – la mort, l’amour, la violence, l’utopie – , elle croque des personnages forts de destins chaotiques et douloureux. ” Lire
-
« La plume de Hernan Rivera Letelier est parfois narquoise, souvent drôle et toujours chaleureuse. [...] Elle croque des personnages forts de destins chaotiques et douloureux. »LIRE
Tout comme les familles qui transportaient des animaux vivants parmi leurs frusques – ces chevreaux et ces agneaux rendaient encore plus pénible la promiscuité à bord – ils avaient trouvé le moyen d’embarquer leur grand piano à queue. Et, dans le tangage des nuits de haute mer, sous un ciel d’étoiles cruelles et rouillées, Elidia del Rosario, son épouse malade, avait eu le courage de distraire cet obscur troupeau entassé sur les planches du pont en jouant du Chopin. Et elle avait même trouvé la force, la dernière nuit du voyage, de déclamer quelques rimes de Gustavo Adolfo Bécquer, le « poète de son cœur comme elle l’appelait. Tout cela malgré la terreur d’un naufrage qui mettait à bout de nerfs son Elidia, si craintive. Pendant toute la traversée, elle n’avait cessé de penser à ce qui s’était produit quelques années plus tôt, quand un vapeur où se trouvaient cinq cents nouvelles recrues des mines de salpêtre avait sombré au large des côtes de Coquimbo. Pour comble de tristesse, tous ces gens enfermés dans les soutes du bateau n’avaient pas été enregistrés à la capitainerie et leur mort avait été catégoriquement démentie par les autorités; néanmoins, certains hommes d’équipage rescapés du naufrage le racontaient en secret dans les tavernes du port. Sa grand-mère maternelle pouvait d’ailleurs apporter sur ce fait un témoignage digne de foi car elle était elle-même allée faire ses adieux a un de ses frères embauché dans le désert et il avait disparu, englouti par la mer.
Assoupi dans son fauteuil de barbier, la porte de son échoppe grande ouverte sur la tiède incandescence de deux heures de l’après-midi, Sixto Pastor Alzamora – visage sanguin et longues moustaches en guidon de vélo – remua pesamment dans son fauteuil en peau de porc et se replongea dans les dunes de sa sieste salpêtreuse. Dans la léthargie de son demi-sommeil il ne savait plus très bien s’il rêvait ou évoquait les images brumeuses de son arrivée sur les côtes du nord, au début de l’année 1907, entassé sur le pont du vapeur Blanca Elena au milieu de cent quarante-neuf nouvelles recrues pour les salpêtrières, tous chargés de famille. Lui s’était embarqué à Coquimbo avec sa femme atteinte de tuberculose et leur fille de sept ans. Et, finalement, au bout de cette pénible traversée, après avoir fait tout le voyage dans la terreur de périr noyée, sa pauvre petite femme était morte du cœur au moment où, entre les lambeaux de la brume, on commençait à distinguer les collines ferrugineuses d’Antofagasta. Quelques heures plus tôt, dans un de ses fiévreux accès de sentimentalisme, Elidia del Rosario lui avait fait jurer sur la Vierge d’Andacollo que, s’il lui arrivait quelque chose, non seulement il devrait s’occuper de sa petite fille et l’aimer toujours mais ne jamais cesser d’encourager son goût pour le piano. « Un jour, elle sera une grande concertiste « , lui avait-elle dit. Il se demandait toujours comment aurait réagi sa lyrique épouse si elle avait assisté à la catastrophe: au matin, son cher piano, mal arrimé sur la chaloupe d’accostage, s’était enfoncé dans les eaux de la baie tumultueuse d’Antofagasta.
Il avait connu Elidia del Rosario à Canela Alta, une petite ville des environs d’Ovalle et ils s’étaient aimés au premier regard. Elle jouait du piano à l’école et il était un maigre garçon coiffeur dans l’unique salon de la ville; un jeune homme intolérant qui, tout en balayant les touffes de cheveux, se lançait dans de ferventes discussions avec les clients les plus sensés du coin, discussions tournant toujours autour de questions de justice ou d’injustice sociale et des abus héréditaires des patrons. Ils s’étaient mariés contre la volonté des parents d’Elidia: ces derniers trouvaient qu’un « coupe-tifs n’était pas un prétendant
digne de leur fille. Leur désaccord ne venait pas tant de son modeste métier que de la réputation d’anarchiste qu’il s’était taillée dans la ville. « Les coiffeurs sont tous des têtes de mules et des renégats « , l’avait prévenue le père d’Elidia. « Pire encore s’ils sont anarchistes « . Pour finir ils s’étaient mariés en cachette un lundi 4 juillet ensoleillé, juste comme elle venait d’avoir vingt et un ans. Lui avait un an de plus. » Dix-sept ans de vaches maigres mais heureuses « , répétait-il à sa fille, les yeux brillants de nostalgie les après-midi venteux où Golondrina, assise au piano, lui demandait de lui parler de sa mère.
Du fait de la fragilité congénitale de sa santé, ils avaient attendu dix ans avant de concevoir un enfant. Et ils n’en avaient pas eu d’autres car elle avait bien failli mourir pendant l’accouchement. Éprise de poésie, elle avait voulu donner ce prénom à la petite fille, en hommage à un poème ailé de Bécquer qu’elle avait coutume de réciter les après-midi de mélancolie. Dès la naissance de la petite, Elidia del Rosario l’endormait tous les soirs en lui récitant des vers glanés dans l’épais volume Les plus beaux poèmes à réciter. Et quand la fillette, belle comme un bouton de rose, commençait à peine à marcher à quatre pattes dans la maison, elle lui permettait déjà – et l’encourageait même avec des rires mouillés de larmes – à se dresser sur la pointe des pieds et à jouer avec les quatre vingt-huit touches du piano. Sa petite Golondrina devait découvrir, disait-elle, non seulement la tonalité et la couleur de chacune des notes de musique mais aussi l’incommensurable présence du bon Dieu ans les passages difficiles les plus subtils de la musique.
Engourdi dans la léthargie de la sieste, le coiffeur se carra dans son fauteuil, lissa ses moustaches et cala le roman de Juanito Zolá sur ses genoux. Dans la salle de musique, de l’autre côté du couloir. en attendant l’arrivée de ses premières élèves pour le cours de déclamation, sa fille Golondrina del Rosario avait commencé ses exercices au piano et la langueur de la musique semblait accompagner à la perfection les épaisses rafales d’évocations nostalgiques, ces images indélébiles des courtes années vécues auprès de sa femme. Comme il l’avait aimée! Il avait senti s’accumuler dans son cœur tout le désespoir du monde après l’avoir fait ensevelir dans une tombe creusée dans la terre du cimetière d’Antofagasta. La dureté du paysage désertique semblait aiguiser sa peine. Inconsolable, il l’avait pleurée deux semaines dans la chambre d’une pension dans le quartier du port, avant de faire entrer sa fille un lundi matin dans un collège religieux. Alors il prépara ses instruments de travail et monta exercer son office dans les salpêtrières. Avec ses moustaches en guidon de vélo, son panama et sa mallette marron à nulle autre pareille, d’abord à cheval puis sur une charrette tirée par deux mules, il se mit à parcourir les déserts du district central. Au début il s’installait dans un endroit plus ou moins fréquenté des campements: au coin d’un cinéma, à la porte du magasin d’alimentation ou devant l’entrée d’une quelconque pension pour ouvriers. Il se procurait des plaques de tôle ondulée pour se protéger de l’inclémence du soleil, demandait un banc dans la maison la plus proche et, après avoir installé ses ustensiles sur le couvercle de sa mallette ouverte, il suspendait un écriteau annonçant ses services et leur prix respectif: coupe de cheveux 5 pesos, barbe 3 pesos.
Peu de temps après, grâce à sa générosité de paysan d’Ovalle, à son idéalisme et à ses paroles enflammées en faveur du prolétariat, il se fit progressivement de grands amis parmi les ouvriers. Dans de nombreux campements les familles mettaient à sa disposition la première pièce de leur maison pour qu’il puisse travailler comme il faut. Il les rétribuait en faisant la barbe du maître de maison, en retaillant la tignasse de sa femme et en tondant toute la ribambelle de leurs gamins pouilleux. Peu de temps après son arrivée dans le désert, sa renommée bien gagnée de maître dans son art s’était propagée et les comités d’ouvriers, les clubs sociaux, les sociétés philharmoniques lui cédaient leurs locaux avec enthousiasme et se disputaient l’exclusivité de ses services. Son grand rêve, en ce temps-là, était d’arriver à s’établir définitivement à Antofagasta,
d’installer son échoppe dans une de ses rues florissantes et de donner la meilleure éducation possible à sa fille. C’étaient ses seules ambitions dans la vie. Voilà pourquoi il parcourait jour après jour, sans exception aucune, les chemins poussiéreux du désert.
Une fois par mois, d’une quelconque compagnie enclavée le long de la voie ferrée, il montait dans le dernier wagon du train pour descendre passer la fin de la semaine au port. Le matin, vêtu d’un costume sombre, les moustaches retroussées et un bouquet d’arums à la main (les fleurs préférées d’Elidia) il allait au cimetière pleurer sa solitude de veuf inconsolable et converser longuement avec le souvenir vivant de sa femme. Malgré le temps, l’image séraphique de son Elidia del Rosario Montoya demeurait intacte dans le miroir de sa mémoire. L’après-midi, l’immuable boîte de friandises sous le bras, il allait rendre visite à sa fille au Collège de jeunes filles des Sœurs françaises. Après quelques mois de travail inlassable, il avait réuni l’argent nécessaire pour tenir la promesse faite à Golondrina del Rosario le jour même de l’enterrement de sa mère. Dans une salle des ventes de la rue Bolivar, il acheta un grand piano à queue français, un Erad, et le lui fit expédier au collège, orné d’une grosse rose de Cellophane. Dès lors, la petite fille, que les nonnes appelaient « sœur Golondrina », à cause de son comportement exemplaire et de son goût pour la prière, était devenue le clou de toutes les activités culturelles et sociales du pensionnat car elle avait non seulement un talent naturel pour la musique mais déclamait les vers avec la passion d’une poétesse expérimentée.
Dans la torpeur de la sieste, alors qu’il se sentait comme bercé par les notes languissantes du piano – il ne savait plus si elles venaient de très loin ou résonnaient dans l’acoustique de son propre crâne – le coiffeur entrevit fugitivement que les mélodies jouées par sa fille au piano étaient devenues, depuis un certain temps, d’une tristesse chronique. Un soupir le fit changer de position dans son fauteuil. Sa fille était si différente des autres. Si délicate dans ses manières. Par moments il était assailli par des remords de classe pour avoir poussé Golondrina à étudier le piano après l’avoir mise dans un collège religieux et non dans une école publique comme il convenait à la fille d’un prolétaire bien né. Mais il avait toujours pensé que, comme le violon était l’instrument des aveugles, l’accordéon celui des gitans et la guitare celui des voyous, le piano était l’instrument aristocratique par excellence. Il finissait par accepter le fait à contrecœur en brandissant l’argument facile selon lequel l’art, plus qu’un luxe des gens de la haute était une nécessité spirituelle pour tout être humain mais il ne parvenait pas à se convaincre tout à fait. C’était un idéaliste impénitent. En cela, il ressemblait sans doute à Juan Pérez, le héros prolétaire du « roman socialiste » posé sur ses genoux qu’il avait fait tomber lourdement par terre en remuant dans son fauteuil pour chasser une mouche de ses moustaches.
Le coiffeur ouvrit à peine un œil et se pencha pour ramasser le volume. En vérité, le personnage de l’ouvrier Juan Pérez était comme lui: les injustices sociales l’accablaient, il en avait l’âme toute meurtrie. Le livre – il l’installa de nouveau sur ses genoux – avait été interdit en son temps et brûlé par les autorités à cause de sa sévère critique du clergé et de l’industrie du salpêtre. « C’est un des rares exemplaires sauvés de l’Inquisition « , répétait-il toujours en le brandissant fièrement devant les clients. Le roman au titre audacieux Tarapacá, roman socialiste avait été publié à Iquique en 1904 sous le pseudonyme de Juanito Zolá et était, à sa connaissance, la première oeuvre se déroulant dans le désert. On y racontait les innombrables actes arbitraires dont les travailleurs étaient victimes au début du siècle et qui continuaient d’être commis maintenant, en pleine année 1929. Actes arbitraires dont il avait lui-même été témoin dans ses tournées difficiles à travers les campements salpêtriers, citadelles où régnait une nouvelle forme de féodalité aux lois créées et imposées d’une main de fer par les propriétaires étrangers eux-mêmes, en tenue de safari. Tout cela, bien sûr, avec l’accord coupable des autorités gouvernementales, particulièrement celles de ce dernier régime de merde.
Le coiffeur donna une tape en l’air. Dans son engourdissement, il se rappela la nouvelle apprise le matin même à propos du dictateur; plus que la mouche, c ‘était sans doute la raison qui l’empêchait de faire sa sieste en paix, se dit-il.
Tôt le matin, alors qu’il faisait la barbe au propriétaire des pompes funèbres, lequel ne cessait de se plaindre de la crise du salpêtre, au moment où il commentait l’impudence de certains cochons de capitalistes – ils fabriquaient de nouvelles cigarettes appelées Tue la Crise, mettant a profit les calamités publiques elles-mêmes pour faire de l’argent -, un vieux était entré pour lui montrer un exemplaire fraîchement publié de La Voix du désert. Il y avait un article où on recherchait des musiciens pour former une fanfare.
– Ça confirme la rumeur, dit le vieux.
– Quelle rumeur ? demanda le propriétaire des pompes funèbres.
– Le flic Ibáñez vient dans notre ville et les huiles veulent le recevoir avec fanfare et tout! grogna-t-il.
Quand, sous la serviette, le propriétaire de l’entreprise de pompes funèbres prétendit que les choses allaient peut-être s’améliorer un peu dans le désert avec la venue du président, il lui demanda pourquoi il n’avait pas la bonté d’aller manger une de ses viandes froides avec un couteau et une fourchette. Puis il se mit à vider son sac à propos de ce cacique de pacotille, cette merde dont l’unique préoccupation était de chasser les malheureux pédés pour les envoyer au fond de la mer. Mais ça, ce n’était rien; noyer ces pauvres types était déjà d’une cruauté extrême mais noyer les syndicalistes en les faisant passer pour des tantouses était le comble de la perversité humaine. On avait appris dernièrement qu’un bateau de la flotte avait levé l’ancre pour la haute mer bourré de dirigeants de l’opposition sous prétexte qu’il s’agissait d’invertis et était revenu vide. Et, au cas où il l’ignorerait, dit-il maintenant rouge de colère, pour compléter le tableau de cette grotesque comédie de malentendus dans laquelle le pays était plongé le ministre des Finances du flic Ibáñez était un homosexuel camouflé qui profitait du pouvoir de son poste politique pour se procurer des éphèbes de haut lignage, tout le monde était au courant dans la capitale. Mais le plus triste, c’était que parmi les derniers dirigeants envoyés par le fond, la majorité appartenait au Mouvement Ouvrier du Salpêtre, on le savait maintenant. Et ce cochon de despote avait l’impudence de venir se pointer sous le nez des travailleurs du désert!
-300x460.jpg)


-100x150.jpg)
-100x150.jpg)