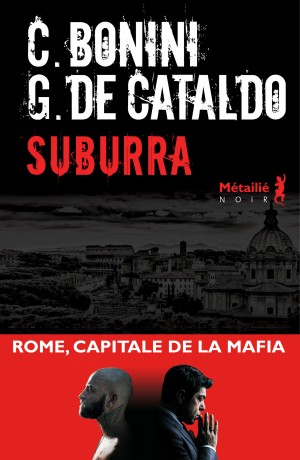Samouraï, ex-leader fasciste devenu gangster, est sur le point de réaliser le couronnement de sa carrière criminelle : piloter en sous-main un gigantesque projet immobilier prévoyant la bétonisation du territoire, du bord de mer jusqu’à la capitale. Pour cela, il lui faut maintenir à tout prix la paix entre les différentes mafias qu’il fédère : Calabrais, Napolitains, Gitans… Il s’appuie aussi sur les réseaux de Malgradi, politicien priapique et véreux. Mais une nuit de débauche tourne mal et la pagaille et les règlements de comptes s’installent.
Samouraï voit se dresser contre lui un ex-disciple, Marco Malatesta, désormais à la tête d’une unité d’élite de carabiniers. À ses côtés Michelangelo, procureur pianiste de jazz, et trois femmes, Alba, collègue et ex-petite amie, Alice, son nouvel amour, blogueuse altermondialiste, et Sabrina, ex-pute, incarnation du bon sens populaire au pays de la gauche caviar médiatique.
Des salons chics aux gigantesques night-clubs de la périphérie où l’on mange, se drogue, tue et se prostitue avec une monstrueuse vitalité, De Cataldo et Bonini racontent les coulisses criminelles de Rome.
Dans ce récit dont l’actualité a mis en évidence la véracité documentaire jusque dans les moindres détails, De Cataldo démontre une fois encore qu’il a su tirer le meilleur parti des influences qu’il revendique, de Balzac à Ellroy en passant par Tarantino.
Ce roman a été adapté au cinéma par Stefano Sollima (Gomorra et Romanzo Criminale tv).
-
“Suburra” est un quartier de Rome où la mafia a pris ses aises. Toute la ville semble dirigée en sous-main par une clique de bandits, politiciens véreux, carabiniers corrompus et clergé affairiste. Parmi eux, on croise notamment Samouraï, gangster charismatique qui tente de mener à bien un énorme projet de spéculation immobilière entre le port d’Ostie et la capitale.
Face à lui se dresse son ancien disciple Marco Malatesta, carabinier d’élite, et qui connaît bien ses méthodes criminelles.
A travers le duel entre ces deux hommes c’est un portrait saisissant de Rome qui apparaît, une ville où débauche et violence deviennent la norme. Car les évènements décrits ici correspondent à une réalité, Bonini et De Cataldo apportant avec ce roman une suite au fameux “Romanzo Criminale”, cette fois au moment de la chute du régime berlusconien. Ils montrent combien le banditisme a su s’adapter et prendre possession de Rome aujourd’hui, au point de rendre quasiment inextricables les liens entre pouvoirs mafieux et institutionnels. Un livre monstrueusement vivant et glaçant.
-
Après les excellents Romanzo Criminale et La saison des massacres (suivis de trois ou quatre opus que je n’ai pas lus) le magistrat Giancarlo de Cataldo –ici accompagné du journaliste d’investigation Carlo Bonini- poursuit son exploration des plus noirs versants de la société italienne contemporaine.
La lecture du roman – 470 pages avalées en un lundi pluvieux, autant dire que la lecture vous happe- laisse une drôle d’impression et l’envie d’en savoir davantage. Qu’est-ce qui est vrai, qu’est ce qui relève de la fiction ? Dans cette interview, De Cataldo nous donne quelques clés.
Après un rapide prélude qui nous raconte un casse des années 90, l’histoire débute dans la chambre d’un palace romain, où l’ambiance est clairement au bunga bunga. Car nous voici à la toute fin de l’ère berluscolienne, un moment où comme dit l’autre, « il faut que tout change pour que rien ne change ». Dans la Rome pervertie décrite par les auteurs, la collusion entre mafia, milieux politiques, affairistes et cléricaux semble totale. Tous cherchent à s’entendre afin de réaliser le gigantesque projet immobilier (bétonnage d’ une côte des environs de la capitale) qui va les rendre richissimes.
Face à cette puissance politique, criminelle et financière, Le lieutenant-colonel Marco Malatesta apparaît bien seul . Aidé d’un procureur intègre et d’Alice, une militante altermondialiste pour laquelle il ressent une certaine inclinaison, il entreprend de lutter contre l’hydre mafieuse et en particulier contre la tête pensante du projet, le Samouraï , personnage charismatique passé du néo fascisme au banditisme pur et simple, dont il fut autrefois le disciple. Un polar politique aussi addictif qu’il est effrayant.
Yves Martin -
Alexandre
-
Christophe Ono-dit-Biot annonce "Suburra" dans le Palmarès des 25 meilleurs livres du Point. Regarder la vidéo ici.
-
"C'est une fresque peinte avec du sang, c'est une tragédie vraie, c'est Dante tombé dans le XXIe siècle." Lire l'article ici. Relayé sur le site de Livres Hebdo ici
Dans le palmarès des 25 livres de l'année - Julie MalaureLe Point -
"Suburra est le manuel indispensable à la compréhension du réel." Lire l'article ici
Lionel GermainSud-ouest dimanche -
"Des personnages nombreux et bien dessinés, des scènes d'anthologie et une réflexion intéressante sur la politique et la citoyenneté, malgré un cynisme glaçant, puisqu'à la fin, on en prend d'autres et on recommence." Lire l'article ici
Fred RobertZibeline -
"Une sorte de valorisation sociale du crime s'est opérée. Il est désormais perçu comme un parcours de réussite." Lire l'entretien ici
Julie MalaureLe Point -
"Parmi les auteurs qui ont le mieux raconté [Rome], la plupart étaient des provinciaux: Catulle venait de Vérone, Virgile de Mantoue, Juvénal d’Espagne, Pasolini du Frioul, Cassola de Turin. A part Belli et Moravia, tous venaient d’ailleurs." Lire l'entretien ici
Entretien d'Anna LiettiL'Hebdo (Suisse) -
"Cataldo et Bonmi excellent dans les dialogues, brossent des portraits denses et formidablement vivants. Et démythifient la Mafia." Lire l'article ici
Michel AbescatTélérama -
"Quel est le point commun entre l'Islandais Arnaldur Indridason, le Français Caryl Férey et l'Italien Giancarlo de Cataldo ? D'être des auteurs de polars, bien sûr, mais aussi et surtout d'éternels supporters." Lire l'article ici
Site Metronews -
"La Ville éternelle est gangrenée par trois pouvoirs -.politique, religieux et... mafieux. Un juge, Giancarlo De Cataldo, écrit des polars pour révéler le monde souterrain de cette trinité criminelle. Où fiction et réalité narrent l'histoire de Rome..." Lire le dossier ici
Dossier d'ouverture par Alain LéauthierMarianne Hors-série -
«Nous nous demandons pourquoi le pouvoir est si pervers, nous lançons des cris d'alarme sur la crise de la démocratie. Et nous le faisons à notre façon, en racontant aussi les méchants.» Lire l'article ici
François ForestierL'Obs -
Ecouter l'émission ici
Entretien de Michel Abescat et Christine FerniotTélérama "Le Cercle polar" -
Ecouter l'entretien ici
Entretien de François AngelierFrance Culture "Mauvais genres" -
"Magistrat à la cour d’appel de Rome, gentleman francophile, Giancarlo De Cataldo est également l’un des meilleurs auteurs de noir à l’italienne." Lire la chronique ici
Pamela PianezzaTess Magazine -
"Monseigneur homosexuel, député de droite priapique et cocaïnomane peuplent le tableau de cette «Roma» quasi fellinienne." Lire l'article ici
Christophe ForcariLibération -
"Pas un chapitre sans qu'un nouveau personnage ne rejoigne cette valse réaliste et palpitante, dessinant un portrait au vitriol de la capitale italienne." Lire l'article ici
Pierre-Edouard PeillonLa List -
Ecouter l'entretien ici
Entretien de Kathleen EvinFrance Inter "L'Humeur vagabonde" -
"Les deux auteurs du roman sont tellement bien documentés que nous ne pouvons qu'être horrifiés ; le contrôle de Rome par le grand banditisme serait une catastrophe non seulement pour l'Italie mais aussi pour toute la planète." Lire l'article ici
François JolyL'Essor du Rhône - L'Essor de la Loire -
"Le plaisir du polar, à l'état pur." Lire l'article ici
François ForestierL'Obs -
"Suburra contient des éléments de polar mais c'est surtout une comédie humaine : je suis un indigne disciple de Balzac. J'aime les personnages qui se croisent, meurent et ressuscitent, j'ai la même boulimie littéraire." Lire l'entretien ici
Entretien de Sophie JoubertL'Humanité -
"Fresque survoltée d’une Rome décadente, Suburra vous embarque dans l’arrière cour sans foi ni loi de la Ville Éternelle, une jungle régie par un système infernal avide de sang, où des gamins sans cervelle se la font exploser, petits soldats d’une guerre sans fin." Lire l'article ici
Geneviève CombyLe Matin Dimanche -
"Un roman noir passionnant puisé aux sources sulfureuses de la réalité italienne." Lire l'article ici
Portrait de François LestavelParis Match -
"Une sidérante plongée dans l'univers criminel actuel de la capitale italienne." Lire l'article ici
Philippe BlanchetLe Figaro Magazine -
Julie MalaureLe Point
-
"Quand on a écrit que Rome puait la Mafia, on nous a dit qu’on exagérait. Et puis quand l’enquête de la justice a été révélée, on nous a dit qu’on aurait pu aller beaucoup plus loin…" Lire l'entretien ici
Entretien avec Philippe LemaireOnlalu -
"Si, dans un pays comme le nôtre, des enquêtes sur la corruption et sur toutes sortes d’actes illégaux se font jour, qu’elles commencent à ouvrir une brèche, alors ça veut dire que le pays est sain, qu’il est en train de réagir." Lire l'entretien ici
Entretien avec William IrigoyenLa Cité -
"On y assassine un ex-allié ou un rival comme on souffle une bougie, les usuriers prospèrent, des politiciens calculent et se couchent... Quelques courageux s'efforcent de lutter contre cette marée puante... Un polar haletant, tendu, aux personnages et aux dialogues forts." Lire l'article ici
J. B.L'Alsace -
"Un juge, un journaliste, deux Italiens qui prennent un malin plaisir à ne pas jouer les enfants de chœur et explorent les labyrinthes de Rome, la cité soi-disant éternelle, aussi imprévisible et menteuse que l'enfer." Lire l'article ici
Martine LavalLe Matricule des anges -
"Les deux auteurs font preuve d’un talent narratif et littéraire tel que Suburra s’avère un page turner redoutable." Lire l'article ici
Marc FernandezMetronews -
"Suburra est aussi ambitieux que l'était Romanzo criminale. Il y a dans ce livre de la politique, du rythme et du nerf, des psychopathes et des personnages madrés et, surtout, une grande intelligence." Lire l'article et l'entretien.
Entretien avec Macha SéryLe Monde des livres -
"Le vrai problème en Italie, et c'est un fait historique, quand tu as en face un juge, un carabinier, ou un membre du pouvoir officiel, tu dois non seulement t'assurer de lutter contre l'ennemi que tu vois, mais aussi te défendre contre la main qui est sur ton épaule, et qui dit être ton ami." Lire l'entretien ici
Entretien avec Benoît LegembleTransfuge -
La mafia au cinéma, par Giancarlo de Cataldo, à l'occasion de la sortie de Suburra : voir l'entretien ici
 © Pamela PianezzaEntretien avec Pamela PianezzaCiné + "Viva Cinéma"
© Pamela PianezzaEntretien avec Pamela PianezzaCiné + "Viva Cinéma" -
"Le Suburra coécrit par l'auteur de Romanzo criminale et le journaliste d'investigation à La Repubblica cherche à distiller, par le truchement d'un roman choral, une science de la tectonique des plaques mafieuses à Rome." Lire l'article ici
Pierre-Edouard PeillonLe Magazine littéraire
prologue
Rome, juillet 1993
Dans l’obscurité humide de la nuit d’été, trois hommes attendaient à bord d’un fourgon de carabiniers Fiat Ducato, garé sur le quai du Tibre. Ils portaient des uniformes mais c’étaient des criminels. Dans la Rome interlope, on les connaissait sous les noms de Botola, Lothar et Mandrake. Botola descendit du fourgon et fit face au fleuve. Il tira de sa poche un biscuit Gentilini effrité et le posa sur le parapet. Reculant de quelques pas, il se plongea dans la contemplation d’une mouette qui piquait du bec les restes du sablé.
– C’est beau, les mouettes.
Il remonta dans le fourgon. Celui qu’on appelait Lothar alluma sa énième cigarette et souffla bruyamment.
– J’en ai plein le cul. Qu’est-ce qu’on attend ?
– Je te suis ! dit avec conviction Mandrake.
Botola secoua la tête, inflexible.
– Samouraï a dit à deux heures précises. Pas une minute avant, pas une minute après. Ce n’est pas encore le moment.
Les autres protestèrent. Mais de quoi on parle ? Dix minutes d’avance, qu’est-ce que c’est ? Et puis, dans la rue, jusqu’à preuve du contraire, c’est eux qui y étaient, pas Samouraï. Alors, quoi, Samouraï, il avait les yeux partout, peut-être ? C’était qui, le bon Dieu, pour pouvoir les contrôler à chaque instant ?
– Le bon Dieu, peut-être pas, concéda Botola, avec un soupir. Mais si tu me parles du diable, t’en es pas loin.
– Ouais, c’est ça, le diable ! ironisa Mandrake. C’est un homme comme nous : Samouraï par-ci, Samouraï par-là… Moi, si j’devais te dire, je l’ai jamais vu se salir les mains, c’te Samouraï… Pour parler, ça, il sait parler, y a rien à redire… mais c’est facile, quand le risque c’est les autres qui le courent.
Botola les toisa, avec un demi-sourire de commisération. Ils ne se rendaient vraiment pas compte, les pauvres couillons !
– Vous vous le rappelez, Gnon ?
À Lothar et Mandrake, ce nom ne disait rien.
Botola raconta une histoire.
Il y a ce boxeur du Mandrione, il s’appelle Sauro, dit Gnon à cause de son gauche de la mort. Une bête, aussi fort des bras que faiblard du ciboulot, pauvre Gnon. S’il avait été juste un peu plus malin, il se serait pas collé avec Samouraï dans une histoire de drogue. Oui, parce qu’à un certain moment, après une affaire de rencontres truquées, la Fédération lui retire sa licence, et Gnon se met à vendre un peu de produit pour le compte de Samouraï. L’ennui, c’est que Gnon se croit très malin. D’abord, il commence par se sucrer au passage, puis, quand il se sent plus sûr, il choure une grosse livraison, la vend pour sa poire et disparaît. Il reste caché trois, quatre mois et un beau jour reparaît. Avec le fric piqué à Samouraï, il s’est acheté une salle de sport, a recruté quatre loubards de banlieue et s’est mis à dealer à son compte. Samouraï essaie de le récupérer en douceur et va le voir à la salle. Il lui propose un accord raisonnable : cinquante pour cent de la propriété du club et de tout le réseau en échange de la paix. Gnon ne veut rien entendre. Il appelle ses loubards et attaque tête baissée. À cinq contre un, Samouraï se défend comme il peut, mais à la fin il en prend plein la tête. Ils le balancent dans une impasse à moitié mort et il lui faut pas mal de temps pour se remettre. Un soir, à la salle, se présente un type jamais vu jusque-là. Il s’inscrit, commence à soulever des poids, bavasse un peu avec les loubards du chef. Quand c’est l’heure de fermeture, et que Gnon est resté seul avec ses fidèles sous-fifres, le type jamais vu sort d’abord un pistolet-mitrailleur Skorpion, comme ceux qu’utilisent les terroristes, et les colle au mur. Cinq minutes passent. Gnon et les siens essaient de toutes les manières de faire parler le type, qui reste muet comme une carpe. Enfin, la porte s’ouvre et il entre. Samouraï. Sous le pardessus, il porte un kimono et il a entre les mains un katana, l’épée très effilée des Japonais. Il marche droit sur Gnon et lui tient un petit discours : l’argent, il pouvait encore passer dessus, mais l’humiliation, non. Alors, mon cher Gnon, lui dit-il, toi, maintenant, avec cette épée, tu t’ouvres le ventre et moi je te regarderai mourir. En échange, je ne toucherai pas un cheveu à tes gars. Gnon se met à geindre. Il demande pardon. Il reconnaît son erreur. Il lui abandonnera la salle, tout le produit qui lui reste, les contacts du réseau. Samouraï pousse un soupir, lève l’épée et, d’un seul coup, coupe la tête à l’un des gars. Gnon éclate en sanglots. Les gars éclatent en sanglots. L’un d’eux s’avance et s’offre à Samouraï comme exécuteur de la sentence. Samouraï le dévisage et le décapite. Tu vois, Gnon, tu ne sais pas choisir tes hommes, soupire-t-il, ils ne te sont pas fidèles… À ce moment, tous les trois, Gnon et les deux survivants, tentent une attaque désespérée.
– Et qu’est-ce que je vous disais ? conclut Botola, Samouraï les découpe en morceaux. L’ami ne tire même pas une balle. Puis ils ont mis les restes dans des sacs et les ont jetés dans le Tibre.
Lothar et Mandrake fixaient le narrateur, déconcertés.
– J’ai bien l’impression que c’est des conneries, hasarda Mandrake.
– C’est l’heure, coupa Botola. Bougeons-nous.
Ils rejoignirent la place Clodio. Les phares du Ducato clignotèrent trois fois en direction de la porte du garage du Palais de Justice, laquelle, au bout de quelques secondes, commença à s’ouvrir lentement. Le militaire de la guérite s’avança sans hâte du côté du chauffeur. Il reconnut Botola et, d’un signe de la main, invita le fourgon à poursuivre sa route. En roulant au pas, ils remontèrent la rampe de béton armé conduisant au parking du bâtiment c, où un système de portes blindées protégeait la chambre forte de la succursale 91 de la Banca di Roma.
L’agence interne du tribunal.
La salle blindée qui abritait les richesses et les secrets des magistrats, des avocats, des notaires, des flics.
Le double fond de ce qu’on appelle la Justice et qui n’est que le Pouvoir.
Botola tira de la poche de la portière la liste des neuf cents coffres de la banque. Samouraï en avait entouré cent quatre-vingt-dix-sept d’un cercle. Ceux-là seulement devaient être ouverts. Lothar prit deux sacs de jute. Mandrake inspecta le sac à outils et l’anneau de cinquante clés dont à Rome il n’y avait qu’un seul propriétaire : lui-même. Tous trois enfilèrent des gants de cuir collants.
Les carabiniers qui les attendaient avaient fait leur devoir. Les portes blindées qui donnaient sur la chambre forte étaient ouvertes, les alarmes et le système vidéo en circuit fermé désactivés. Botola croisa le regard des militaires avec une grimace de mépris. Ces deux-là puaient la peur et le déshonneur. L’odeur des flics quand ils sont ripoux. Et il renvoya le plus jeune d’une pichenette sur la joue.
Ils connaissaient le caveau par cœur. Ces derniers mois, Botola, Lothar et Mandrake y étaient descendus au moins une dizaine de fois, accompagnés par un des caissiers de l’agence. Un quinquagénaire avec un penchant pour la coke et les femmes. Il s’était mis à leur disposition comme un petit chien, indiquant le nom du propriétaire de chaque coffre, ce qui avait permis à Samouraï de faire le tri. Il avait fourni des plans et tenu à jour la liste des accès. Il avait rendu possible la prise d’empreinte des clés qui ouvraient les portails internes au cœur de cette banque. Au fond, il ne restait plus que la partie la plus simple. Mettre la main sur toutes ces richesses.
– Maintenant, je m’enlève cet uniforme, hasarda Mandrake. Je me sens vraiment pas dans la peau d’un condé.
– À qui le dis-tu, collègue ! se solidarisa Lothar.
Botola donna son autorisation. Pourvu qu’ils se dépêchent : la chance ne pouvait pas être avec eux pour l’éternité, et même les plans les mieux conçus échouent parfois contre les bizarreries du destin.
Ils décidèrent de travailler dans l’obscurité. Avec deux grosses torches de plongée pour seul éclairage. Mandrake fonça. Comme il savait et devait faire. Et les cent soixante-quatorze premiers coffres s’ouvrirent comme des boîtes de chocolat.
Dans un sac de jute finirent le liquide, dix milliards de lires, ainsi qu’une montagne de bijoux et de montres.
Lothar les raflait avec une volupté grossière. En tirant et rentrant la langue, comme en proie à une irrépressible jouissance sexuelle.
Botola se consacra au reste. Parce que, dans ces coffres, il y avait quelque chose qui valait plus que les liasses gansées de billets de cinquante et cent mille lires. Il découvrit avec une relative surprise qu’un proc’ à la narine enfarinée conservait là quelques hectogrammes en réserve, entre la montre du grand-père et le rang de perles de l’épouse. Un rayon de lumière éclaira les extraits de comptes des banques suisses vers lesquelles avocats, juges, officiers de carabinier, policiers, agents de la brigade financière avaient dirigé le fric qui avait permis à la bande de les acheter depuis des années.
Samouraï avait raison. Là-dedans, il n’y avait pas une Épiphanie. Il y avait le nouveau Noël de Rome.
Dans le dernier coffre, il trouva un pistolet.
Botola n’avait jamais rien vu de pareil. Bien sûr, il avait acquis une certaine pratique lui aussi, après tant d’années dans la rue. Mais ce pistolet… Un engin d’un autre temps : long, avec une inscription incompréhensible, ça ressemblait à de l’allemand. Il contrôla la liste, pensant à une erreur. Il n’y avait pas d’erreur. Samouraï, il l’avait encerclé carrément deux fois, ce coffre. Mais qu’est-ce qu’il pouvait en faire, un type comme lui, de cette vieillerie ? En tout cas, il attrapa l’arme et deux boîtes de munitions et fourra le tout dans le sac.
Quatre heures du matin. Mandrake se répandait en jurons contre deux serrures qui opposaient une résistance inattendue.
– Suffit, les gars, il se fait tard.
Ils revinrent au fourgon, tandis que les carabiniers refermaient dans leurs dos grilles et portes blindées. Le Ducato manœuvra et redescendit au pas vers la porte coulissante, en suivant la rampe par laquelle il était monté. Le portail s’ouvrit de nouveau. Botola se pencha par-dessus la glace vers le carabinier de la guérite.
– Ç’a été un plaisir, tas de merde.
Les rires gras de Lothar et de Mandrake couvrirent le vrombissement du passage en première.
Ils conduisirent le Ducato dans le bosquet de Monte Antenne, où ils avaient auparavant dissimulé la Saab non repérée de Botola. Ils débarquèrent les sacs et les enterrèrent avec les uniformes. Lothar et Mandrake arrosèrent le fourgon d’essence.
– Donne-moi du feu, Botola ! plaisanta Lothar.
Le projectile le cueillit entre les yeux. Il tomba sans un gémissement.
Au bruit, Mandrake se retourna. Horrifié, il fixa Botola, le 7.65 dans la main gauche, canon encore fumant.
– Mais qu’est-ce que…
– Tu sais, ce type de la salle de sport, celui qui était avec Samouraï ? C’était moi, Mandrake, dit Botola, et il lui tira aussi dessus.
Le soleil était déjà haut quand Botola rentra dans sa grande maison au Panthéon. Lothar et Mandrake étaient des bouts de chairs brûlées entre les tôles. Il était un peu désolé pour eux, mais les ordres de Samouraï ne se discutaient pas. Le butin était en sûreté, en attendant que se calme la prévisible tempête. Botola enfonça dans la glace deux bouteilles de champagne millésimé et se mit à la fenêtre face à la place ensommeillée. À une époque, cette maison avait appartenu au Dandy. Le dernier chef de la bande avait été abattu quelques années plus tôt de la main de quelques collègues : des balles de salopes, selon certains. Un acte de justice qui avait libéré la terre du pire rapace, selon le plus grand nombre. Botola n’avait pas d’opinion là-dessus. Il considérait la sortie de scène du Dandy, auquel il avait été aussi profondément lié, comme un événement à mi-chemin entre un accident et une nécessité. Si le Dandy ne s’était pas monté la tête, il serait resté encore un bon moment le numéro un. Mais s’il ne s’était pas monté la tête, il n’aurait pas été le Dandy. Et donc…
Pendant un moment, Patrizia, la veuve du Dandy, s’était installée dans ces trois cents mètres carrés avec terrasse qui dominaient le centre de la capitale. Puis Patrizia s’était mise avec un flic, et ça s’était mal terminé pour elle. Botola, une fois purgée une peine acceptable, s’était tout acheté, mobilier compris, pour un morceau de pain. Et c’était de là, de ce lieu qui autrefois leur avait rappelé qui ils étaient, d’où ils venaient et où ils étaient arrivés, c’était de là qu’il fallait repartir.
Comme autrefois. Mieux qu’autrefois.
Samouraï daigna apparaître vers midi. Très grand, il portait une chemise coréenne sans la moindre auréole de sueur, des lunettes noires, un jean moulant. Il s’annonça avec une espèce de grimace exténuée, dédaigna le champagne, hocha à peine la tête quand Botola commença à chanter le haut fait du caveau.
– Je sais que ça s’est passé comme il fallait. On en a parlé à la radio.
Botola le prit mal. Bon, d’accord, Samouraï était un type peu causant, disons même qu’il était du genre muet, alors, je demande pas un peu d’enthousiasme, mais au moins un peu de satisfaction, merde !
– Tu as amené ce que je t’avais demandé ?
Botola, mécontent, lui tendit le pistolet et les cartouches.
Samouraï saisit le tout avec la dévotion qu’on réserve à une relique, retira ses Ray-Ban, caressa l’arme avec un regard attendri, et enfin sourit.
– Qu’esse y peut bien avoir de spécial ce flingue, marmonna Botola.
Ils avaient mis la main sur un trésor et lui se fixait sur un pistolet qui devait avoir plus de cent ans.
– Tu ne comprendrais pas, rétorqua sèchement Samouraï.
Botola n’insista pas. Depuis vingt ans il était dans la rue, et s’il y avait quelque chose qu’il avait compris, c’était qu’il ne devait jamais se mettre entre un homme et ses manies. Si Samouraï s’excitait avec ça, c’était son affaire.
Samouraï empocha l’arme et les cartouches, puis s’attarda sur le petit tableau au-dessus d’un long canapé blanc.
– Un truc du Dandy, s’empressa d’expliquer Botola. Il l’a payé cent millions à une vente aux enchères.
– C’est une copie, murmura Samouraï.
– Putain, qu’esse tu racontes ? Y a même la signature ! Regarde, De Chierico.
– De Chirico.
– Eh beh ? Chais pas si tu te souviens, mais Dandy, c’était pas le genre à se faire baiser par un faussaire.
– Je n’ai pas dit que c’était un faux. J’ai dit une copie. C’est très différent. L’artiste peint un original, puis il met en circulation d’autres exemplaires de la même peinture, ou bien il autorise un autre peintre à faire la même chose… En tout cas, ça vaut pas grand-chose.
– Bon, ben, si tu le dis. Toute façon, moi, ces deux gogols qui s’embrassent m’ont jamais convaincu.
– Hector et Andromaque, précisa Samouraï.
Botola en avait assez. Bon, d’accord, Samouraï déconnait mais qu’est-ce qu’il trafiquait dans sa tête ? Bah. Peut-être que c’était seulement l’adrénaline qui lui jouait un mauvais tour. Botola gagna la cuisine, déboucha le champagne opportunément glacé, ne s’en versa que pour lui vu que l’autre était si tordu et revint au salon, décidé à éviter une nouvelle perte de temps.
Samouraï s’était installé au milieu du canapé et jouait avec le pistolet et les cartouches.
– Samouraï, si ça t’embête pas, il me semble qu’on devrait parler de nos projets.
D’un geste vague, Samouraï l’invita à poursuivre.
Botola s’empara d’une chaise mocharde (autre investissement du regretté Dandy, d’un inconfort mortel) et se plaça face à lui.
– Alors, moi je dis qu’on a une seule route à suivre.
– À savoir ?
– On se reprend Rome.
– Ah oui ? Continue.
– On a le fric, du fric bien frais, bien propre, et beaucoup. C’est-à-dire qu’il est propre pour nous parce qu’il est sale pour eux, je sais pas si tu me suis.
– Parfaitement.
– Bien. On a les papiers. Qui nous disent où finissent les sous que tous ces braves serviteurs de l’État se sont fauchés pendant ces dernières années. Pratiquement, on les tient par les couilles. Ce qui nous rend intouchables et donc…
– Donc ?
– Donc, si tu marches, nous deux, toi et moi, à partir de maintenant on est Jules César et Octave Auguste.
Botola rit, content de sa blague qui le ramenait à l’époque du Libanais, le fondateur de la bande. Un type qui, à propos de manie, avait celle de la Rome antique. Et peut-être qu’il n’avait pas tous les torts.
– Alors ? Qu’est-ce que tu en dis, hein, Samoura’ ? Ça peut se faire ?
Samouraï hocha la tête et se mit à charger le pistolet. Tandis qu’il introduisait la lame-chargeur dans l’ouverture sur l’arrière du canon, il soulignait les passages marquants à un Botola effaré.
– Ceci est un Mannlicher, fabriqué en 1901 en Autriche. À la différence des pistolets semi-automatiques normaux, le fonctionnement n’opère pas grâce au recul de l’obturateur, mais à cause du déplacement vers l’avant du canon. L’obturateur est, comme on dit, solidaire du châssis : comme tu vois, les cartouches s’insèrent par en haut, et non par le bas. L’arme fut adoptée par l’armée autrichienne, qui s’en servit durant la Première Guerre mondiale. Par la suite, tombée en désuétude, elle a connu une nouvelle fortune en Argentine. Et de fait, ces cartouches que tu vois sont des Borghi, fabriquées à Buenos Aires en 1947. Au moment du tir, le canon, en partie contenu par un guidon cylindrique, avance, tiré par la friction du projectile et, comprimant un ressort de récupération approprié, expulse la balle.
Samouraï poussa un profond soupir, pointa le Mannlicher sur le front de Botola et fit feu.
Durant le reste de l’été, Samouraï se mit en hibernation.
Piqués au vif par la clameur que soulevait ce coup magistral, les hommes en uniforme acheminèrent à Rome les meilleurs enquêteurs. La taupe fut chopée presque aussitôt et balança les carabiniers, qui à leur tour balancèrent Lothar, Mandrake et Botola : traîtres un jour, traîtres toujours. Samouraï l’avait prévu. Donc il avait dû, quoiqu’à contrecœur, supprimer trois braves garçons qui savaient se tenir. Pour couper le fil. Et ainsi, vers la mi-septembre, alors que les condés se décarcassaient inutilement pour donner un visage au cerveau du braquage, il récupéra le butin et se présenta ponctuellement à la réunion mensuelle au Bateleur.
Officiellement appelé “cercle récréatif”, le Bateleur était ce qui ressemblait le plus à un centre social[1] que l’extrême droite romaine ait réussi à concevoir. Mais si le modèle organisationnel était copié sur la gauche, le dispositif scénographique, des fanions à faisceaux de licteur aux fresques avec Gandalf et Frodon, des cendriers à croix gammée aux matraques à cœur de fer qu’on vendait en sous-main sur des étals improvisés, était sans équivoque fasciste. Comme étaient fascistes les âmes des jeunes gens qui, d’abord à la dérobée puis toujours plus nombreux, venaient se serrer sur les bancs boiteux du sous-sol de Montesacro, impatients d’écouter, dans un silence religieux, le verbe de leur chef spirituel.
Ce soir-là, ils étaient une bonne quarantaine, presque tous très jeunes. Enfants des tribunes du stade Olimpico, divisés comme supporters mais unis – c’est du moins ce que leur faisait croire Samouraï – par une foi commune.
Les tribunes. L’avenir de Rome.
Samouraï plaçait de grands espoirs dans ses gars. Des gars excités, des gars qui n’avaient rien à perdre, impatients de tout rafler.
L’idéologie avait été l’appât, mais le projet allait bien au-delà de l’utopie désormais engloutie. Il s’agissait de construire un réseau aux mailles serrées. Ils devaient être forts, déterminés, impitoyables comme les guerriers antiques, mais aussi rusés comme des renards et, en l’occurrence, malléables et urticants comme des méduses. Chacun devait être employé suivant ses qualités propres : chiens fous et professionnels en costard-cravate. Et tous, tous seraient fidèles.
Samouraï commença à parler. Sa voix était basse, plaisante, mais laissait passer de soudaines déchirures d’énergie qui allumaient les esprits et réveillaient les cœurs. Il parla du lien étroit, indissoluble, qui rapproche la Révolution, dont tous ici rêvaient, et la vie de la rue. Il expliqua que ce qui est un crime pour le bourgeois peut être, pour le guerrier, le geste parfait qui ne tolère ni les minables pleurnicheries du faible ni l’âcre censure d’une justice ramollie. Parce que le geste trouve en lui-même sa justification, éthique, esthétique et religieuse, et cela devrait vous suffire.
Il parla longuement, enrichissant son discours de paraboles exemplaires, jusqu’à ce qu’il ait la certitude de les avoir, comme toujours, bien en main. Et alors, brusquement, au moment où ils s’attendaient à recevoir la révélation définitive, il se tut, et, avec un demi-sourire, les congédia tous.
– Allez, maintenant. Que chacun de vous médite sur ce qu’il vient d’entendre. On se revoit le mois prochain.
Les jeunes s’égaillèrent en échangeant des commentaires enthousiastes, mais à voix basse, pour ne pas troubler la concentration de Samouraï qui, les yeux fermés, se massait les tempes, comme vidé par son effort oratoire.
– Maître ? Vous permettez que je vous dise deux mots ?
Samouraï ouvrit les yeux avec un soupir.
Et se retrouva à dix centimètres du canon d’un semi-automatique.
Il concentra son regard sur un visage franc, deux yeux profonds et sourcilleux, une grimace de tension et un tremblement contrôlé à grand-peine.
Marco Malatesta. Dix-huit ans. Un loubard de Talenti doté de cœur, de courage et, surtout, de cervelle. Un de ses préférés. Un dauphin potentiel.
– Si tu croyais me surprendre, Marco, c’est réussi. Maintenant, si tu voulais bien m’expliquer…
– Tu n’es pas un maître. Tu n’es qu’un salopard !
– Attention, Marco. Tu es en train de raisonner comme un petit-bourgeois.
– Rien à foutre de tes conneries, Samouraï. Ça, c’est toi !
Le garçon fouilla dans les poches de son blouson et lui balança au nez une poignée de pilules multicolores.
– Ça vaut un paquet de fric, commenta Samouraï, nullement perturbé. Tu ferais mieux de les ramasser.
– Ah, tu les reconnais, hein ? Et bien sûr ! C’est toi qui arroses la tribune d’ecstasy, toi qui nous drogues. T’es un dealer, Samouraï. Non, pas un dealer, le chef de tous les dealers. Tu nous as envoyé casser la gueule aux dealers. Et tu as appelé ça un “acte révolutionnaire”. Et en fait c’était quoi, hein ? De la libre concurrence ?
– Mon garçon, si tu veux tirer sur quelqu’un, il faut d’abord ôter la sécurité.
D’instinct, Marco baissa les yeux.
Samouraï sourit puis agit, foudroyant. En un instant, le pistolet se retrouva entre ses mains.
Marco se jeta sur lui, ivre de rage. Samouraï s’écarta à peine, esquivant l’assaut, et lui flanqua un coup de crosse sec à la base de la nuque. Le garçon s’effondra en gémissant. Samouraï fit monter une balle dans la chambre du pistolet. Puis il s’inclina sur Marco, l’obligea à se retourner, s’assit sur lui en lui pointant l’arme au milieu du front.
– Je devrais te rendre la monnaie de ta pièce, Marco Malatesta. Et ça ne te servirait à rien de demander pitié.
– Moi, je ne demande pas pitié à un fils de pute ! Je croyais en toi, Samouraï, je croyais à ce que tu disais. Changer cette ville, changer ce monde pourri, la nouvelle morale. À toi, ce monde pourri, il te va très bien, tu frétilles dedans, tu es un traître !
– Je ne suis pas un traître. Tout au plus, un mauvais maître. Je n’ai pas réussi à t’enseigner quoi que ce soit. C’est pourquoi je suis beaucoup plus coupable que toi. Et ma punition sera de te laisser en vie.
Samouraï empocha l’arme. Il se releva et fit signe à Marco d’en faire autant. Le garçon se remit debout à grand-peine ; sa vision était brouillée, sous son crâne battaient des élancements insupportables. Samouraï le soutint, sa main effleura le visage de Marco, comme une caresse de paix. Marco ressentit une douleur aiguë, il porta une main à sa tempe et la retira, souillée de sang.
– C’est seulement un modeste signe, expliqua Samouraï en repliant une petite lame. Il t’accompagnera toute la vie. Il te rappellera qui tu es, d’où tu viens et ce que tu as fait.
Deux semaines plus tard, quand la blessure fut cicatrisée, Marco Malatesta se présenta à la caserne des carabiniers Pisacane et demanda l’officier de garde.
Rome, de nos jours
1.
Posté à la fenêtre de la suite “Anna Magnani”, au quatrième étage de l’hôtel La Chiocciola, dans les dépliants “petite oasis de charme derrière le Campo de’ Fiori”, pour le vulgum pecus coûteux baisodrome de l’élite capitoline, le député Pericle Malgradi, champion de la chrétienté, ouvrit grand le peignoir de soie noire avec le dessin du Fuji-Yama enneigé – kimono, ça s’appelle un kimono, lui avait expliqué Samouraï, mais c’était un obsédé, ce type –, extirpa le considérable engin dont la légendaire érection était vantée par lui urbi et orbi et commença à bénir de sa rosée jaunâtre toits et passants de la cité éternelle.
– Sabrina ! aboya-t-il sans se retourner vers sa favorite, abandonnée à l’instant gisante sur le lit king-size à côté de l’autre, la Lituanienne. Sabrina, toi qui es romaine, tu la connais c’te poésie de Belli – comment c’était déjà qu’elle disait ? Moi, j’suis le roi… moi j’suis le roi et vous êtes que dalle…
Mais la miction, la sublime miction post-coïtale, quelle jouissance, quel plaisir ! Il pouvait diriger le jet et l’orienter en arrosoir, en fontaine, à giclées répétées et multiples, ou bien en fil à plomb, un gouttelette toc-toc, ou décharger d’un coup dans une cascade impétueuse, mousseuse, sur ces misérables qui travaillaient la nuit.
– Sabrina, regarde ! J’en ai chopé un juste sur la tronche ! Ouais, vas-y, coco, regarde le ciel, prends-toi-z’en aux mouettes et aux corneilles… moi je suis en haut et toi en bas… t’as compris, maintenant, comment ça marche, la vie ? Sabri’ ? Sabrinaaa… Et viens voir, putain de la Madone des montagnes, avec ce que je vous paie, à toi et à la Slave, vous voulez me le faire, un petit plaisir ?
Mais rien. La boutique mon cul devait s’être assoupie. Ben, évidemment. Il les avait crevées, ces deux-là. Ça rigole pas : il s’agit de Pericle Malgradi ! Mais il allait s’en occuper en personne de leur sonner le réveil, aux “professionnelles”.
Le député repêcha dans la grosse poche du kimono sa Patek Philippe Annual Calendar 4937g, embrassa avec un tendre et légitime orgueil la petite photo de ses filles qu’il s’était fait encastrer dans le boîtier, déclencha le mécanisme – et va le trouver ailleurs, quelqu’un qui peut se permettre comme boîte un dragon à cinquante mille euros – et attrapa deux comprimés de Listra.
– Listra, Sabri’, t’as compris, et pas ce truc de clodos que les autres utilisent, le SSSialis, le Viagra… qu’après tu te retrouves la tête en feu et les tripes en vrac. Ça, c’est un produit spécial, mon enfant, un truc de premier choix, préparé par mon frère Temistocle de ses saintes mains. Un jour ou l’autre, je vous le présente, vous savez, parce que lui aussi pour ce qui est de niquer, il est niveau Champions League… C’est de famille… les frères Malgradi, la classe, c’est pas de la bibine… Oh, Sabri’, toi et l’autre, là, la Slave, comment elle s’appelle… mais vous allez venir, oui, les putes ?
Rien. Silence. Putain, merde ! Là, Sabrina, elle faisait chier. Eh, ok, y avait qu’elle peut-être qui vendait son cul, à Rome ? À Rome, où on nage dans la chatte ! La prochaine fois, deux négresses. Non, mieux : deux négresses et un trav’. Comme ça, pour être un peu ensemble dans la joie. Le minimum syndical, après toute une vie passée au service de la communauté. Mais avec les trans’, que les choses soient claires : la lui mettre, oui, bwana, mais la prendre, jamais. Il était pas pédé, lui !
Le député remit la montre dans sa poche, en tira une dose de coke enveloppée de papier alu, y émietta les pilules, disposa le tout sur le rebord de la fenêtre et se fit un solide rail.
– Sabrina ! La Slave ! Venez, qu’y en a aussi pour vous.
Encore le silence. Suffit ! Un vertige violent le fit vaciller. Il s’appuya à la balustrade. Le produit était en train de monter au cerveau. Et de là, très vite, il allait redescendre dans l’engin. Tandis que le cocktail érectile commençait à faire son effet, un joyeux sentiment d’invincibilité l’envahissait. Tout le monde disait d’y aller mollo, tout le monde disait qu’on dansait au bord du volcan, tout le monde craignait que les choses changent d’un moment à l’autre. Tout le monde déblatérait sur le spread, la spending review[2], la moralité… et bordel ! L’Italie ne changera jamais. Nous serons toujours en haut, et les misérables en bas.
– Au secours !
Oh, enfin, un peu de vie.
– Remettez-vous le petit brillant, y a tonton qui arrive.
Ah, le brillant. Ça, c’était la trouvaille qui l’avait convaincu de la supériorité de Sabrina sur le reste du tapin romain. Un petit bijou fourré dans le petit trou, celui de derrière. Préliminaires de sultan ! Avec un seul inconvénient, il y avait le risque de l’avaler, ce machin. Mais tu parles si à Pericle Malgradi, the Number One, une merde de ce genre pouvait arriver.
Malgradi se retourna.
Sabrina le fixait, pâle et tendue.
– Qu’est-ce qu’y a, merde ?
– Vicky se sent mal.
Malgradi commença à réaliser qu’il y avait peut-être un problème.
– Et elle veut quoi, l’autre, là ?
– Elle est en train de mourir, crétin.
Mais qu’est-ce qui lui prenait, à Sabrina ? Et pourquoi elle criait tant ?
– Tais-toi, sangu ’i cristu, staju pinsannu, sang du christ, je réfléchis[3].
Sabrina souffla de colère. Malgradi évalua la situation. Sainte Madone ! Verte, elle était devenue, la Slave, verte comme une tête d’artichaut en fin de saison. Elle haletait, renversée sur le drap de satin noir, et un bruit de fond malsain remontait de ses poumons chaque fois que sa poitrine se levait et s’abaissait dans l’effort d’inspirer.
– Madone ! Me more, me more ! Elle me meurt, elle me meurt entre les mains, c’te conne me meurt !
Incapable de bouger. Incapable de prendre une décision. Incapable de parler. Sabrina fouilla son sac à main et attrapa le portable.
– Il faut appeler une ambulance ! dit-elle.
Le député fut enfin foudroyé par un éclair de conscience : je suis foutu ! Il s’écroula sur le lit à côté de l’étrangère, toujours plus décolorée et haletante. Tandis que la torpeur de la coke s’évanouissait et que montait la lucidité hystérique des amphétamines, les conséquences lui passèrent en rapides séquences devant les yeux.
Donna Fabiana, épouse et mère, dévote aux Sœurs Oblates de la Vierge. Fini.
Le secrétaire national du parti, engagé corps et âme dans la défense de la famille contre les épousailles des pédés et la plaie de l’avortement. Fini.
Ses électeurs au collège de la Calabre ionienne déçus et irrités. Fini.
Fini. Le scandale. La misère. La taule.
La Lituanienne haletait, sa bouche se remplissait de mousse jaunâtre, ses mains s’ouvraient et se refermaient dans l’effort de sucer une dernière goulée d’air.
Malgradi arracha le portable des mains de Sabrina.
– T’appelles personne, merde ! T’as compris ? Tire-toi ! Jativínni ! Vui cca nun siti mai vinuti ! Tire-toi ! Vous, ici, vous n’êtes jamais venues ! Moi, je vous connais pas !
– Elle est en train de mourir, nom de Dieu ! Il faut qu’on demande de l’aide !
– Et tant pis pour elle ! Moi, je m’en vais, merde ! hurla Malgradi et il commença à fouiller en quête de ses vêtements.
Et Sabrina, soudain glaciale, mauvaise comme une hyène :
– Ah bien sûr, parce que personne ne t’a vu monter avec nous.
Hôtel La Chiocciola, hôtel de charme[4]. S’il avait pu le brûler, qu’ils crèvent tous, eux et leurs ancêtres ! Et toi, radasse, je devais t’attacher avec une chaîne, le triple nœud, j’aurais dû te faire ! Et merde à cette Vicky de mes deux et à toute sa race, on a été trop bons avec ces étrangers, trop, on leur a donné un doigt et eux ils se sont pris le bras et tout le reste, je suis baisé, baisé…
Et enfin, dans un râle, la malheureuse vomit un caillot de bouillasse, puis ce fut le silence.
– Elle est morte ! murmura lentement Sabrina.
Elle ferma les yeux et planta sur Malgradi un regard brûlant de mépris, de nausée, de dégoût.
Mais le député était ailleurs. Dans le fond de son cœur avait germé un souvenir de sa lointaine enfance calabraise, comment c’est que disait pépé Alcide, quand ils allaient pêcher près de la côte à Le Castella, prie, prie, que les poissons arrivent parce que c’est justement quand tu sais pas quel poisson prendre qu’ils arrivent, et alors Malgradi tomba à genoux, joignit les mains et commença à invoquer le Très-Haut, que sa main bénie s’abaisse sur son humble serviteur, je me retirerai dans un couvent, oh Seigneur, dans un couvent, mais sauve-moi de ce scandale, toi qui peux tout, je te prie, je…
– Oui, prie, prie. Là, l’ange gardien il va arriver sur son tapis volant.
Ah, la pute s’y mettait aussi. Et elle se permettait de l’insulter. Comment ? Tu te pointes avec cette abrutie que, si ça se trouve, elle avait aussi une maladie et tu la ramènes encore ?
Une fureur irrépressible s’empara du député Malgradi. Il se leva, se jeta sur Sabrina et l’envoya dinguer d’une baffe mauvaise.
– Ouais, c’est ça, bravo, dit-elle sans se démonter, en se passant une main sur la joue. Qu’est-ce que tu vas faire ? Tu vas me tuer, moi aussi ? Comme ça, au lieu d’un cadavre, t’en auras deux sur le dos ?
– Mais bordel, qu’est-ce que tu veux ? T’as une idée, pouffiasse ?
Sabrina reprit son portable et passa un appel.
– Spadino ? J’ai besoin d’un coup de main.
Une demi-heure plus tard, un jeune homme dans les vingt-deux ans en t-shirt noir et jean délavé frappa à la porte. Il était petit, boutonneux, laid comme la dette.
Sabrina le fit entrer et lui indiqua le lit.
Un coup d’œil suffit au garçon pour comprendre qu’il avait fait bingo. Le cadavre, Sabrina un peu triste et très dégoûtée, le type suant qui se tordait les mains… Oui, c’était sa grande occasion. Meilleure que ce qu’il avait espéré quand il avait répondu à Sabrina.
– Si vous pouviez nous aider à venir à bout de cette situation… si embarrassante…
Le gros bonnet s’approchait, sourire d’estrade électorale et tremblement d’imminente attaque de panique. Pourvu qu’il ne se mette pas à chialer comme un bébé.
– Eh ben ?
– Je… voilà… Sabrina, là, m’a parlé en bien de vous…
– À moi aussi, d’toi, si c’est ça, ricana Spadino.
Le député plongea une main dans sa poche et en sortit un portefeuille volumineux.
– Si vous pouviez m’aider à…
À ce point, il ne savait vraiment plus quoi dire. Surtout, comment le dire. Le jeune homme s’amusa à le tenir encore un peu sur des charbons ardents, puis il hocha la tête et s’alluma une cigarette.
– Donc, explique-moi ça. Tu veux que moi, je me démerde de la pute morte.
Un large sourire de soulagement détendit les traits du député.
– Naturellement ! dit-il en ouvrant son portefeuille. Je pensais que pour votre dérangement…
– Et tu pensais à combien, juste pour se faire une idée.
Le député lui tendit un rouleau de billets.
– Ça doit faire…
– On comptera ça après, le rassura le garçon, en empochant le fade avec une rapide rapacité.
Malgradi misa sur le sourire qu’il réservait aux interlocuteurs de prestige quand la négociation était conclue à la satisfaction des deux parties.
– Je n’oublierai pas ce que vous avez fait pour moi, monsieur…
– Appelle-moi Spadino. Et pour les remerciements… t’inquiète, t’auras tout ton temps ! Et maintenant dégage.
Malgradi recula vers la porte, en marmonnant d’autres paroles de circonstance.
– J’ai comme l’impression que ton ami est vraiment un fumier, commenta Spadino quand le terrain fut libre.
– T’imagines pas à quel point.
– Donne-moi un coup de main pour habiller cette pauvre nana, va.
Avec un soupir, ils se mirent au travail.
Le plan était de la décharger dans un endroit que Spadino connaissait bien. Un endroit sûr. Il fallait donc la faire sortir sans que le concierge de La Chiocciola, les femmes de chambre ou d’éventuels inconnus rencontrés en chemin suspectent que la fille était morte. Mais même rhabillée et aspergée de parfum – la soirée était chaude et déjà une petite odeur désagréable commençait à se faire sentir –, la Lituanienne avait sans équivoque l’air d’un cadavre. Spadino ordonna donc à Sabrina de la maquiller et elle apporta sa contribution avec l’idée de lui mettre les lunettes-miroir Tom Ford qu’elle utilisait pour cacher ses cernes quand, après une folle nuit, elle devait encore faire une passe rapide. Même si l’effet n’était pas exaltant, ça pouvait aller. Il s’agissait de faire quelques dizaines de mètres, et avec un peu de chance tout s’arrangerait au mieux.
Ils la mirent sur pied, en la soutenant chacun d’un côté. Mais qu’est-ce qu’elle pesait, paix à son âme ! Les mouvements étaient embarrassés, on voyait clairement que ce n’était pas elle qui marchait, mais eux qui la traînaient.
– Y a rien d’autre à faire, dit Spadino. On racontera au concierge qu’elle est bourrée. On lui laissera peut-être cent sacs, comme ça il comprendra qu’il vaut mieux qu’il regarde ailleurs.
Le raisonnement se tenait.
Ils se mirent en route.
Le couloir du quatrième étage était désert. L’ascenseur arriva tout de suite. Ils se retrouvèrent presque sans effort dans le hall. Spadino demanda au concierge de lui tenir la lourde porte tournante ouverte, ce que l’homme exécuta avec un sourire doux. Sabrina lui tendit deux billets de cent.
Quand l’étrange trio s’en fut allé, le concierge retourna derrière le comptoir, mit de côté le Corriere dello Sport qu’il lisait religieusement chaque jour pour se sentir plus romain et, à l’occasion – cela dépendait des clients –, plutôt romanista ou plutôt laziale[5], et il se mit à réfléchir. Il s’appelait Kerion Kemani, avait trente-cinq ans, venait d’Albanie et un doute le tourmentait. Il devait beaucoup à M. le député Malgradi : son emploi, entre autres, et la nationalité italienne, qui allait arriver d’un moment à l’autre. Mais jusqu’à quel point pousser la gratitude ? Avant de marcher droit, il avait lui aussi connu une brève saison dans la rue. De toute manière, on ne peut pas dire que les Italiens lui aient laissé le choix. Il avait débarqué à Bari avec la première vague migratoire, en 91. À peine plus vieux qu’un enfant, il s’était retrouvé serré au milieu des autres dans un stade qui s’était bientôt transformé en enclos de bêtes fauves. Pour se payer la traversée, son père avait vendu tout ce qu’il possédait, la maison, le champ, les quelques bêtes qui en son temps avaient échappé à l’avidité du régime communiste. Dans le stade de Bari, la mafia de Valona avait fait le reste : sa sœur était allée faire le trottoir et lui s’était débrouillé dans le secteur de la récupération des dettes. Ce qui équivalait à terroriser des pères de famille, briser des os de temps à autre, punir des putes rétives. Des trucs de ce genre. Puis les choses avaient changé, bien sûr, mais il y a des souvenirs qu’on ne peut effacer. Et si l’expérience de la rue avait un sens, eh ben, la nana avec les grosses lunettes était tout sauf bourrée.
Elle était morte.
Mais, cela dit, que faire ?
Donc, raisonnons.
Quoi qu’il soit arrivé dans la suite, Malgradi y était mêlé. Et à lui, Kerion, qu’est-ce que ça lui rapportait ?
Après tout, la bienveillance que le député lui avait manifestée n’était pas à fonds perdus. Malgradi l’aidait à faire son chemin en Italie mais lui en échange garantissait la discrétion maximum sur sa turbulente vie sexuelle. Pas d’enregistrement, pas de communications embarrassantes à la questure, pas de demande de documents d’identité et, en plus, tous les compatriotes qui réussissaient à obtenir la nationalité convoitée – au moins un millier jusque-là – devaient voter pour lui.
Donc, plus que de bienveillance, il s’agissait d’un pacte. Et les pactes, comme on sait, ne sont pas éternels. Ou, du moins, ils peuvent toujours se rediscuter.
“Là, c’est mon tour, monsieur le député.”
Ce fut ainsi que Kerion Kemani, concierge albanais et aspirant citoyen italien, monta dans la suite “Anna Magnani”, s’empara d’une taie souillée d’une substance puante sur la nature de laquelle il ne lui parut pas opportun d’enquêter et d’un papier d’aluminium avec des résidus de poudre blanche et, armé de son portable, prit pour compléter le tout quelques photographies du lieu du délit. Plus tard, dans le deux-pièces au Pigneto qu’il partageait depuis quelque temps avec sa sœur, ex-putain promue soignante d’une vieille dame en chaise roulante, il écrivit un bref compte rendu des événements et enfin alla dormir.
Au moment opportun, tout cela s’avérerait utile.
Spadino et Sabrina déchargèrent le cadavre dans la réserve naturelle de la Marcigliana, à quelques kilomètres avant Monterotondo Scalo. Spadino repéra une espèce de petite gorge, ils sortirent de l’habitacle la Lituanienne et lui arrangèrent une belle litière de feuilles et de branches sèches.
– Repose en paix, amen, commenta Spadino et il se roula une cigarette.
– Maintenant, tu me ramènes à Rome, s’il te plaît ?
– Oh, détends-toi, Sabri’, regarde, quelle belle nuit étoilée. On est qu’au début. Il me semble que ton député, c’te connerie ça va lui coûter un beau tas d’euros.
– Moi, je veux pas m’en mêler.
– Et qui t’a dit de le faire ? Même : moi, tu me connais même pas, c’est clair ?
– Fais attention que Malgradi est un homme dangereux.
– Qui ? Lui ?
– Il a les amis qu’il faut, Spadi’, le sous-estime pas.
– Allez, dis pas de conneries ! C’est moi qui suis dangereux, poupée ! Et toi, aussi, ça suffit de chialer, maintenant, hein ? Ce qui est fait est fait.
– Spadino, moi, je veux changer de vie.
– Dommage, rétorqua-t-il avec un ricanement sarcastique, en jetant son mégot. Moi, tout ce mouvement, ça m’a donné une envie.
– Je t’en prie, rentrons à Rome.
– Les voyages se paient, trésor, coupa-t-il en déboutonnant sa braguette.
Sabrina se mit au travail.
Autour d’eux, pendant ce temps, des ombres invisibles et silencieuses commençaient à bouger, attirées par l’odeur. Des chiens sauvages.
[1] Depuis plusieurs décennies, il existe dans toute l’Italie des “centres sociaux”, lieux d’agrégation politico-culturelle créés par l’extrême gauche, le plus souvent dans des squats, que depuis quelques années l’extrême droite s’emploie à imiter. (Toutes les notes sont du traducteur.)
[2] Spread : différence dans le rendement entre les titres d’État allemands et italiens comme indicateur de la (mauvaise) santé de l’économie italienne. Spending review : révision des dépenses publiques. Ce sont deux des mots les plus utilisés dans la langue “italienne” ces dernières années.
[3] Sous le coup de l’émotion, le député se met à parler en calabrais, la phrase en dialecte est immédiatement suivie de sa traduction : cette convention sera appliquée dans l’ensemble du livre.
[4] En français dans le texte.
[5] Soit plus supporter de la Roma ou de la Lazio, les deux équipes rivales de la province de Rome.