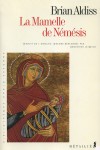-
« L'«éducation» d'un juvénile représentant des couches moyennes passablement perturbé par une mère toujours au bord de craquer, une sexualité toujours sur le point d'exploser et un conflit mondial. C'est grossier, brutal, poignant. [...] Ce «roman d'apprentissage» fort peu sentimental est nerveux, emportant, faussement simple et véritablement secouant : du grand art qui ne se montre pas, pour des émotions obliques qui ne se formuleront pas. »LA QUINZAINE LITTERAIRE
Le thé, Sister Traven est venue une seule fois le prendre avec nous, à la maison, et cela n'a pas manqué: ma mère nous a tous plongés dans un état voisin de la panique avant l'arrivée de notre invitée.
Elle s'y est prise comme à son habitude, mouche du coche partout présente, faisant sans cesse appel à ce qu'elle nommait "un peu de tact" pour nous convaincre, Beatrice ou moi, c'est-à-dire qu'elle susurrait de son ton le plus melliflu des choses qui auraient été beaucoup plus supportables si elle s'était contentée de les énoncer d'une voix normale. " Mais non, voyons, ma petite Beatrice, je ne crois pas que nous allons utiliser nos serviettes ordinaires. Vous verrez que les serviettes en papier, mais oui mais oui, celles qui sont dans le dernier tiroir de la petite commode, vous verrez qu'elles seront d'un effet charmant, vous ne trouvez pas? Mais bien sûr, bien sûr, il vaut sans doute mieux que j 'aille les y chercher moi-même, n'est-ce pas? Mais non, voyons, mon petit, ne vous gênez pas, j'y vais, j'y vais! "
Beatrice ne se formalisait pas. Elle était à notre service depuis plusieurs années et connaissait les façons de faire de maman. Elle était mariée, maintenant, et avait donc cessé d'être "nourrie, logée", mais elle continuait de venir chez nous le matin, confiant ses enfants - de plus en plus nombreux à la surveillance d'une quelconque sœur aînée. Mais ce jour-là, pour rendre service, elle était venue aussi l'après-midi, comme elle faisait dans les grandes occasions. Tandis que nous nous affairions pour mettre la table, je l'observai avec intérêt. C'était une fille plutôt ordinaire -pas mal!
Ce que je peux être fidèle, tout de même, songeai-je. Enfin, quoi, j'ai dix-sept ans et elle en a au moins vingt-cinq et deux horribles mouflets, et je continue de la trouver plutôt à mon goût!
- Chéri, tu as trouvé ta cravate? Tu ferais mieux de te dépêcher, sinon elle risque d'arriver, tu ne crois pas?
- Franchement, maman, vous croyez que ça la gênera beaucoup que je ne porte pas de cravate?
Elle me fixa droit dans les yeux avec un sourire inoxydable.
- Elle a certainement vu des tas de petits garçons sans cravate, mon petit Horatio; et même plus déshabillés encore! mais, si je ne me trompe, elle est ton invitée à toi et je ne pense pas que ce soit trop te demander que de te montrer vaguement coopératif.
Le "petit garçon" était exactement aussi indigeste qu'elle l'avait espéré.
- C'est vous qui avez voulu l'inviter, maman, pas moi!
- Mon poulet, je te serais vraiment reconnaissante de ne pas te montrer trop franchement odieux au moment même où je fais tout ce que je peux pour vous aider, Beatrice, Ann et toi, tous tant que vous êtes. Tu sais parfaitement que nous l'avons invitée pour te faire plaisir à toi. C'est ton amie à toi, tu ne le nieras pas? Et, qui sait? un jour, elle nous invitera peut-être à Traven House pour prendre le thé avec elle et sa famille.
En gagnant l'étage pour chercher ma cravate, je croisai ma sœur dans l'escalier.
- Elle ne pense qu'à ça, que Sister Traven nous invite à prendre le thé chez elle.
- De toute façon, faut pas compter sur moi. J'arrive pas à mettre la main sur mes souliers, répondit Ann.
Elle avait treize ans, alors, âge classique de l'apparition du syndrome des souliers perdus.
Dans ma chambre, je l'entendais encore hurler à l'adresse de maman. Elle était, et de loin, plus disposée que moi à donner de la voix.
Quand je fus habillé, cravaté et tout et tout, je m'assis sur le bord de mon lit et feuilletai un magazine. C'est dans cette attitude que maman me découvrit quand elle vint à l'étage.
- Prêt, mon chéri? Pourquoi ne descends-tu pas attendre notre invitée? Ne crois-tu pas que ce serait plus gentil ainsi ? Je vais me recoiffer, je dois avoir une tête! Ah, je n'en puis plus, et elle n'est même pas encore arrivée. J'espère qu'elle n'est pas trop regardante sur les détails! Il faudra que je dise à ton père de jeter un coup d'œil au rideau de la défense passive dans cette pièce, il est tout de travers.
- Mais vous êtes parfaitement coiffée, maman.
- Merci, mon chéri.
Elle s'approcha de moi, m'entoura de ses bras et déposa un baiser sur ma joue.
- Tu es un gentil garçon, un très gentil garçon. Ne te dépêche pas trop de grandir, n'est-ce pas, mon chéri? Attends un peu que je t'arrange cette cravate. Je suis si contente que tu l'aies trouvée. Ah, j'aurais dû emprunter le service à thé de tata Nelly.
- Pourquoi ça? Le nôtre est cassé?
- Chéri, voyons, tu sais bien qu'il est tout ébréché et plein de craquelures.
Elle recula d'un pas pour considérer ma cravate d'un oeil critique.
- Tes cols ne sont jamais parfaits. Je suis bien persuadée que les services à thé de Traven House sont charmants, tu ne crois pas? Son père est amiral, c'est bien ce que tu m'as dit?
- Contre-amiral.
- Bien. Allez descends mon chéri maintenant, je mets un peu d'ordre dans mes cheveux et je vous rejoins, j'en ai pour une minute. Et dis-moi, Horatio...
- Oui, maman ?
- Essaie de surveiller un peu ton accent du Leicestershire, je t'en prie!
- J'essaierai, maman.
- Attention à ces ou traînants...
Roulant le magazine et le glissant dans ma poche, je descendis rejoindre ma sœur. Nous étions assis chacun à une extrémité du sofa, l'air sinistre. Elle ne semblait pas me tenir responsable de cet épisode barbant et je lui en fus reconnaissant. Elle jouait aux échecs contre elle-même, comme papa le lui avait appris.
Comme moi, Ann était en train de mastiquer du cachou. Maman nous en distribuait toujours dans ce genre d'occasions éprouvantes pour les nerfs, avant de nous présenter à quelqu'un d'important. Peut-être le cachou ajoutait-il effectivement à nos charmes, encore que je ne me souvienne pas que notre haleine eût nul besoin d'être adoucie ou parfumée.
Maman se servait toujours elle-même lors de ces distributions de cachou. J'adorais le goût violemment artificiel des petits carrés noirs qu'elle tirait d'une minuscule boîte de carton, bien qu'il fût associé à l'énervement de ces préparatifs fébriles, aux inévitables retouches de mon nœud de cravate.
Ma mère était une grande femme mince, elle dépassait de la tête mon gros bonhomme de père. Autant il était lourd, autant elle était frêle comme un oiseau. Il avait la réputation (quelque peu imméritée) de ne jamais se départir de son calme; tandis qu'elle était (plus justement) connue pour être nerveuse. Notre médecin lui avait recommandé le plein air comme remède à cette nervosité et, à cette époque de ma vie, elle allait sans cesse par les rues ou parcourait la campagne environnante, parfois accompagnée d'Ann et, plus rarement, de mon père et de moi-même, toujours un peu à la traîne.
- Tu es trop lent pour suivre un enterrement! lançait maman.
Et, avec un humour laborieux, papa écarquillait les yeux et faisait mine de scruter l'horizon à la recherche d'un éventuel corbillard.
L'invitée dont nous attendions si anxieusement l'arrivée à l'abri de nos haleines parfumées était en l'occurrence l'infirmière de mon collège, Miss Virginia Traven. Je dis "mon collège" mais j'avais déjà décidé quant à moi que j'en avais fini avec l'école.
Il existait plusieurs raisons à ma détermination, la principale étant que j'arrivais à l'âge d'homme et que c'était un bon moment pour le faire. Le moment ? Nous étions à la mi-septembre 1939, la Grande?Bretagne était entrée en guerre contre l'Allemagne nazie depuis un peu moins d'une quinzaine. Mon frère aîné, Nelson, avait déjà disparu, absorbé par l'armée et, s'il fallait en croire l'unique lettre que nous avions reçue de lui, était en train de jouer au petit soldat dans une caserne d'Aldershot. Le mari de Beatrice, un rocailleux jeune homme qui nettoyait notre automobile une fois la semaine, était, nous disait?on, à l'entraînement dans un régiment d'infanterie du côté de Salisbury. Mon père connaissait les affres de l'indécision - s'engagerait, s'engagerait pas ? - et se demandait ce que penseraient de son attitude ses supérieurs de la banque. Et moi j'étais là sur mon sofa, épluchant les petits morceaux de peau morte des cals que je m'étais faits aux mains en pelletant la terre pour recouvrir notre abri antiaérien dans le jardin.
La sonnette de la porte d'entrée retentit. Ma mère cria d'en haut :
- La voilà !
Beatrice alla ouvrir. Contrairement aux instructions reçues je lui emboîtai le pas. Je désirais dire d'abord un mot en privé à notre invitée.
Sister Traven entra gaiement. Elle portait son manteau de tweed léger, un peu fatigué mais confortable. Elle me sourit, la tête vaguement inclinée sur le côté, et se hâta de mettre sa petite main dans la mienne. Quelque chose s'alluma dans son visage quand elle vit que le mien s'illuminait.
- J'espère que vous ne vous ennuierez pas trop, chuchotai?je.
Maman nous fondait déjà dessus du haut de l'escalier avec toutes sortes de petits bruits préliminaires comme un orchestre qui s'accorde. Je me raidis et reculai, attendant l'ouverture.
Les repas ne sont plus ce qu'ils étaient alors. Et c'est précisément vers cette époque que se situe le tournant, en ce qui concerne la famille Stubbs en tout cas. Peut?être même fut?ce le dernier de ces thés somptueux que maman aimait offrir à ses amis, assise au haut bout de la table, la théière et ses accessoires disposés sur une petite table pliante à son côté, adressant à tout un chacun un mot aimable, accordant son attention à ses hôtes à tour de rôle afin que personne ne se sentît laissé pour compte, s'interrompant de temps à autre pour glisser à voix basse quelques instructions à Beatrice.
Ma pauvre maman ! Toujours, son vrai, son plus grand bonheur, résida dans le passé, et ce jour?là comme les autres elle cherchait autant à arrêter la pendule qu'à impressionner favorablement notre visiteuse. Dans la déclaration de guerre, les garçons de mon âge avaient déjà subodoré le changement et s'étaient mis à trembler ; il n'est pas douteux que la génération de ma mère en fit autant mais quand nous tremblions d'impatience et de joie, c'était de peur que nos aînés tremblaient.
Peut?être fut?ce la raison pour laquelle elle décida de parler à Sister comme si elles avaient appartenu toutes deux à la même génération. Je puis bien reconnaître aujourd'hui que dix ans à peine les séparaient sans doute, mais c'était un gouffre infini à l'époque.
Par?dessus les gelées et les crèmes, par?dessus les tranches de pain noir, par?dessus les confitures dans leurs coupes de verre qu'enchâssaient des présentoirs d'argent, par?dessus le beurrier, par?dessus le quatre?quarts et le cake, par?dessus les petits pains et les biscuits ; par?dessus les éclairs au chocolat qui étaient surtout là pour Ann, maman conversait joyeusement avec Sister, discutant un avenir qu'elle ignorait encore plus que moi.
- Je dois dire que je vous trouve extrêmement courageuse de renoncer à une situation stable pour participer à l'effort de guerre ! Je suis persuadée qu'une vie passionnante vous attend, avec des tas de camarades et d'admirateurs ! Vous pouvez m'en croire !
- J'espère obtenir un poste en France, dit Sister Traven.
- Mais c'est merveilleux ! Ne manquez pas d'aller à Paris ! Une ville d'une telle beauté ! Notre-Dame ! Les boulevards ! Robert et moi nous adorons Paris, surtout au printemps…
- Mais tu n'y as passé qu'une journée, maman, dit Ann.
- Une merveilleuse journée de printemps, mange ta tartine proprement, Ann, et tiens?toi droite ! Paris vous plairait, j'en suis certaine, Sister Traven.
- Oui, Paris me plaît beaucoup, j'y ai des attaches.
- Des relations de famille, sans doute ? J'imagine que vous devez connaître la plupart des capitales d'Europe… Moi aussi j'aimerais faire mon devoir pour mon pays, mais je ne suis pas aussi libre que vous, trois enfants et un mari…
- Maman, vous ne pensez pas que Nelson n'est plus précisément un enfant ? demandai?je. Il est engagé volontaire et il s'est laissé pousser la moustache.
Maman me sourit et me tendit la main.
- Tends donc correctement ta tasse, si tu désires encore du thé. Beatrice, je crois qu'il nous faut encore de l'eau chaude… Si vous saviez la tête que cette moustache peut faire à Nelson, Sister Traven ! Mais, suis?je bête, vous ne l'avez jamais vu. Ses supérieurs ne tarderont pas à la lui faire raser. Il est à Aldershot ; Robert y était pendant la Grande Guerre. Aurait?il soixante ans que pour moi il sera toujours mon enfant ! J'espère qu'il se comportera bien à l'armée. Je crois que plusieurs membres de votre famille sont militaires, n'est?ce pas, Sister Traven ?
Un petit pied vint me frapper sous la table et Ann m'adressa une grimace par?dessus sa tasse ; nous sentions presque physiquement l'effort que déployait maman pour le mot clé, le mot magique, le mot "chic" - amiral - apparût dans la conversation.
Maman aperçut le geste et reprit :
- Tu me ferais plaisir en essayant de boire un peu plus comme une demoiselle, ma petite Ann.
Sister Traven mangeait avec un petit air modeste et réservé, et cette espèce de demi?sourire qu'elle avait. Je songeai qu'elle aurait pu passer pour la toute jeune fille de maman, sage comme une image, si son visage n'avait déjà porté quelques rides légères. Ses cheveux, qu'elle portait courts et dont quelques mèches étaient d'une parfaite blondeur, étaient beaux et bien coiffés. Elle avait l'air tellement… enfin, on voyait bien qu'elle avait été élevée dans le meilleur monde.
- Mon père et son frère étaient dans la Marine.
- Oh, la Marine, la première de toutes les armes ! Et j'imagine qu'ils y ont tous deux fait une carrière splendide, non ? Permettez?moi de vous donner encore une tranche de quatre?quarts.
- Ma foi, la carrière de mon pauvre oncle David s'est mal terminée. Il s'est noyé en mer.
- Oh, ma pauvre enfant ! je suis navrée. Jamais Horatio ne m'avait dit !
- Je ne savais pas, dis?je. C'est la première fois que j'entends parler de l'oncle David.
- Bien sûr, vous l'ignoriez, dit Sister Traven en m'adressant un petit sourire secret. Ce fut assez tragique. Ça s'est passé en 1917. J'étais folle de mon oncle alors que je n'étais encore qu'une toute petite fille. Il était si brave et si beau. Son navire a été coulé dans l'Atlantique par un sous?marin allemand. Il est resté dans l'eau un temps incroyable, accroché à une épave. Enfin, il fut recueilli par un navire marchand anglais et savez?vous ce qui se produisit ? Il n'était pas à bord depuis une heure quand le bateau fut lui aussi torpillé par un sous-marin. Il a sombré, et mon oncle avec.
- La guerre est une chose terrible, dit maman tout en faisant circuler un plat de gâteaux.
- Nous aurons vite battu les Allemands, dis?je, leurs tanks sont en carton. C'est l'état?major qui le dit.
Il se fit une minute de silence consacrée à la méditation patriotique et à la mastication.
- Mais, je sais que votre père est vivant et se porte à merveille, dit maman.
Sister hocha du chef.
- Il est contre?amiral. A la retraite, bien sûr. Mais il parle de fermer Traven House et de reprendre le harnais, si l'Amirauté veut encore de lui.
Nous sourîmes tous. Maman dit :
- Contre?amiral… Ah, quand je pense à toutes nos grandes vieilles demeures, tant de nobles maisons contraintes de fermer…
Papa avait cherché la demeure de Sister dans un vieux Badeker et voici ce qu'il avait trouvé : " A trois miles vers le N.E., Traven House, XVIIIe s., belle orangerie vict. Résidence de sir Francis Traven, gouverneur de Massachusetts Bay (1771-1779). " Nous avions tous été ravis et nous étions demandé si les descendants de sir Francis continuaient d'y faire pousser des oranges.
- Vous avez des fantômes ? demanda Ann. Je serais morte de frousse ! Vous entendez des bruits de bataille, des armures qui s'entrechoquent, des chaînes ?
Sister éclata de rire, petit spectacle charmant.
- Non, pas de fantômes, pas d'armures qui s'entrechoquent…
- Mais Horry m'avait dit…
- Mange donc ton gâteau, l'interrompis?je. Les fantômes n'ont pas besoin d'être vrais pour te donner la frousse !
- Je t'interdis de parler à ta sœur sur ce ton, Horatio, et fais?moi le plaisir de retirer cette mèche de tes yeux. Ah, j'aime mieux ça.
- Maman et moi nous adorerions venir vous voir à Traven House, dit Ann.
Notre visiteuse eut l'air vaguement désemparé.
- Hélas ! Ann, je ne serai plus à la maison bien longtemps, maintenant. Sinon, ç'aurait été avec grand plaisir.
Ces mots s'imprimèrent profondément dans mon cœur. Je continuai de mastiquer mon cake mais j'avais mal en dedans. Elle n'avait pas le droit de s'en aller ! J'avais besoin d'elle. Je l'aimais. Elle ne se rendait pas compte de ce qu'elle faisait, sinon, jamais elle ne serait partie.
Il y avait quatre femmes dans cette pièce avec moi. A l'exception de ma mère, j'avais eu des relations sexuelles avec toutes. Mais c'était de Sister que j'avais besoin, totalement, seulement. De Sister, parmi toutes les femmes de la terre.
Fallait?il que je me lève et que je déclare mes sentiments ? Est?ce qu'elles allaient rire ? Que dirait maman ? Mais maman, justement, s'étant alors servi une dernière tasse de thé, faisait son grand numéro et déclamait un poème appris quand elle était jeune fille :
Le vieil Hollywood cette nuit résonna
De force appels et cris de joie
Le roi Jacques en sa demeure
Fêtait d'Écosse les meneurs
Qu'il avait fait mander pour l'heure
Avant de se mettre en chemin
Avec l'armée le lendemain
C'est qu'il aimait banqueter
Le bon roi et rire et chanter
Un grand festin le jour puis au soir
Une danse et quelque chose "oir"
Mais cette fête la dernière
Devait être aussi la plus fière,
La plus…
Et ainsi de suite, je ne m'en souviens plus très bien. C'est Marmion, de sir Walter Scott. J'ai appris cela à l'école. Ah, j'aurais pu réciter des heures d'affilée, à l'époque ! Je dis bien à Ann et à Horatio qu'ils devraient lire plus de poésie. Vous lisez beaucoup de poésie, Sister ?
Et Sister fit une réponse appropriée.
Après le thé, Ann fila en douce jouer dans sa chambre. Je demeurai là, tandis que maman se mettait en frais pour mon invitée.
- Dis?moi, mon chéri, finit?elle par me lancer se tournant vers moi. Va donc chercher tes dernières peintures pour Sister Traven. C'est qu'il a vraiment l'air doué.
- Je n'en ai fait aucune depuis que j'ai vu Sister pour la dernière fois.
Sourire, hochement de tête entendu.
- Il en a fait plusieurs, Sister. Il est beaucoup trop modeste. Je suis, quant à moi, grande admiratrice des artistes anglais, Gainsborough et Hogarth et tant d'autres.
Il se trouve qu'elle prononçait Hogarth comme si le nom avait comporté deux g : Hoggarth.
- C'est Hogarth, maman. Avec un seul g.
- Je suis parfaitement capable d'orthographier Hogarth, mon chéri. Comme d'ailleurs de le prononcer, je te remercie. Un grand artiste. Je me souviens que nous avions un boucher qui s'appelait Hogarth, à la maison, avant mon mariage. De toute façon, il faut que je vous remercie, Sister : vous avez vraiment été charmante de vous intéresser comme vous l'avez fait à mon petit Horatio et de l'emmener en promenade…
Tu ne crois pas si bien dire, me dis?je. J'observais Sister qui se levait pour prendre congé : d'accord, honnêtement, elle n'avait pas une silhouette époustouflante. Mais je pouvais discerner ses seins sous le chandail et je savais comme ils étaient doux, comme en était rose l'aréole quand vous la dégagiez délicatement du soutien?gorge… Du calme, connard, ou tu vas te mettre à bander.
Nous nous levâmes tous. Maman remit en place d'un geste caressant ma mèche rebelle. Puis elle me serra contre elle avec affection.
- Ah, si c'était une fille ! je lui ferais porter une barrette. Je le lui dis souvent, cette mèche me rendra folle. Mais c'est un bon garçon. J'ai des reproches à me faire. Je le néglige un peu, maintenant, ce bon petit. Non, vraiment, j'ai eu beaucoup de chance avec mes enfants.
- Oh, vous n'allez pas remettre ça, maman ! Elle dit ça à tout le monde, Sister. Elle oublie que nous avons été de véritables petits monstres.
- Je n'en doute pas, dit Sister avec un sourire.
J'étais ébahi qu'elle pût sans le moindre trouble me voir ainsi traiter comme un gosse.
- Quand il pleurait, étant petit, son père se mettait dans de telles colères contre lui qu'il menaçait de le jeter par la fenêtre ! Mais c'est un gentil garçon dans l'ensemble. Eh bien, Sister, cela a été une grande joie… Horatio, voyons, va donc chercher le manteau de Sister Traven. Est?ce ainsi que je t'ai élevé ? Oui, j'espère beaucoup vous revoir bientôt…
Comme elles se dirigeaient vers la porte, je les devançai, l'ouvris, et me glissai à demi sur le seuil avant de dire :
- Maman, je vais faire un petit bout de chemin avec Sister dans sa voiture. J'aimerais lui dire quelque chose.
- Dis?le?lui maintenant. On ne peut pas dire que tu as été très bavard.
- Non, s'il te plaît, je lui dirai en chemin, maman, et puis comme ça, j'irai dire bonjour à William. Je ne serai pas long.
- Eh bien, d'accord, mon chéri. Ne sois pas trop long. Ton père ne va pas tarder.
Pour descendre les cinq marches blanches de notre perron et gagner sa voiture au bout du chemin, je pris le bras de Sister. Maman demeura sur le seuil et nous adressa des signes de la main tandis que la voiture s'éloignait ; j'espérais qu'elle avait remarqué mon geste.
- Passons par le cimetière.
- Mais, vous avez promis de faire vite.
En général l'avenue qui longeait le cimetière était calme. Elle se rangea dans un endroit propice sans perdre de temps. Tournant tous deux la tête, nous nous entre-regardâmes. Rien en elle ne semblait indiquer qu'elle avait traversé la même épreuve que moi.
Nous nous embrassâmes. Ce ne fut pas ce que j'appellerais un baiser passionné, je savais qu'il ne fallait pas compter sur elle pour ce genre de baiser à cette heure de la journée ; les baisers passionnés et même ceux qui précédaient les baisers passionnés et qui constituaient sa manière de s'assurer de ses propres dispositions, ne se matérialisaient qu'avec l'obscurité. Mais c'était à n'en pas douter un baiser aimant. De nouveau, je fus rempli de stupeur à l'idée qu'elle n'avait pas été indisposée par l'acharnement de maman à montrer que je n'étais qu'un gosse. Aussi lui dis?je :
- Je vous ai trouvée rudement gentille avec maman.
- Je l'ai trouvée gentille avec moi.
Mieux valait ne pas s'appesantir sur ce sujet ! Je lui demandai si nous pouvions rouler jusqu'à la tombée de la nuit. Elle savait très bien ce que j'entendais par?là.
- Il faut que je rentre à Traven House, mon amour. Notre notaire doit passer ce soir pour régler avec moi quelques affaires. Je possède quelques actions, des bons, et quelques trucs comme ça, ainsi que des bijoux - oh, sans grande valeur ! - que je compte confier à sa garde jusqu'à la fin de la guerre.
- Oh, Virginia, comme j'aimerais que vous ne partiez pas !
-300x460.jpg)
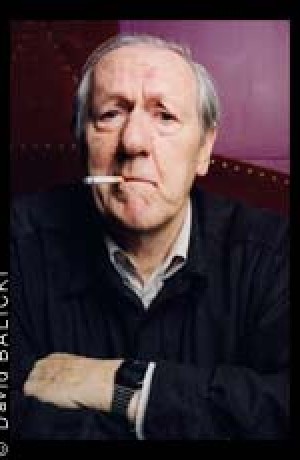
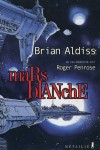
-100x150.jpg)


-100x150.jpg)
-100x150.jpg)