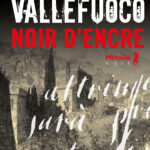Faut-il avoir traversé l'Afrique, de l'Angola au Mozambique, pour se rendre compte que « le désespoir est le réflexe le plus futile sur les chemins sans appel » ? Jeune journaliste portugais, déjà couvert de prix, Pedro Rosa-Mendes a fait ce voyage en 1997, à pied ou en stop. Il en a ramené un livre, qui n'est pas un récit de voyage, un itinéraire raconté, mais un patchwork de reportages, de portraits, de lettres et d'anecdotes, « l'invention d'une géographie par la parole ». Dans ce décor, aidé par une belle écriture, on apprend qu' «en Angola, les guerres naissent comme le; jours », qu'il est des pays « où le dernier repas a lieu quand il y a à manger », que l'on peut «partir de la vie avec les ustensiles pour coloniser la mort ». De ce déplacement, on revient « avec une contrebande de cauchemars » mais, aussi, avec une malle de souvenirs dédouanés, le doux-amer réconfort qu'il existe de « l'allégresse dans un pays mutilé ».
Dans la mosaïque, quelques zelliges brillent plus que d'autres. On se prend au jeu avec Augusto Amaral, inventeur d'une « table pour lire le temps ; on scrute une baie - deux galions ancrés au large - avec les yeux de Jono Tomas da Fonseca, mort-vivant comme l'histoire; on perd son identité, et même le souci d'en avoir une, aux côtés de John van Der Merve, en réalité un Portugais « assimilé » par l'Afrique du Sud de l'apartheid, « l'homme debout de l'autre côté du fleuve » qui s'est battu à la tête des Flechas negras, un bataillon de bushmen; on écoute une femme - «je ne me suis pas mariée avec celui que j'ai aimé, je me suis mariée avec celui que j'ai rencontré » - qui « adore tout ce qui souffre»; et on meurt gratuitement, à Huambo, l'ancien Nova Lisboa, où un fils et ses vieux parents sont assassinés en, l'espace de trois mois, trois victimes
« complètement inutiles « dont la mort n'a « atteint que ceux qui les aimaient ».
Dans ce livre, dont les trois parties s'appellent « Terminus », « Africa Hôtel » et « Cité Miséria », la guerre est omniprésente. Elle l'est à travers « ces hommes qui ont payé un prix exorbitant en lambeaux de leur propre corps. Ils ont des mines au bout de leurs béquilles, des grenades là où manquent leurs mains et des bombes à portée de leurs cils. Un commerce de troc en direct, c'est ça leur guerre: un pied pour chaque pas, un doigt pour chaque retard, un homme pour chaque pouce de terrain, un cri pour chaque douleur. Une génération pour chaque prophète » Celle à venir, la génération des enfants d'aujourd'hui, promet des lendemains pires encore. « Vois cet enfant, il shoote son football dans un crâne humain. Ce n'est pas par méchanceté. Le crâne était disponible, à portée de main et desséché. Toi et moi connaissons les balises de l'humanité: des crânes s'enterrent, les ballons sont ronds. A cet enfant, personne n'a donné d'occasion pour autant. »
Etrangement, Pedro Rosa-Mendes rapporte des horreurs sans noircir ses pages. Dans son monde recréé de traits de plume sûrs, il règne la maka, l'intraduisible mot-valise angolais pour «désordre », « confusion », « grand bruit », « bagarre » ou « catastrophe ». Mais c'est un monde sans appel et, donc, sans désespoir.
Dans la presse
-300x460.jpg)