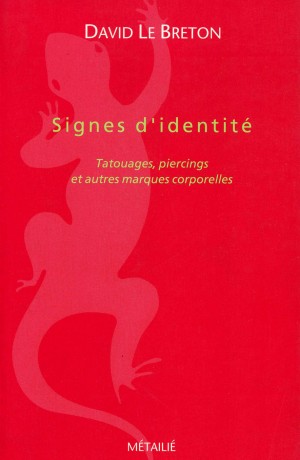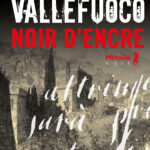Entretien entre Thierry Jonquet et David Le Breton
A l'occasion de la sortie d'" Ad vitam aeternam " et de" Signes d'identité ", le romancier et le sociologue s'interrogent sur le statut du corps dans notre société. Tatouage, piercing, chirurgie... : on le bricole sans limites, comme une "prothèse du moi".
D'un côté, Thierry Jonquet, pilier du roman noir français, dévoreur de presse et de faits divers, hanté par la mort, les exclus et la chair à psychiatre. De l'autre, David Le Breton, professeur de sociologie à l'université Marc-Bloch de Strasbourg, spécialiste de l'anthropologie du corps et des conduites à risque des jeunes. Corps tatoués, piercés, bricolés, cadavres manipulés, dépecés, mis en spectacle : leurs œuvres respectives pointent une société contemporaine en souffrance avec son corps, Thierry Jonquet affiche, parmi ses influences, celle de David Le Breton, et l'anthropologue a lu avec passion les livres du romancier. Ils ne s'étaient jamais rencontrés : Télérama les a réunis.
Télérama : Quelle est l'origine de cette passion commune pour la relation de l'homme à son corps?
Thierry Jonquet: Pour moi, l'époque où je travaillais à l'hôpital comme ergothérapeute. J'en garde des images proprement incroyables de vieillards délabrés, d'infirmes déglingués, d'amputés congénitaux qu'on aurait dit droit sortis de Freaks, le film de Tod Browning. Je me souviens en particulier d'un gamin dont le tronc à peu près normal se finissait de manière informe, comme un sac de chair, et de ma première rencontre avec lui, quand un aide-soignant l'a sorti de l'espèce de coquetier qu'on lui avait fabriqué pour qu'il puisse tenir en position verticale. L'histoire commence quelque part par là...
David Le Breton : La mienne est celle d'un adolescent mal dans sa peau aux prises avec l'énigme de l'incarnation : quel est le lien entre moi et mon visage, mes mains, mon corps ? L'anthropologie, le détour par d'autres sociétés humaines m'ont permis de comprendre que nous sommes les incarnations d'une culture, que nos gestuelles, nos habitudes vestimentaires, la manière dont nous parons notre corps renvoient à des visions du monde, à des manières d'être ensemble. Depuis une quinzaine d'années, j'essaie ainsi de comprendre quelle est la part de l'autre en nous, la part de la culture. Parallèlement, comme Thierry Jonquet, j'ai moi aussi fréquenté l'hôpital, où j'ai enseigné dans diverses écoles d'infirmiers. Je suis troublé de constater à quel point la qualité de notre rapport au monde passe par notre corps: notre apparence commande le regard des autres, peut induire une extrême violence ou à l'inverse une grande adhésion. Ce qui me rapproche de Jonquet, c'est la volonté de comprendre le corps abîmé, le corps en souffrance.
Thierry Jonquet: Mais je n'y vois, moi, qu'une matière romanesque. J'essaie de construire des histoires qui accrochent le lecteur, je n'avance pas de discours, tout juste quelques questions.
David Le Breton : N'empêche que des ouvrages comme les vôtres sont bel et bien des sortes d'analyseurs sociologiques. Il y a dans vos intrigues, dans la mise en scène de vos personnages des éléments qui permettent de mieux comprendre le statut du corps dans notre société. Au risque de vous surprendre, je ne vois pas de différence majeure entre nous. Le roman est une manière de poursuivre la réflexion avec d'autres moyens que ceux des sciences humaines. Les différences, ce sont les mises en forme, les morales d'écriture, l'enquête, le terrain, la nécessité pour un universitaire d'étayer son propos par la citation d'une série d'auteurs alors que le romancier peut aller droit à son sujet sans avoir de compte à rendre, sinon sur la qualité de son intrigue.
Télérama : Quelles ont été les sources de votre dernier roman, Thierry Jonquet ? Comme vos précédents livres, Ad vitam aeternam est directement inspiré de la réalité sociale...
Thierry Jonquet : Bien sûr, mais je réagis émotionnellement, j'essaie de ne pas trop rationaliser. Le roman, sinon, serait tué dans l'œuf. A l'origine, il y a la lecture de L'Adieu au corps, cet essai où David Le Breton analyse le mépris contemporain pour le corps: cette manière de le considérer comme imparfait et par conséquent comme un terrain d'expériences sans limites pour l'embellir ou l'améliorer. ça commence avec le piercing, qui peut prendre des formes radicales, jusqu'à certains délires de la médecine, qui finit par ne voir en nous qu'une sorte de meccano dont les pièces pourraient être changées à l'infini ... Mais le déclic, c'est un reportage que j'ai vu, peu de temps après, sur l'artiste allemand Gunther von Hagens, un ancien médecin anatomiste devenu
>" sculpteur " de cadavres (qu'il conserve grâce à un procédé de son invention, la " plastination ", et met en scène en fonction de ses caprices). Quand j'ai vu que des millions de gens se pressaient à ses expositions, je me suis dit que j'avais la matière d'un roman. Il me semble que nous sommes au début d'un processus et qu'il va y avoir des dégâts !
David Le Breton : Les valeurs anciennes attachées au corps ont en effet volé en éclats ces vingt dernières années. Celui-ci est aujourd'hui perçu comme un brouillon que l'on peut remodeler ou rectifier à volonté. On bricole son identité en bricolant son corps, avec l'idée qu'il n'est que la prothèse du moi. La chirurgie esthétique et la vogue qu'elle connaît est tout à fait révélatrice à cet égard. On ne se contente plus désormais du visage que l'on a. La mode du culturisme va dans le même sens. Quant au développement actuel du tatouage ou du piercing, il exprime, entre autres, la souffrance des jeunes générations face à un monde de moins en moins lisible. J'analyse ainsi les marques corporelles comme une manière de " prendre ses marques " avec la société.
Thierry Jonquet : Le corps est un monde en miniature. On agit sur son corps plutôt que d'agir sur le monde.
David Le Breton : Exactement. En agissant sur son corps, on reprend le contrôle d'un monde qui nous échappe. Pour moi, le tatouage, le piercing, les scarifications sont aussi une manière d'éviter, de dépasser les incisions corporelles brutales que s'infligent les jeunes dans les moments de grande souffrance. Les filles, en particulier, se coupent, font couler le sang, dans une perspective d'apaisement, de dilution d'une tension insupportable, pour échapper à un sentiment d'impuissance. Les marques corporelles constituent de ce point de vue une pratique pacifiée parce qu'elles recourent à un spécialiste, une sorte de compagnon de route qui va permettre de les réaliser de façon plus apprivoisée que dans la solitude totale.
Thierry Jonquet: Ce qui me frappe tout de même dans ces pratiques, en particulier les plus extrêmes, c'est la rapidité de leur diffusion, la souffrance qu'elles impliquent et le fait qu'elles soient le plus souvent données en spectacle. Il y a une vingtaine d' années, les artistes du body art, Gina Pane par exemple, dont une des performances consistait à escalader pieds nus les barreaux d'une échelle hérissée de picots, apparaissaient comme des marginaux. Et s'ils avaient constitué une sorte d'avant-garde ? Je lisais récemment dans VSD un reportage sur une jeune fille tatouée et piercée des pieds à la tête, qui expliquait tranquillement, sans émouvoir le moins du monde son interlocuteur journaliste, qu'elle allait bientôt se faire suspendre à des crochets parce que c'est le top de la démarche. Quant aux séances de branding, ces marques obtenues par application au fer rouge ou au laser, qui se déroulent en public, de quoi s'agit-il sinon de séances de torture ?
David Le Breton : Torture, je ne sais pas, dans la mesure où le protagoniste est consentant. Il y a pour moi, une différence essentielle entre la douleur et la souffrance. A partir du moment où l'on choisit délibérément l'épreuve qu'on s'inflige, on n'est plus dans la souffrance. On reste dans la douleur, mais on la regarde en quelque sorte dans les yeux. C'est cela que nous disent les sportifs de l'extrême, les artistes du body art ou les jeunes qui pratiquent le branding : tu regardes la douleur, mais tu restes au-delà. La souffrance apparaît quand on perd son rapport à la douleur, c'est-à-dire quand elle est infligée par un autre, comme dans la torture ou la maladie.
Thierry Jonquet: Reste tout de même le problème des spectateurs, dont les motivations me paraissent troubles. Que cherchent-ils, ceux qui se pressent par milliers aux expositions de Gunther von Hagens ? S'ils font la queue des heures durant ce n'est pas pour voir des figurines ou des cires anatomiques. Ils savent bien qu'ils vont avoir affaire à d'authentiques cadavres.
Télérama : Que voulez-vous dire ? Qu'un certain nombre d'interdits majeurs sont en train de s'effriter?
Thierry Jonquet : Oui, je crois. Quand le cadavre devient un spectacle, il y a une rupture dans notre civilisation. Une perte du respect du corps, et par conséquent de la vie.
David Le Breton : Pour moi, c'est le respect de l'homme lui-même qui est en cause, parce que la condition humaine est une condition corporelle. Nous sommes notre corps. Quand on apprête des cadavres, quand on les découpe ou les écorche pour les mettre en scène, on est dans une désacralisation radicale non seulement du corps et de la mort, mais aussi de l'homme, qui devient une sorte de relique dérisoire et grotesque. Vous parliez de rupture, je crois que nous sommes aujourd'hui confrontés à de multiples ruptures anthropologiques. La première, qui remonte à la Renaissance et au début de l'anatomie, a consisté à ouvrir le corps de l'homme sans se poser de questions éthiques, c'est-à-dire avec pour seul souci celui de faire progresser la connaissance de la médecine. La seconde rupture vient avec les greffes, cet échangisme des organes qui conduit l'homme à se regarder autrement : la vision du corps devient essentiellement instrumentale.
Thierry Jonquet : Le refus contemporain du vieillissement me paraît également constituer une rupture, toutes ces promesses de la médecine, les hormones miracles qui devraient multiplier les centenaires poussent à la négation des limites humaines. C'est l'accélération vertigineuse du progrès technique qui pose finalement problème. Voyez encore l'exemple du clonage. Les sociétés ne sont pas prêtes, elles n'évoluent pas aussi vite que les techniques.
David Le Breton : La question est alors celle de la transmission. Que transmettre aux nouvelles générations d'un monde qui change si vite ? Sans doute faut-il refuser ce culte de la vitesse, cette valorisation contemporaine du changement pour le changement, qui consiste à ériger en valeur fondamentale le principe même du monde libéral, l'obsolescence de la marchandise. La valeur fondamentale, pour moi, c'est au contraire la flânerie : prendre son temps, faire la sieste, lire, marcher, converser les yeux dans les yeux avec ses amis...
Thierry Jonquet : J'aime l'idée de finir sur cet éloge de la flânerie. C'est complètement subversif !
Dans la presse