On ne peut écrire sur sa vie qu'en racontant celle des autres, constate Esteban qui retrouve à travers la vitre enneigée de son appartement parisien les fantômes de son enfance et de la Colombie des années 60. Et il nous raconte l'histoire de Tonio, amoureux de Delia mais incapable de résister aux avances de Cory; celle de Blas, le curé espagnol qui va de révolution en révolution jusqu'à trouver celle qui le change; celle du garçon qui rejoint la guérilla; celle de Federico, l'expert en suicide; celle de Daperti le joueur, élégant jusqu'à la fin; toute une série de portraits et de vies qui forment la trame de celle de notre héros.
Puis on quitte la Colombie pour l'Italie et l'Espagne, où le jeu d'échecs et un joueur exceptionnel enseignent à Esteban une leçon fondamentaie: gagner une partie, ce n'est pas mal, mais ce qui est indispensable, c'est d'y prendre du plaisir.
Santiago Gamboa reprend avec talent la tradition du roman de personnages et des histoires intercalées, pour démontrer brillamment qu'un écrivain ne peut se construire qu'à tràvers les autres.
-
"Dans un petit appartement de banlieue parisienne, Esteban Hinestroza, un écrivain colombien de 34 ans, médite sur son existence. Il vit de sa plume, au sens large du terme. Ses reportages radiophoniques et ses articles pour la presse écrite se convertissent plus facilement en espèces trébuchantes que ses romans. Mais Juan Goytisolo, l'un de ses écrivains favoris, n'affirme-t-il pas que " quand on vit de ses livres, on finit par publier des âneries " ! Fort de cette maxime et calfeutré entre les piles de livres qui envahissent la pièce, Esteban se laisse doucement envahir par ses souvenirs. C'est d'abord l'enfance à Medellin - celle d'avant les narco-traficants - entre Pablito le frère aîné, les parents, deux universitaires passionnés de beaux-arts et de littérature, et Délia, la jeune bonne. Ce sont ensuite des déménagements à Bogotà puis à Rome, avant Madrid où Esteban débarque seul pour entreprendre des études de philologie. Chaque période est empreinte de nouveaux apprentissages, de nouvelles quêtes de sens et de rencontres qui rendent le quotidien fascinant. Car, dans cette famille unie et anticonformiste, la vie elle-même est un art, peut-être même l'Art majeur par excellence. Proche de l'autobiographie Aujourd'hui, un roman évoquant la douceur de vivre en Colombie - qui plus est à Medellin - fait figure d'événement rare. D'autant que chez Santiago Gamboa, l'autobiographie nourrit la fiction. La relation " vie-littérature " qui a déstabilisé, voire traumatisé, plus d'un romancier semble pour le Colombien un facteur d'équilibre et de sérénité ! Aussi est-on porté à croire qu'il a lui-même expérimenté l'une des " joyeuses idioties " tentées par Esteban, alors apprenti écrivain: convaincu que ses personnages manquent de chair, le jeune homme n'hésite pas à les incarner, à penser, à se mouvoir et à agir comme eux! Dans son dernier roman, la biographie du " héros " et la sienne se confondent. Mais c'est à partir des histoires de multiples personnages secondaires - imaginaires ? - que Gamboa file la trame de l'histoire d'Esteban. Il y a là Tonio, l'amoureux déçu qui trouve sa voie dans la guérilla, Blas, le curé de gauche qui, de révolution en révolution, atteindra la plénitude à travers l'amour d'une femme. Puis Federico, expert en suicide, ou Rodolfo, étrange exilé argentin passionné par le jeu d'échecs. " On ne peut écrire sur sa vie qu'en racontant celle des autres ", constate d'ailleurs Esteban. A l'aube de la maturité, il a compris que " pour écrire il fallait vivre " et que pour vivre il fallait savoir reconnaître et saisir le bonheur. La traduction littérale du titre original est en cela tout à fait éloquente : " Vie heureuse d'un jeune homme nommé Esteban ".Alexie LorcaLIRE
-
"Il nous avait fait rire avec Perdre est une question de méthode, nous avait entraînés dans d'incroyables aventures chinoises avec les Captifs du lys blanc, voilà qu'il nous emmène par les chemins du roman d'apprentissage avec Esteban le héros. Soit Esteban, le héros du roman, un écrivain colombien de 34 ans vivant en France, qui se penche sur son passé. L'occasion de croiser une foule de personnages. Une tranche d'histoire de l'Amérique latine, servie encore frémissante sur un ton un rien picaresque. Pas de doute, les " enfants " des immenses Garcia Marquez et Carlos Fuentes sont à la hauteur...Alexis LiebaertMARIANNE
-
« L'imagination au pouvoir. Polar, érotisme, politique : S. Gamboa se joue de la narration, prouvant que la littérature est bien le lieu de tous les possibles. »Dominique AussenacLE MATRICULE DES ANGES
Je vis de ma plume. Émissions de radio et articles pour la presse écrite, surtout. Mais aussi des romans car, toute honte bue, j'ai des ambitions littéraires. J'écris tous les jours car j'ai lu que c'est ce qu'on fait quand on est écrivain, même si la majeure partie des pages que je noircis finissent à la corbeille et que je n'en garde que quelques-unes, celles qui plaisent à ce lecteur cruel qui habite chacun de nous et qui est le premier à détruire ce que l'autre, le travailleur ingénu, lui présente chaque jour. Foin de prétention, je préfère le dire clairement: je ne vis pas des romans que j'écris - j'en ai fait deux - mais des articles de presse et des émissions de radio, ce qui est une autre manière d'écrire et de vivre. En gagnant ainsi ma vie, je nourris l'écrivain timide et vulnérable, incapable de vivre de ce qu'il fait, mais dont le seul fait qu'il existe donne à l'autre une raison de sortir du lit tous les matins sans se demander pourquoi il se lève puisqu'au bout du compte, le soir, il devra se recoucher.
Je vis dans un appartement de la banlieue parisienne, un vaste espace plein de livres et aux murs nus, dans ce désordre dont on marque les endroits qu'on habite : des chemises pendues aux dossiers des chaises, des cendriers avec trois mégots en voie de fossilisation, des enveloppes de courrier qu'on n'a pas ouvertes et des verres d'eau à moitié pleins qui dorment du sommeil du juste à côté du lit. Les livres s'amoncellent dans les endroits les plus incongrus et voilà bien longtemps que j'ai renoncé au vieux rêve de les ranger par ordre alphabétique. Passé l'âge de trente ans, on a accumulé des habitudes délicieuses et inutiles: frimer une cigarette sur le balcon en contemplant l'autoroute qui va vers Orly ; fixer son regard sur les signaux lumineux des avions en imaginant qu'à bord se passent de fabuleuses histoires dont on ne sait rien, des moments de vie intime et de bonheur ; préparer des cocktails sophistiqués ; fouiner chez les marchands de livres d'occasion à en rendre fous les bouquinistes et arriver en retard partout. Des habitudes sans intérêt qui cependant enjolivent le cours d'une vie et lui donnent un sens.
Revenons à la façon dont je gagne ma vie. Un soir, il y a quelques années, j'ai entendu le romancier Juan Goytisolo dire qu'il n'était pas sain pour un écrivain de vivre de ses livres, arguant du fait que l'indépendance consiste à dire et à faire ce que l'on a envie de dire et de faire et qu'il n'y a rien de tel pour cela que d'avoir un travail parallèle. "Quand on vit de ses livres, on finit par publier des âneries, disait Goytisolo d'une voix lente et avec cet air sempiternellement impénétrable, et par vivre le nez collé sur les listings de ventes, à ne plus lire que les succès de librairie pour les imiter." Dans mon cas, le problème ne se pose pas puisque ce que me rapportent mes livres me paye tout juste un voyage ou deux en Colombie, me permet de ne pas faire trop mauvaise figure devant mes éditeurs et d'inviter mes amis à boire un verre dans un bar ou de changer les amortisseurs de ma vieille Volkswagen.
Quand je suis arrivé à Paris, il y a plus de sept ans, je rêvais de mener une vie régulière et paisible. Je voyais des hommes en pardessus, au volant de leur voiture ou bien arpentant les trottoirs d'un pas décidé, et je me demandais quand viendrait mon tour d'être comme eux: des gens qui trouvent des pièces de dix francs dans des vestes oubliées dans le fond de leur penderie, qui appellent le Crédit Lyonnais pour connaître le solde de leur compte et le notent sur leur agenda comme si c'était le numéro de téléphone d'une inconnue. Moi, je n'avais rien. Que des projets et des rêves. J'avais envie de préparer un doctorat à la Sorbonne et, surtout, l'aspiration secrète de devenir écrivain, ce pourquoi j'avais dans ma valise un gigantesque manuscrit sans titre que j'avais commencé à rédiger en Espagne. C'était un monstre de plus de sept cents pages, ambitieux et irresponsable, que j'avais écrit parce que j'avais cru en ce que disait Vargas Llosa, que l'inspiration n'existe pas, qu'écrire est affaire d'obstination, de patience pour attendre ce qui n'arrive presque jamais, de générosité devant cette créature égoïste qu'est le texte, ce tyran à masque de bouffon qui s'assied sur ton épaule et qui n'hésite pas à rire de tes rares et précieuses trouvailles. Lecteur cruel, piètre critique. J'aurais donné ma vie, et je la donnerais encore, pour que Vargas Llosa ait raison car je n'ai jamais senti la moindre manifestation de génie, rien qui puisse faire supposer que ce que j'écris ait une quelconque importance, soit un peu original ou innovant, s'avère capable de révolutionner le goût classique ou de créer une forme nouvelle... Le problème de l'écriture, quand on est étudiant en littérature, c'est qu'on a tendance à théoriser d'avance ce que l'on n'a pas encore écrit ou, dans le meilleur des cas, ce que l'on a mal écrit. A faire des études de lettres, on acquiert un tel sens critique que rien de nouveau ne peut plus surprendre, accablé qu'on est sous le poids des idées acquises dans les manuels d'esthétique. J'ai lutté contre cette tendance et je ne sais pas si je suis parvenu à m'en libérer mais je sais que c'est ce combat qui m'a permis de continuer à écrire. Il m'a appris qu'avec un peu de discipline tout était possible. Qu'il fallait surtout avoir le courage de rompre avec tout ce qui n'est pas solidement fondé, sans état d'âme, de rejeter l'arrogance de celui qui croit tout savoir à propos d'un domaine où, par ailleurs, il n'est pas capable de se montrer créateur.
Le temps a passé et les choses ont changé. D'une manière que je soupçonnais déjà et qui est impitoyable: on obtient ce que l'on veut quand l'objet désiré ne nous fait plus rêver. J'ai lu un jour cette phrase: "Quand j'ai eu les réponses, mes questions avaient changé." J'ai maintenant une Volkswagen, un pardessus, un travail stable - je suis fonctionnaire de l'État français - travail qui m'amènera, sauf coups durs, jusqu'à l'âge de la retraite, et pour mes voisins, je suis devenu le paisible M. Hinestroza. Dans mon portefeuille dorment quelques cartes de crédit que j'utilise plus que je ne le devrais mais qui me permettent sans problème d'atteindre la fin du mois. J'ai écrit deux romans qui me redonnent du courage, quand les mots se coincent et surtout quand je me rends à l'évidence que je ne suis plus le jeune homme timide que j'ai été. Je voyage beaucoup et j'achète tous les livres dont j'ai envie mais il m'arrive, quand je me retrouve tard dans la nuit au volant de ma Volkswagen sur une autoroute et que mes yeux se fixent sur les lignes blanches tracées sur l'asphalte, de penser à la vie, à la distance qui sépare mes rêves d'antan de ce que, tant bien que mal, je suis devenu et de ce qui m'appartient. Et il ne se passe rien. Il n'y a pas une voix pour me dire: "C'est parfait ! ", ou qui me critique et me fasse des reproches. Aucun enthousiasme. Une certaine résignation. Ce même sentiment d'arriver trop tard à quelque chose de magnifique que je n'avais pas pressenti alors qu'il n'y avait rien et que je n'étais arrivé nulle part. Et je me répète ces vers si vrais de Gil de Biedma : "Et c'était la vraie vie qui passait / voilà ce que trop tard l'on apprend." Mais je ne veux pas trop m'avancer et, pour reprendre ce que dit Dostoïevski: "Nous en viendrons à ce moment particulier plus tard."
Ces jours-ci, il fait très froid à Gentilly, c'est le nom de ma banlieue, et toute la semaine il a neigé. De ma fenêtre, je vois les toits tout blancs des immeubles et la seule chose qui me gêne dans ce paysage magnifique, c'est que je ne peux pas sortir fumer sur le balcon. La neige bloque la porte et mes souliers prennent l'eau. Je n'ai plus qu'à rester à l'intérieur et à regarder à travers le carreau mais j'ai beau faire, je ne vois que des visages anciens et ne parviennent à mon oreille que des voix silencieuses sorties d'un passé pourtant pas si lointain.
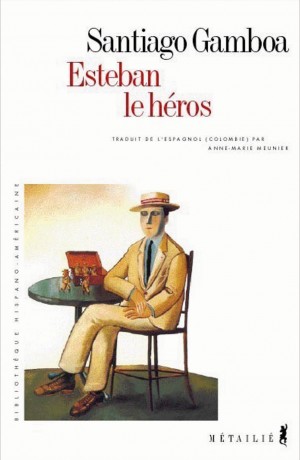

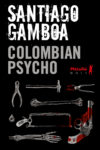

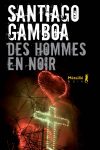





-100x150.jpg)

-100x150.jpg)