Bogotá est assiégée depuis des mois. Le gouvernement a fui à Carthagène, la guérilla contrôle le sud de la ville et affronte l’armée et les paramilitaires. Tandis que les obus pleuvent sur la ville, deux journalistes étrangers, la belle Islandaise Bryndis Kiljan et le Maltais Olaf K. Terribile enquêtent sur une sombre histoire de trafic d’armes entre la guérilla et l’armée, dont les ramifications les guideront à travers une Bogotá clandestine jusqu’aux clés d’un conflit inextricable.
Dans une deuxième histoire un jeune homme facile se laisse séduire par des hôtesses de l’air qui vont faire de sa vie un enfer.
De l’humour à l’érotisme en passant par le suspense, Santiago Gamboa maîtrise les registres les plus divers et montre une fois de plus son originalité irréductible.
-
Cette nouvelle n’est pas tant une dénonciation facile de la conjecture pourrie de la Colombie qu’une caricature volontairement grotesque des correspondants de guerre shootés à l’adrénaline et prêts à tout pour quatre colonnes de sensationnel.(Page des libraires)
Michel Edo
-
« Une réussite incontestée. Le colombien, ancien journaliste à l’AFP devenu diplomate, sait trouver les mots pour camper caractères et ambiances et les dialogues sont décapants. »Jacques KaufmannA-LIRE.INFO -
« Il y a un peu de cela : "Deux petites perles fichtrement agréables, rafraîchissantes et mêlant d’une manière remarquable, réalisme, sexe, humour et violences plus ou moins barbares." Et beaucoup d’autres choses dans les deux nouvelles regroupées dans Le siège de Bogota de Santiago Gamboa. »
Nicolas Gary
ACTUALITTE.COM -
« […] n’hésitez pas à vous plonger dans ces deux récits : le premier vous fera réfléchir et captera votre attention, et le deuxième vous rendra le sourire même si finalement, il ne se terminera pas forcément comme on se l’imagine… »Sarah ChellyLIVRES-A-LIRE.NET
-
« Chez Gamboa les guérillas sont foireuses et les aventures amoureuses pourrissent la vie. »
Frédérique BréhautLE COURRIER DE L’OUEST/LE MAINE LIBRE -
« A travers deux fictions aux allures de polar débridé, l’écrivain colombien dépeint avec humour les luttes de pouvoir et la faiblesse humaine. »
Karin SoulardOUEST France -
« Santiago Gamboa serpente dans ce microcosme armé avec une aisance redoutable. On le suit dans ce jeu de piste en temps de guerre. Fable ? Sans doute. Fiction ? Moitié-moitié. Narrateur hors-pair, Gamboa fait preuve d’une imagination assise sur des bouts de réalité. Les personnages secondaires, les seconds rôles en quelque sorte, forment un bataillon hétéroclite. Ce court roman détonne, surprend, captive : que demander de plus ? »
Benoît Delmas
COURRIER INTERNATIONAL -
« Quelque chose entre Henry Miller et Enrique Vila-Matas. […] Une sorte de politique-fiction menée tambour battant. » Lire la suiteThierry ClermontLE FIGARO LITTERAIRE
1
Bryndis Kiljan, correspondante de guerre au Ferhoer Bild de Reykjavik, ouvrit les yeux et comprit qu’elle avait forcé sur la bouteille en réalisant deux choses : premièrement, qu’elle n’était pas dans sa chambre, et deuxièmement qu’elle était toute nue. Elle fit un effort de mémoire mais son esprit brumeux refusa de réagir, et l’espace d’un instant un sentiment de culpabilité dévastateur se mêla à la migraine. Elle se retourna mais ne vit personne d’autre dans le lit, ce qui la soulagea un peu. Elle vit sa culotte au pied d’un petit canapé, et ses autres vêtements sur le tapis. Il y avait des odeurs de tabac et de vodka, et aussi de transpiration. Elle eut la nausée. Avec qui elle était ? Impossible de se le rappeler. Ses souvenirs n’allaient pas au-delà du dîner, quand elle était partie boire avec un groupe de journalistes qui venaient d’arriver à Bogotá. Sur la table, elle vit un paquet de préservatifs Durex entamé et, plutôt rassurée, elle se dit que même dans les plus terribles soûlographies elle conservait le sens des priorités.
Soudain, elle entendit un bruit dans la salle de bains : quelqu’un avait tiré la chasse d’eau et se lavait les mains. Elle pensa qu’elle découvrirait l’identité de son amant quand la porte s’ouvrirait, et elle n’en fut que plus intriguée. C’était Eva Vryzas, la photographe de l’agence Komfax, de Lituanie.
– Salut Bryndis, dit Eva, nue elle aussi. Tu as mal à la tête ? Pardi, hier soir tu as bu comme une pute de Minsk. Tu avais oublié le numéro de ta chambre et je n’ai pas trouvé la clé dans ton sac, alors je t’ai amenée dans la mienne.
– Mais… dit Bryndis. Pourquoi je suis toute nue ? Est-ce que… ?
– Non, ne t’inquiète pas, répondit Eva. Les préservatifs n’ont rien à voir avec toi. C’est moi qui les ai utilisés. Tu dormais si profondément que tu ne t’es rendu compte de rien. La personne qui m’a aidée à te porter s’est un peu attardée. Tu étais si lourde que j’ai bien été obligée de lui donner un petit pourboire, hi hi !
– C’était qui ?
– Ah, ça, secret professionnel ! Tu es toute nue parce que tu as insisté pour aller aux toilettes avant de dormir, mais personne ne t’a touchée, tu peux me croire. Et puis, c’était très amusant de le faire à côté de toi. J’ai senti que tu étais solidaire. Tu ronflais.
– Je t’assure que je ne me souviens de rien, dit Bryndis.
– Et moi je préférerais ne pas m’en rappeler, répliqua Eva, mais j’ai une forte irritation. Le type d’hier soir était un vrai fauve, un chimpanzé avec un membre d’éléphant.
Le claquement d’un obus les ramena à la réalité. Elles tendirent l’oreille pour écouter l’écho des tirs. Par rafales.
– Debout, lança Eva. La guerre nous attend.
Bryndis se leva en râlant et elle vit trente-six mille chandelles. Elle sortit un poudrier de son sac.
– Tu en veux ?
Elles sniffèrent quatre lignes de cocaïne, toujours nues, les cheveux blonds encore humides de la transpiration de la nuit, et remirent un peu d’ordre dans la pièce. Elles ne pouvaient ouvrir les fenêtres pour évacuer les relents aigres d’alcool, de sexe et de sueur, car les francs-tireurs, postés sur les immeubles des hauteurs, auraient pu les voir. Ils ne tiraient presque jamais sur l’hôtel, mais il valait mieux ne pas leur donner l’occasion de commencer. À l’extérieur, les Colombiens s’entretuaient et les deux femmes, de jolies journalistes connues pour leurs chroniques de guerre, n’étaient pas en forme. Eva prit un tube de crème, versa sur ses doigts un liquide poisseux et en enduisit l’intérieur de ses cuisses, ce qui parut la soulager presque immédiatement. Bryndis alluma une cigarette, s’empara d’une bouteille de vodka à moitié vide oubliée sous le canapé, en but une gorgée et prépara une autre ligne de poudre blanche.
– Je vais prendre une douche dans ma chambre, dit Bryndis. Et encore merci. Tu es une vraie copine. Ça va mieux ?
– Oui, ça va passer.
– Tu ne veux pas me dire qui… ?
– C’était agréable sur le moment, répondit Eva. Mais je ne te le dirai pas, sauf si c’est nécessaire.
– Je suis ravie que tu n’aies plus mal. À tout à l’heure.
Le couloir de l’hôtel Tequendama, à cette heure matinale, était une galerie spectrale d’ombres et
de lumières. On avait recouvert les fenêtres d’une toile goudronnée pour qu’on ne puisse pas voir
à l’intérieur, mais le soleil s’infiltrait par les interstices, comme des giclées de lumière qui ressemblaient à des rayons artificiels, à des lampes au fond d’une caverne.
Bogotá était assiégée depuis sept mois. Les forces de la guérilla avaient réussi à s’emparer de la zone sud, établissant un front sur l’avenue des Comuneros, ce qui leur permettait de contrôler un tiers de la ville, et surtout l’autoroute sud ; côté ouest, ils occupaient l’avenue Boyacá et une partie des collines de Suba, et à l’est les collines de
Guadalupe, Monserrate et El Cable. Au nord, les premières tranchées commençaient à l’échangeur du Tercer Puente. Bogotá était encerclée. Au moins trois millions d’habitants avaient fui vers les régions gouvernementales, c’est-à-dire les zones côtières des Caraïbes.
Du haut de leurs positions dans les collines, avec des nids de mitrailleuses et de lance-grenades, avec des bombonnes de gaz bourrées de boulons – une arme non conventionnelle, dénoncée par les envoyés des Nations Unies, que la guérilla continuait d’utiliser en souvenir du début du conflit –, les séditieux exerçaient un contrôle stratégique sur tout ce qui se passait à Bogotá. L’armée se défendait bec et ongles, mais les armes faisaient cruellement défaut. Le gouvernement s’était enfui à Cartagena des Indes et menait des dialogues de paix avec la direction de la guérilla, en dépit du pessimisme ambiant. Régulièrement, l’aviation bombardait les positions de la guérilla sur les collines, ce qui apportait
de brèves périodes de calme, mais il lui était impossible de lâcher des bombes sur les fronts urbains.
Les paramilitaires, qui se battaient avec les milices civiles contre la guérilla mais aussi contre l’armée nationale, s’étaient emparés de l’aéroport El Dorado, et la presse internationale était obligée de passer par eux pour obtenir un visa et atterrir à Bogotá dans un des avions des Nations Unies qui livraient le matériel de l’aide humanitaire. On racontait des histoires horribles sur la zone qu’ils contrôlaient, transmises par Bryndis et Eva à leurs organes de presse respectifs : des syndicalistes pendus par la langue aux poteaux télégraphiques, des leaders communaux émasculés, des enseignants de gauche fusillés après des tortures terribles : l’un d’eux avait eu le pénis tranché d’un coup de rasoir, ce qui avait fait vomir Bryndis pour la première fois.
Sur les fronts où s’opposaient les paramilitaires – surnommés les “paras” – et la guérilla, il y avait aussi des atrocités épouvantables. Les paras avaient inventé une catapulte qui leur permettait de projeter des cadavres à quatre ou cinq cents mètres sur la zone ennemie. Chaque fois qu’ils s’emparaient d’un syndicaliste, d’un espion ou de tout individu suspecté d’avoir un passé de gauche, celui-ci était exécuté et catapulté dans le camp ennemi, le corps bourré de grenades.
La place de Bolívar était un terrain vague semé de cratères et de décombres, car la lutte y avait été rude. Le Capitole national, le Palais de justice et la Casa de Nariño, résidence du gouvernement, avaient les tripes à l’air. Les gens, dans une réaction de désespoir suprême, avaient mis à sac ce qui restait des anciens bureaux et des vastes salons de réception. Dans ces ruines, les mendiants se protégeaient de la pluie et du froid en faisant du feu avec les vieux dossiers. Au début de la guerre, le gouvernement avait tenté de défendre le siège historique, ce qui avait avivé la destruction. Une pluie de bombes était tombée des montagnes, il y avait eu des attentats aveugles, on avait mitraillé sans pitié le centre-ville jusqu’à ce qu’il ne reste plus âme qui vive. L’armée parvint à repousser les attaques, mais l’ancienne zone du pouvoir
fut réduite en cendres, un paysage lunaire de décombres, des murs noircis de fumée, troués par la mitraille, des structures métalliques tordues par le feu. Dans l’éclat des incendies, les flammes étaient montées si haut que certains habitants se rappelèrent les événements du 9 avril 1948, date de destruction mémorable du milieu du siècle précédent.
Dans l’escalier de service de l’hôtel – le seul utilisé, car les ascenseurs étaient en panne –, Bryndis rencontra Olaf K. Terribile, correspondant du journal The Presumption, de l’île de Malte.
– Salut, Bryndis, tu as bien dormi ? l’interpella Olaf en la caressant du regard. En dépit de sa timidité, il était attiré par cette belle blonde.
– Je ne suis pas certaine d’avoir dormi, Olaf. Ma tête ressemble à un obus sur le point de toucher terre.
– J’ai de l’aspirine, tu en veux ?
– Non. Une aspirine n’atteindrait même pas la périphérie de ma migraine. Le travail est la seule chose qui puisse me guérir.
– Prends garde, Bryndis. Essaie de ne pas te tromper de tranchée.
– Ne t’inquiète pas, tu sais bien que la poudre a peur de moi.
Olaf et Bryndis se connaissaient depuis quatre guerres – Afghanistan, Palestine, Irak et Somalie –, mais Olaf n’avait jamais osé lui avouer ses sentiments, encore moins lui proposer le moindre contact intime, et pourtant ils avaient vécu ensemble des moments difficiles, comme le jour où Bryndis avait dû le porter debout, inconscient, et le hisser dans une camionnette de location, à Jalalabad, après qu’ils avaient été roués de coups par un groupe de manifestants afghans. La timidité, chez Olaf, semblait être un trait congénital. Il n’y avait pas longtemps, au Belize, il avait eu recours à une assistance psychiatrique. Pour le test d’identité, il avait répondu ceci :
“Je m’appelle Olaf Keith Terribile et je suis correspondant de guerre. J’ai vécu à Moscou, Nicosie, Goma et Nairobi, en plus de La Valette, capitale de Malte, ma ville natale. Je parle six langues de la branche indo-européenne. J’ai quarante-six ans et je porte des lunettes, car je suis affligé d’une forte myopie. Ma couleur préférée est le vert, car il symbolise l’espérance. Je suis veuf et je n’ai pas d’enfants, un euphémisme pour suggérer que je suis plus seul qu’une pierre dans le désert, en admettant que les pierres puissent se sentir seules. J’ignore l’origine de
ma timidité. J’ai eu une enfance heureuse et agréable. Je n’ai jamais manqué de rien et n’ai jamais eu de gros soucis ; je n’ai jamais été regardé avec indifférence par ceux que j’aimais. La mer m’attire beaucoup, même si elle m’inquiète. Je ne supporte pas le lait. Mon plat préféré est le couscous, et tout de suite après, le canard laqué pékinois. Je n’ai pas de tendances homosexuelles. Je me suis épris tout jeune d’une étudiante d’anglais polonaise, à Malte, qui est devenue mon épouse. Elle s’appelait Myla, et je dis ‘s’appelait’, parce qu’elle est morte au bout de six ans de mariage. Myla Posvlo. Elle est morte en donnant le jour à celle qui aurait dû être notre fille. C’est alors que j’ai sollicité une première assistance psychologique et que j’ai demandé à être correspondant de guerre au Presumption. La mort est entrée dans ma vie. Je ne l’ai pas cherchée. Depuis ce jour, je l’ai vue à l’œuvre.”
Olaf se trouvait à Bogotá depuis quatre mois et ses articles étaient lus avec intérêt par ses compatriotes, qui ne savaient pas grand-chose de ce lointain pays en guerre. C’était un professionnel sérieux et mesuré. Un homme qui faisait son travail avec application et qui dormait la conscience tranquille. Mais il avait besoin de quelqu’un à ses côtés. Et ce quelqu’un, disait-on, pourrait bien être Bryndis Kiljan, qui ressemblait tellement à Myla, aussi forte et courageuse qu’elle.
En s’éloignant d’une barricade de la 7e Rue, en face de l’hôtel Tequendama, Olaf fut étonné de voir un car renversé au bord de la voie : il devait avoir brûlé toute la nuit, car il était passablement roussi, malgré la pluie, et quelques flammes léchaient encore la carrosserie, dont l’arrière était déjà tout noir.
– Que s’est-il passé ? demanda-t-il en espagnol à un soldat en lui offrant une cigarette.
Si Olaf avait su déchiffrer les uniformes de l’armée, il aurait remarqué que le soldat avait le rang de caporal-chef. Il n’était plus tout jeune. Et n’était ni mince ni athlétique.
– Il n’a pas respecté le couvre-feu, répondit le militaire. Je crois que ce sont les nôtres qui ont tiré sur lui. Je crois.
Olaf se caressa le menton. Il sortit un petit carnet et un stylo-bille, inscrivit la date et l’heure en haut de la page et prit quelques notes.
– Des morts ? insista-t-il.
– Non, seulement deux blessés. Apparemment il roulait à vide.
– Il allait vers le sud ?
– Oui, je crois. Je suis arrivé une heure après, et c’est ce qu’on m’a dit.
Olaf releva la tête et vit, sur le sol, la trace du coup de frein. Deux lignes de caoutchouc parallèles qui décrivaient un S et mouraient à côté des fers tordus.
– C’est bizarre, non ? songea Olaf à haute voix.
– Oui. Sortir en bus en plein couvre-feu et filer vers le sud, dans la gueule du loup, c’est bizarre.
– Et les blessés ?
– Ils sont en état d’arrestation.
Olaf allait demander s’ils étaient colombiens, mais la question lui parut stupide. Tous, dans cette guerre absurde, étaient colombiens.
– On les soupçonne de quelque chose ?
Le soldat lui lança un regard ironique. Puis
il scruta les deux côtés de l’avenue. Un groupe
d’officiers discutait au carrefour dans un nid
de mitrailleuses, le seul qui protégeait l’entrée de l’hôtel.
– C’est une question trop délicate pour une seule cigarette.
Olaf en prit deux, les glissa dans la poche de sa chemise et lui donna le paquet. Le militaire les compta, en alluma une et dit :
– S’ils ont été arrêtés, c’est qu’on les soupçonne de quelque chose, vous ne croyez pas ?
Olaf le dévisageait toujours, sans affirmer ni nier. Son visage semblait dire : “Un peu plus, vous devez m’en dire un peu plus.”
– Il semble, et que ce soit bien clair, enchaîna son interlocuteur, il semble, ou il semblerait qu’il s’agissait de soldats qui emportaient des armes pour les vendre à la guérilla.
– Des armes gouvernementales pour la
guérilla ? demanda Olaf sur un ton purement rhétorique. Voilà qui est intéressant. Ils ont pris des armes et ensuite ils ont détruit le car ? Ça s’est passé comment ?
Le soldat se rapprocha d’Olaf.
– Je réponds à cette question et on en reste là, compris ?
De nouveau il lança un coup d’œil à la ronde. La pluie s’était transformée en averse ; une petite rigole nettoyait le macadam.
– Oui, compris, dit Olaf. Je saurai payer l’information que vous me donnerez, si elle en vaut vraiment le coup.
– Le car roulait sans lumières, mais on a tiré dessus du haut de la colline. C’est les guérilleros qui l’ont eu, faut vraiment être con ! Peut-être que ceux du front de Monserrate n’étaient même pas au courant. En tout cas, c’est une drôle d’histoire.
– Si vous me trouvez des informations, je vous les achète, dit Olaf. Par exemple : qui a vraiment tiré, qui était dans le car ; si ce sont des militaires, de quel grade ; s’ils allaient vendre des armes, quel était leur prix… Ma chambre est la 1124. Je m’appelle Olaf K. Terribile. Je suis maltais.
– Maltais ? s’étonna le soldat. Ça veut dire quoi ?
– Juste que je viens de très loin, cher ami. N’oubliez pas, chambre 1124.
Le soldat le regarda s’éloigner. Peu après arriva un lieutenant, ce qui l’obligea à se mettre au garde-
à-vous et à saluer en claquant des talons et en portant une main à la tempe.
– Caporal-chef Emir Estupiñán, mon lieutenant, au rapport qu’il n’y a rien à rapporter, mon lieutenant !
– Repos, caporal, et n’appliquez pas le règlement au pied de la lettre. Vous êtes réserviste ?
– Oui, mon lieutenant, réserviste de troisième niveau. Avant la guerre, j’étais fonctionnaire dans les services du cadastre. Vu ma formation, on m’a donné le grade de caporal-chef.
– Je vous en félicite, caporal. Ainsi, vous servez votre pays.
– Merci, mon lieutenant, mais sauf votre respect je préférerais continuer de le servir derrière mon modeste bureau de fonctionnaire. Si je suis ici, c’est par obligation.
– Nous voudrions tous retourner à la vie d’avant, caporal, dit son supérieur. Mais une guerre exige des sacrifices.
– Une question, mon lieutenant, si ce n’est pas indiscret, dit Estupiñán. Vous croyez qu’on va la gagner ? Je veux dire, la guerre ?
– C’est comme une partie de billard, caporal. On peut manquer cinq caramboles de suite et gagner ensuite en une seule reprise. On ne sait jamais avant la fin. Voilà pourquoi il faut être très concentré. Comme dans la vie.
– Bon exemple, mon lieutenant, dit Estupiñán. Vous auriez, par hasard, une formation supérieure ? Ce que j’en dis, c’est à cause de la précision de votre commentaire.
Le lieutenant lissa sa petite moustache, laissa échapper un sourire de fierté et poussa du pied un bout de ciment dans le ruisseau qui coulait le long du trottoir.
– J’ai toujours été bon en philosophie, caporal. Merci du compliment.
Le caporal Estupiñán rattrapa son supérieur et leva un doigt.
– Lieutenant, lieutenant… Je ne suis pas aussi bon que vous en philosophie, mais je suis fasciné par les énigmes. Ce car renversé, il transportait des armes, n’est-ce pas ?
– Oui, caporal. Quelle honte ! Si ce n’était pas pour le respect que je dois à cet uniforme, je ficherais le camp, dit-il, choqué. Des compagnons, et même des supérieurs, qui vendent des armes à l’ennemi ! Incroyable.
– Vous avez raison, lieutenant. Il faudrait des gens comme vous au commandement, sauf votre respect, déclara Estupiñán avec emphase. Des gens qui aiment leur pays. Et dites-moi, c’est qui, les détenus ?
– Deux malpropres, des pauvres types. Dommage qu’ils n’aient pas été tués, ils le méritaient. En plus, ils portaient l’uniforme.
– Oui, ils l’auraient mérité, lieutenant, mais l’avantage qu’ils soient en vie c’est qu’on peut leur soutirer des noms. Ils sont à Cantón Norte, la zone militaire ?
– Oui, ils sont là-bas, à l’hôpital, répondit le supérieur. Une seule chose me rassure, et vous savez laquelle, caporal ? De savoir que ces salauds de guérilleros sont pires que nous. Rendez-vous compte, ceux du front de Monserrate étaient au courant, pour le car ; et ils ont tiré pour que le front de Ciudad Bolívar ne récupère pas les armes. Les commandants se bouffent le nez entre eux. Vous imaginez le sac de nœuds ?
– Heureusement que c’est comme ça, mon lieutenant, dit le caporal Estupiñán. Du côté de Ciudad Bolívar, ça chauffe sacrément. Je connais quelqu’un…
Une rafale de mitraillette l’interrompit. Les deux militaires se précipitèrent derrière un monticule de terre et de gravats.
– Bande d’enfoirés… ! lança le lieutenant. Ils tirent pour faire du bruit. On voit qu’ils ont des munitions à gogo. Alors que nous, on compte les cartouches.
Le caporal Estupiñán resta seul et alluma une cigarette. Sur ces entrefaites, il vit s’approcher, entre les barricades d’automobiles renversées et de tôles, un groupe de jeunes filles très maquillées, en minijupes très audacieuses. Elles se dirigeaient vers l’hôtel. Quand elles passèrent devant lui, Estupiñán ne put retenir un mouvement d’exaspération. C’étaient des ex-étudiantes qui racolaient des clients chez les journalistes et les militaires des Nations Unies. “C’est le pire de la guerre, se dit Estupiñán, la nécessité les oblige à baisser leur culotte pour pas grand-chose ; trente ou quarante dollars au maximum.” Presque tous les correspondants permanents se payaient des filles, et les interprètes arrondissaient leurs fins de mois en se glissant dans le lit des chefs. C’était ça, la guerre.
-300x460.jpg)

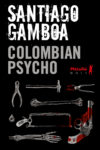

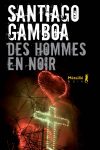




-100x150.jpg)


-100x150.jpg)