Paris est toujours un merveilleux fantasme pour les jeunes écrivains latino-américains, Esteban vient y étudier la littérature, mais il y découvre aussi la pluie, le froid, la solitude et la plonge dans le sous-sol d’un restaurant coréen. Il rencontre d’autres émigrés, coréens, marocains, latino-américains, roumains, africains, tous porteurs d’une histoire qu’ils nous racontent avec sincérité. Tous jeunes, désespérés, inventifs et sans le sou, ils trouvent le salut dans leur solidarité, leur amitié, et se raccrochent à l’unique chose qui leur prouve leur humanité : le sexe. A travers lui, ils se retrouvent égaux et peuvent croire un instant que tout peut changer.
Esteban est un amoureux maladroit, sincère et volage, qui souffre de la jalousie et de l’abandon tout en pratiquant avec enthousiasme une vie érotique échevelée et drôle qui le conduira à ce pour quoi il est venu à Paris, l’écriture.
Romancier traitant avec une infinie tendresse ses personnages ballottés dans un monde de misère et de désespoir, Santiago Gamboa se place à l’ombre de Henry Miller pour nous raconter avec distance et un humour exceptionnel ces Jours tranquilles dans un Paris moderne au cœur de la mondialisation.
Un roman prenant, juste, plein d’énergie vitale, et magnifiquement écrit.
Ce roman fait partie de la 1ère sélection du Prix Médicis étranger 2007
-
Gamboa mélange avec bonheur dans ce roman les genres littéraires : roman initiatique, policier, sentimental, érotique voire, avec un goût évident pour l’outrance, carrément pornographique.(Page des libraires)
Michel Edo
-
BIBLIOSURF.COM
-
, Chronique de Sandrine LeturcqCARNETS DE SEL
-
« Santiago Gamboa serpente dans ce microcosme armé avec une aisance redoutable. On le suit dans ce jeu de piste en temps de guerre. Fable ? Sans doute. Fiction ? Moitié-moitié. Narrateur hors-pair, Gamboa fait preuve d’une imagination assise sur des bouts de réalité. Les personnages secondaires, les seconds rôles en quelque sorte, forment un bataillon hétéroclite. Ce court roman détonne, surprend, captive. Que demander de plus ? »Benoît DelmasBLOG COURRIER INTERNATIONAL -
, Jean-Sébastien Barrey, émission du 29 septembre 2007"Le livre de la semaine"FRANCE BLEU COTENTIN
-
, Louis-Philippe Ruffy, émission du 21 septembre 2007"Entre les lignes"RADIO SUISSE ROMANDE
-
, Frédéric Koster, émission du 3 juillet 2007RADIO PLUS
-
, Joseph Lecuyer, émission du 18 septembre 2007RADIO BRO-GWENED
-
, Tewfik Hakem, émission du 11 septembre 2007"A plus d'un titre"FRANCE CULTURE
-
, Catherine Fattebert, émission du 8 octobre 2007"Que de la radio"RADIO SUISSE ROMANDE
-
"Romancier traitant avec une infinie tendresse ses personnages ballottés dans un monde de misère et de désespoir, Santiago Gamboa se place à l'ombre de Henry Miller pour nous raconter avec distance et un humour exceptionnel ces jours tranquilles dans un Paris moderne au cœur de la mondialisation. Un roman prenant, juste, plein d'énergie vitale, et magnifiquement écrit."Januario Espinosa
ESPACES LATINOS -
"Avec une ironie implacable et un humour décapant, l'écrivain colombien Santiago Gamboa peint un portrait vitriolé des émigrés."Francisco Cruz
WORLD -
"Il y a toujours un décalage gigantesque entre l'image fantasmée d'une ville et la réalité dans laquelle on vit, où l'on est invisible. Il m'a fallu deux ans. Et c'est par la littérature que j'y suis arrivé."propos de Santiago Gamboa rapportés par Amélie Dor
LIRE -
"Un récit où l'humour le dispute au désespoir, le sexe à la pauvreté, la chaleur humaine à l'indifférence de nos concitoyens, la perte des illusions aux lendemains qui chantent."Yonnel LiegeoisLA NOUVELLE VIE OUVRIERE -
« Deux histoires qui ont en commun l’humour, la politique et l’érotisme : soit l’occasion rêvée de découvrir le colombien. »Daniel MartinCENTRE FRANCE DIMANCHE -
"Gamboa signe un roman d'une grande générosité, où jamais le lecteur n'est guetté per l'ennui, littéralement porté par le flot impétueux de la prose de l'écrivain. Cette fresque chatoyante, à la fois grave et drôle, est assurément une des œuvres les plus émouvantes de la rentrée."Christine Barbacci
ROUGE -
"Gamboa, dans ce livre "triste mais véritable", comme le souffle l'un de ses personnages, raconte, de toutes évidences, des fragments de sa vie. Et par touches successives, parfois au discours indirect libre, il intercale d'autres voix à la première personne."Lila Azam-Zanganeh
LE MONDE -
"Un livre dur et foisonnant, où Gamboa fait preuve d'une très belle politesse du désespoir et d'une cruauté lucide."Daniel Walther
LE MAGAZINE DES LIVRES -
"Dans ce roman bourré d'humanité et d'autodérision, l'auteur [...] enchâsse dans le récit l'histoire, racontée à la première personne, des autres protagonistes dont les vies croisent celle d'Esteban."Véronique RossignolLIVRES HEBDO -
"L'autre originalité du livre est qu'en dehors d'Esteban, le narrateur ironique et omniscient de cette histoire, l'auteur cède la parole aux autres protagonistes du récit. Devenus le temps de quelques pages les propres conteurs de leur destinée."
Alain FavargerLA LIBERTE -
"Il y a une telle flamme, une telle vigueur, une telle énergie dans ce roman polyphonique qu'on ne peut que céder au charme de ce portrait-miroir."Sandrine FillipettiLE MAGAZINE LITTERAIRE -
"Conteur hors-pair, tout à la fois comique, pathétique, acerbe, lyrique, grave, voluptueux, il dresse une galerie de portraits fascinants."Dominique Aussenac
LE MATRICULE DES ANGES -
"Avec une aisance inouie et dans un style où les récits se mêlent, Gamboa tisse un extraordinaire roman universel : plein de désespoir, certes, mais gorgé de vie."
François JulienVSD -
"Le résultat est une espèce de radioscopie, absolument pas misérabiliste, mais intelligente et tendre, de l'état d'émigré."Raphaëlle LeyrisLES INROCKUPTIBLES -
« Comme dans un concert, le romancier présente tour à tour chaque musicien qui joue son propre solo pendant quelques minutes avant que sa voix ne se fonde à nouveau avec les autres voix de l’orchestre et avec celle d’un autre personnage déterminant : le téléphone, dont les sonneries et les silences apportent tous les rebondissements, comme un running gag. »Véronique RossignolLIVRES HEBDO -
« Le syndrome d’Ulysse, c’est le vertige de l’anomie, le cri muet de l’immigrant, du clandestin. Le mal-être des interstices et de l’errance. Roman, tract politique, livre de mémoires, Le syndrome d’Ulysse, de Santiago Gamboa, est le portrait polyphonique de cette France des souterrains. »
LE MONDE DES LIVRES -
"Avec lui, nous entreprenons un voyage qui nous mènera de la banlieue au cœur de Montparnasse, du monde de l'émigration forcée à celui de l'émigration choisie."Milagros P. OlivaCOURRIER INTERNATIONAL
Santiago Gamboa nous en parle :
Cet entretien avec Santiago Gamboa a été enregistré pour le site www.lechoixdeslibraires.com
Extrait audio :
La lecture de cet extrait a été faite par Joachim Salinger pour le site www.lechoixdeslibraires.com
À l’époque, la vie ne me souriait pas vraiment. Elle me faisait même la grimace, presque un rictus. C’était au début des années 90. Je vivais à Paris, la ville des voluptés peuplée de gens prospères, ce qui n’était pas mon cas. Loin de là. Ceux qui étaient entrés par la porte de service, en enjambant les poubelles, avaient une vie pire que les insectes et les rats. Et comme rien, ou presque, n’était prévu pour nous, le plus clair de notre alimentation se réduisait à des envies absurdes. Nous commencions toutes nos phrases par : “Quand je serai…” Un Péruvien du restaurant universitaire avait déclaré : “Quand je serai riche, je ne vous adresserai plus jamais la parole.” Peu après, on l’arrêta pour vol dans un supermarché. Il s’était pourtant appliqué, mais la caissière poussa un cri d’horreur (que j’oserais qualifier de “cinématographique”) en le voyant, car d’épaisses gouttes rouges ruisselaient de ses cheveux. Il avait dissimulé deux barquettes de viande de bœuf sous la capuche de son imperméable, mais il avait trop attendu et le sang avait traversé le plastique. À compter de ce jour, sa phrase devint : “Quand je serai riche, je nagerai dans le sang frais.” Par la suite, j’ai appris qu’on l’avait interné dans un asile et je le perdis de vue.
On n’entendait pas grand-chose dans mes poches (pour qu’une pièce tinte, il faut qu’il y en ait au moins deux), ce qui m’avait obligé à louer une chambre de neuf mètres carrés qui ne donnait même pas sur la rue, sous les combles d’un immeuble de la rue Dulud, commune de Neuilly-sur-Seine, une banlieue pleine de familles riches, d’automobiles élégantes et de boutiques de luxe. Quand on est pauvre, il est déconseillé de s’entourer de gens riches. Je ne vous le recommande pas. Ça porte malheur et ça laisse un goût amer, mauvais pour la santé. Quand on est pauvre, il vaut mieux s’entourer de pauvres. Croyez-moi.
Ce n’était pas mon seul problème : Victoria, le grand amour de ma vie, ne l’était plus (en réalité, je n’étais plus le grand amour de sa vie), voilà pourquoi j’avais souvent des crampes d’estomac. Ajoutez à cela une alimentation chiche et de mauvaise qualité – viande aux petits pois en conserve à six francs, vous voyez le genre – qui avait déclenché une gastrite et réveillé un vieil ulcère. Une violente douleur physique qui faisait oublier l’autre, que nous pourrions qualifier de spirituelle, douleur de l’âme. En somme, j’avais mal partout. Les journées étaient un os un peu dur à avaler, elles avaient un sale goût, et chaque matin je devais trouver de très bonnes raisons pour sortir dans le froid, car en 1990 l’hiver était particulièrement rude. Douleurs, froid et désamour. Le cocktail idéal pour ne pas survivre. Mais j’avais brûlé mes vaisseaux, car je ne voulais pas retourner à Bogotá. C’est ce que j’avais décidé, sans raison particulière ni originale. Cette ville était un excellent refuge, mais ma vie était entre deux eaux. Qu’est-ce que je pouvais en faire ? Il fallait bien que quelqu’un la vive, ou essaie de la vivre, alors je devais continuer, seul, le plus loin possible. Je n’étais pas encore trop atteint et mes joues, malgré le froid, semblaient respirer la santé. Je pouvais encore en supporter. Tout est supportable si on peut y mettre fin, comme disent les candidats au suicide. Vu que je ne savais pas combien de coups je pouvais encore encaisser, j’étais prêt à faire le calcul. Et sans hésiter.
Sortir dans la rue, quelle aventure !
Je n’ai jamais rencontré personne qui connaisse la rue Dulud, cette rue insignifiante de la commune de Neuilly-sur-Seine. Elle est parallèle au bois de Boulogne, côté avenue Charles-de-Gaulle, un endroit sans commerces ni enseignes lumineuses. Il n’y a que les murs gris des immeubles et une boulangerie à l’angle, Le four de Boulogne. C’est une rue froide et un peu triste, habitée par des familles bourgeoises qui vous lancent un regard méfiant si vous croisez leur chemin, car dans le coin tout le monde se déplace en voiture.
Mon compte bancaire, ouvert deux mois plus tôt avec la somme de trois mille six cents francs au Crédit lyonnais du boulevard du Montparnasse, était au plus mal. Il restait huit cent soixante-quinze francs et je ne voyais pas comment augmenter ce maudit chiffre. J’avais décroché quelques cours d’espagnol dans une boîte privée, pour lesquels on ne me payait pas grand-chose, exactement quatre-vingt-cinq francs de l’heure, il m’en fallait donc au moins quinze par mois pour payer mon loyer, qui s’élevait à mille deux cents francs. Tout le problème était là, car il fallait répartir le travail entre plusieurs professeurs aussi affamés que moi, ce qui ne laissait pas grand-chose à chacun. L’un d’eux était un Argentin de soixante-dix ans, romancier, critique de cinéma et dramaturge très connu à Buenos Aires (d’après lui). Par pudeur je tairai son nom, mais je vous assure qu’il offrait un spectacle tragique quand on le croisait dans les couloirs, avec sa bouteille d’oxygène reliée par un tuyau à ses narines. En bon Portègne, il était toujours sur son trente et un, un chapeau sur la tête, mais cela ne changeait rien à l’implacable réalité, à savoir qu’il était avant tout un crève-la-faim. J’avais un autre collègue, un sociologue chilien, qui préparait un doctorat d’État sur le socialiste Luis Emilio Recabarren, un homme obèse (le sociologue) et triste, qui semblait porter toute la misère du monde et qui se lamentait par-dessus le marché d’avoir arrêté de fumer, parce qu’il avait encore grossi. Il était surprenant qu’un homme aussi gros puisse être aussi pauvre. Les autres professeurs n’étaient pas moins marginaux, et quand nous organisions des débats linguistiques ou des “séminaires” sur les différentes formes du parler hispanique, le contraste entre les élèves riches et nous, teint cireux dans nos vestes rapiécées, était pathétique.
La boîte privée s’appelait Langues dans le monde et elle se trouvait rue de Tilsitt, pas loin de chez moi. J’étais ravi d’avoir décroché ce boulot, même si on me donnait des horaires impossibles sous prétexte que j’étais nouveau. Par exemple, entre sept et huit heures du matin avec M. Giraud, un dirigeant de la compagnie pétrolière française Total qui allait être muté à Caracas, un personnage terriblement sérieux, qui avait l’air d’avoir des doutes insondables sur mes capacités d’enseignant. Quand on accepte de sortir de chez soi à six heures du matin pour quatre-vingt-cinq francs, c’est qu’on crève vraiment de faim. Le reste de la journée, c’était un temps mort, car le cours suivant tombait généralement en fin d’après-midi, et comme les autres il durait une heure. Comme si cela ne suffisait pas, il fallait s’habiller correctement, porter une chemise propre et un pantalon repassé. Le fer que j’avais apporté de Bogotá n’avait pas la bonne prise et je devais acheter un adaptateur qui coûtait trente francs, le budget d’une journée. Tout mon linge était dans une valise, car la chambre n’avait pas de placard.
Sortir, quelle aventure !
À six heures du matin, le brouillard montait du sol et le crachin vous transperçait jusqu’aux os. Le froid était tel qu’au deuxième carrefour on avait la mâchoire paralysée, mais on n’était pas au bout de ses peines : il fallait encore traverser le bois de Boulogne jusqu’à la piscine publique de l’Université Paris-Dauphine, où se trouvaient les douches. D’ailleurs, lors d’une de mes premières sorties, je fus témoin d’une scène inquiétante. Un clochard était mort de froid pendant la nuit et je tombai sur un groupe de secouristes qui enlevaient le cadavre. Mais il y avait un problème : quand l’homme était tombé (au moment de sa mort), sa main gauche avait échoué dans une flaque d’eau qui avait gelé lorsque la température était descendue. Je me rappelle le bruit d’un pic brisant la glace dans laquelle la main s’était prise. Je m’éloignai en me disant que la main, étant congelée, vivait peut-être encore, et je rêvai d’elle plusieurs fois.
L’abonnement trimestriel à la piscine représentait un gros investissement, cent vingt francs, mais une douche chaude quotidienne était la condition de ma survie. Et j’y allais en grelottant, comme un fantôme dans la brume. Je laissais mes vêtements au vestiaire, dans une armoire métallique, et, bonnet à la main, j’allais me planter sous une douche équipée d’un système économiseur. L’eau s’arrêtait au bout de deux minutes et il fallait garder la main appuyée sur le bouton pour qu’elle continue de couler. Comme c’était mixte, un agent de sécurité veillait constamment à ce que personne n’abuse de la présence des femmes. En quoi il avait raison, car avec le temps j’ai repéré des hommes qui s’approchaient si près d’elles qu’ils auraient pu les toucher en tirant la langue. Chaque fois que le gardien entrait, il fallait s’activer sur sa propre toilette, ce qui me coûtait cher, car j’achetais uniquement du shampoing et celui-ci devait me durer au moins deux semaines. Jamais un gardien ne m’a reproché de rester trop longtemps sous l’eau, mais je me suis parfois senti observé. Bien sûr, moi aussi j’observais. C’était l’heure où les étudiantes venaient nager, belles jeunes filles qui se douchaient vite et repartaient non moins vite à leurs cours. Mais moi, je restais. Je ne nageais pas, je restais sous la douche. Je n’étais pas pressé de retourner dans le froid, sous la pluie.
Dans ma poche, je gardais précieusement trois pièces de dix francs. C’était mon maigre budget du jour, le minimum vital pour deux repas chauds au restaurant universitaire de Mabillon, un café et quelques cigarettes. Parfois, j’achetais un livre de poche d’occasion qui coûtait dix francs, mais uniquement les jours où je sortais, sinon je préférais rester au lit à rêvasser, à ruminer des projets et à me reprocher de ne pas avoir choisi une autre ville, un endroit où il ferait moins froid et où les gens seraient moins durs. Comme tout un chacun, je devais trouver ma place dans le monde, un petit coin où vivre sans trop de sacrifices, mais ma quête en était à ses débuts.
Et puis il y avait le problème Victoria.
Elle était venue me voir, mais avant de quitter Madrid elle m’avait prévenu par téléphone : “Il y a du nouveau, on en parlera.” Et elle avait ajouté qu’elle était plongée dans Anna Karénine, de Tolstoï. J’en déduisis qu’elle préparait une confession. En effet, après plusieurs détours et quelques larmes, elle avait lâché le morceau : “Il y a quelqu’un d’autre.” Pour lui épargner toute culpabilité, je lui dis que moi aussi j’avais eu une aventure, et sa réaction fut, c’est le moins qu’on puisse dire, incroyable : un regard de haine féroce succéda aux larmes. Elle me balança une chaussure à la tête, cassa mes deux seules assiettes et partit en claquant la porte. Elle revint presque aussitôt, repentante, pour me dire que son histoire c’était du sérieux, et on se donna mutuellement l’absolution. Avant de s’en aller, elle me tendit cinq mille francs en billets neufs. C’étaient ses économies, l’argent qu’elle avait mis de côté en travaillant tout l’été.
– Il est à toi, tu en as plus besoin que moi.
Ma situation désespérée ne me permettait pas de refuser.
– Je te rembourserai dès que je pourrai.
Ce fut tout. Je l’accompagnai à la gare d’Austerlitz et je la vis partir en larmes. Les pleurs de Victoria étaient peut-être sincères, mais j’étais décomposé. À Madrid, le terminus de la ligne, quelqu’un l’attendait. Nous le savions tous les deux. Avant de rentrer dans ma chambre de Neuilly-sur-Seine, j’achetai une bouteille de whisky avec son argent. Le monde tournait et je me retrouvais seul, au fond d’un trou humide et misérable, alors j’allumai la radio, je m’assis dans un angle et débouchai la bouteille. Après plusieurs gorgées, je sentis un peu de chaleur. Je l’imaginai dans son compartiment de seconde classe, lisant des pages écrites de ma main ; elle revenait, j’entendais frapper deux coups à la porte, j’ouvrais et elle était là. Elle avait sauté du train et elle voulait rester pour toujours. Mais le silence sur le palier était de plus en plus dense.
La bouteille fut bientôt vide et j’enfilai ma veste pour sortir. Ah, quelle aventure ! Il pleuvait comme cette maudite ville en a le secret, sans qu’on s’en aperçoive, un crachin trompeur : quand on réagit, c’est trop tard, on est déjà trempé jusqu’aux os. Trois rues plus loin, près du bois de Boulogne, je trouvai une boutique ouverte. Un Arabe, entre deux bâillements, me vendit une bouteille de whisky que j’ouvris immédiatement. Je me dirigeai vers le bois en buvant au goulot. Il faisait très sombre. Je ne savais pas ce que je cherchais et je distinguai une lumière dans le noir. C’était la voiture d’une prostituée, une grosse femme qui exhibait ses chairs blanchâtres sous un épais manteau. Elle attendait le client. Je restai à l’écart, vidant la bouteille à grandes lampées. Une automobile s’arrêta et un homme passa dans celle de la prostituée, qui avait aménagé un lit à l’arrière. Je m’avançai sans bruit. Le type baissa son pantalon, la femme se mit à le sucer avec des mimiques exagérées, puis il lui grimpa dessus. L’homme prenait son pied, la femme faisait son boulot, mais moi qui les observais j’étais loin d’avoir les mêmes sensations. Victoria était dans un train qui l’emportait vers une ville lointaine, et en y repensant je versai toutes les larmes de mon corps, comme si c’était la dernière nuit d’un homme sur la terre. Et je compris le sens du mot orphelin. Le bois était devenu un milieu hostile et je décidai de rentrer chez moi. Mes chaussures étaient trempées. La lune, une sphère coupée en deux, se reflétait dans toutes les flaques.


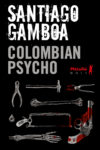

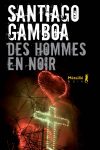




-100x150.jpg)


-100x150.jpg)