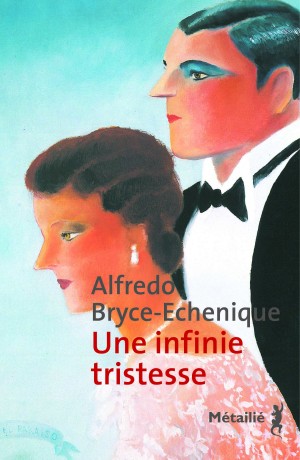La dynastie des De Ontañeta règne depuis longtemps sur Lima, figures de l’aristocratie péruvienne, propriétaires de terres immenses et de richesses infinies, dépensiers, frivoles et étrangers au pays dans lequel ils vivent.
Alfredo Bryce-Echenique nous raconte ici leur fin et explore leur arbre généalogique. Au fil du temps les situations scabreuses se multiplient dans la famille : suicides, crimes, mariages incestueux.
Les dernières années du patriarche Tadeo sont bien éloignées de son apogée comme propriétaire de mines et grand voyageur. Celles de Fermín Antonio, son fils, séducteur et collectionneur de femmes, sévère et impitoyable, seront tout aussi lamentables, pour ne rien dire des branches collatérales.
Bryce-Echenique revient à ses meilleurs textes de dissection et de satanisation d’une classe sociale qu’il connaît bien. Il retrouve son humour sardonique, son ironie et le charme qu’il sait si bien déployer dans les scènes de tendresse.
-
Etant un amoureux de la littérature latino-américaine, je viens de découvrir ce grand romancier péruvien qu'est Alfredo Bryce Echenique. Une infinie tristesse est un grand roman de cette littérature du sud de l'Amérique. L'auteur est extrêmement brillant, cette satire corrosive de la société aristocratique péruvienne est magistrale. Les personnages sont extrêmement marquants et ils sont un des points forts du roman, tout comme les relations qui nous sont dépeintes au sein de cette famille. J'ai aimé la nostalgie qui se dégage de l'oeuvre, l'humour grinçant de l'auteur et tout simplement son écriture baroque. Un roman qui rappelle Le Guépard de Lampedusa ou Les Budenbrook de Thomas Mann en ce qui concerne la thématique principale qui est la présentation du déclin d'une famille d'aristocrates.Aurélien Vicentini
-
Un portrait au vitriol de l’aristocratie péruvienne tout au long du 20ème siècle. Avec ses armes habituelles, verve et humour grinçant, cette grande voix de la littérature sud-américaine brosse un tableau sans concession d’une famille de notables de Lima, de ses grandes années de gloire jusqu'à sa déchéance. Une saga émaillée de vilaines histoires de famille (infidélités, alcoolisme, corruption, disparitions suspectes, etc), de ces grandes familles égocentriques qui ne semblent pas s'émouvoir, ni même s'apercevoir des maux qui touchent leur pays.
-
"On complote, on trahit, on assassine si le besoin s'en fait sentir, l'auteur se déchaîne, dans un style qui n'est qu'à lui, il n'a rien perdu de l'éclat de sa jeunesse, l'infinie tristesse du titre se transforme en l'inverse pour le lecteur." Lire l'article iciChristian RoinatEspaces latinos
-
"Une satire proustienne d'un monde qui rechigne à vivre avec son temps." Lire l'article iciAriane SingerLe Monde des Livres
-
"Avec son nouveau roman, l'auteur du génial Un monde pour Julius revient à son cher univers de la haute bourgeoisie limeña au travers d'une saga familiale." Lire l'article iciEsther SanchezQué tal París
– Ne vieillis jamais, Alfonsinita… Ne sois jamais vieille, au grand jamais.
– …
– Et encore moins archivieille, Carlita, jamais…
– …
– Et toi non plus, Ofelita… Ne sois jamais archi vieille, ce qui s’appelle jamais… Et encore moins archi archivieux, comme moi. Archivieux pour de bon comme moi seul peux l’être. Archi-archivieux, comme moi seul, ça alors non, jamais, jamais, jamais, Elenita…
Même en tenant compte, bien sûr, que ni Alfonsinita, ni Carlita, ni Elenita n’existaient et n’avaient jamais existé, c’était en vérité une grande chance que le bisaïeul Tadeo soit désormais sourd comme un pot et qu’il croie qu’il y avait toujours un membre de la famille pour lui tenir compagnie dans ce coin de la serre où une infirmière, avec sa coiffe et tout, tirée à quatre épingles, en plus, le transportait tous les matins à huit heures pile, immédiatement après un petit-déjeuner maigre et bien mou spécial édenté, parfaitement propre et rasé de frais, cela va sans dire. On prenait un million de précautions pour ce voyage quotidien dans son fauteuil roulant, à vitesse minimum, depuis le réservoir à oxygène de sa chambre jusqu’à celui de sa salle de bains, puis de ce deuxième réservoir à celui de l’immense serre où il passait ses journées, même en été et sous un soleil radieux. Un véritable empilement de châles et d’écharpes faisait disparaître, été comme hiver, sans aucune distinction de saison, ses costumes de haute qualité britannique, quant au tissu et à la confection, ses gilets, y compris quelques-uns de haute fantaisie, et les éternels nœuds papillon, très colorés et énormes, qu’il conservait encore et qui avaient été étrennés mille ans plus tôt, l’un après l’autre, depuis le jour où il avait définitivement renoncé à sa vie de très prospère exploitant de mines et même de téméraire précurseur de cette activité au Pérou, semble-t-il, car il était revenu des mines veuf et très riche, plein de problèmes pulmonaires, ça oui, mais avec un tel désir de voir le monde qu’il n’avait jamais marchandé ni dépense ni luxe au cours des interminables voyages durant lesquels, selon sa propre affirmation, il avait fait deux fois et demie le tour complet du monde, de grand hôtel en grand hôtel, de grand restaurant en grand restaurant et des cocottes[1] hors de prix à tous les casinos qu’il avait fréquentés lors de ses pérégrinations. Toutefois, on doit à la vérité de dire que tout ce que le bisaïeul Tadeo avait rapporté au Pérou, après le grandiose apogée final qu’avait été son dernier voyage, c’était des malles entières de très fins vêtements sur mesure, qu’avec le temps il avait fallu commencer à rétrécir et à raccourcir, toujours en tenant très précisément compte de la nouvelle taille et de l’inclinaison très tour de Pise – beaucoup plus qu’une simple courbure – d’un bisaïeul déjà plus que centenaire.
Toutes ces chemises et tous ces costumes étaient accompagnés d’une véritable floraison de nœuds papillon que ma mère et ma grand-mère trouvaient toujours vraiment colorés, mais que le grand-père classique, à savoir le grand-père maternel, jugeait insupportablement criards et même inhumains, d’après ses propres mots, ainsi que de quelques fabuleux albums de timbres qui, eux, oui, pouvaient donner un témoignage fidèle de la véritable dimension géographique de ses voyages, des voyages pionniers, même, et réellement expéditionnaires. Et pour finir le bisaïeul Tadeo avait aussi ramené une impressionnante Hispano-Suiza décapotable, de couleur rouge, avec des tapis en peau de porc, dont il ne se servit que très épisodiquement, et uniquement l’été, pour aller voir, à la station balnéaire de La Punta, son fils aîné Fermín Antonio et son épouse, l’adorable Madamina, avec laquelle il avait toujours été plus facile de plaisanter et de s’entendre qu’avec cette grande asperge de merde, à savoir mio propio figlio…
– Fin de trajet. Fin de trajet, mais pour ce matin, que ce soit bien clair, on verra cet après-midi et aussi ce soir, répétait jour après jour le bisaïeul Tadeo en entrant dans sa serre personnelle et en arrivant dans son coin habituel, où, aussitôt, l’infirmière à coiffe procédait à la mise en place du petit masque respiratoire qui lui couvrait le nez et la bouche, et ouvrait le robinet rouge du réservoir à oxygène. Cela constituait le début de la première étape du rituel quotidien selon lequel, au bout de vingt ou trente minutes tout au plus, le bisaïeul Tadeo lui-même ôtait son masque à oxygène, le donnait à la demoiselle à coiffe, en tendant pour ce faire au maximum son bras droit, ce qui dans son cas était relativement peu, à vrai dire, tandis qu’avec le gauche il allumait une très fine cigarette brune cubaine, puis en tirait trois et, de préférence, jusqu’à quatre bouffées bien soignées et interminables qui, vu la constitution plus que maigre et réduite qui était la sienne, devaient le remplir de fumée de la tête aux pieds, en commençant, bien sûr, par ses poumons, affectés d’un emphysème suraigu. Il écrasait ensuite son mégot dans un grand cendrier de cristal placé sur la petite table ronde qui était à sa gauche, et regardait l’infirmière pour l’informer qu’elle pouvait le rebrancher au réservoir à oxygène. Et c’était là le moment précis où la demoiselle à coiffe avait toujours voulu lui dire “Don Tadeo, vous devriez penser à l’extrême gravité de votre emphysème”, mais le vieillard, tout rabougri désormais, l’en avait toujours empêchée, en lui envoyant, tout heureux, une contagieuse et point dédaignable bouffée de fumée en plein visage.
– Don Ta…
– Vous disiez, mademoiselle la travailleuse ?
– C’est que, don Ta…
– Syndiquez-vous, mademoiselle la travailleuse. Syndiquez-vous et organisez, vous et vos combatives camarades, une bonne grève antivieux et archivieux fumeurs.
– À mon humble avis, ça, ce serait vraiment inhumain, don Tadeo. Moi, en tout cas, je désapprouverais semblable procédé.
– Alors ne m’emmerdez plus et revenons à la charge avec quelques bouffées de plus.
– Don Tadeo…
– Pas de don Tadeo qui tienne, mademoiselle la travailleuse, et passez-moi plutôt les allumettes, s’il vous plaît, elles sont encore tombées par terre.
– Vous jouez avec le feu, don Tadeo, voyez comme vous êtes près de votre réservoir à oxygène.
– Tout ce que je vois, mademoiselle la travailleuse, c’est qu’on vous donne un salaire qui est assez élevé pour que vous sautiez avec moi s’il le faut. Allez, allons, arrêtez un peu avec vos sensibleries et passez-moi les allumettes, une fois pour toutes. Les allumettes et bouche cousue, mademoiselle la travailleuse à coiffe. Et prenez une fois pour toutes aussi ce cornet acoustique de très fin ivoire. Que les gens sont stupides, vraiment ; ils vous offrent des trésors comme ce cornet qui ne vous sert qu’à entendre connerie sur connerie.
Une demi-heure n’était pas passée que déjà le bisaïeul Tadeo fumait sa deuxième cigarette de la journée, dont il tirait trois, ou de préférence jusqu’à quatre très longues bouffées qui finissaient toujours par une très urgente reconnexion au grand réservoir à oxygène qui le dépassait facilement de vingt ou trente centimètres, et qui cependant ne dura jamais aussi longtemps qu’en principe il aurait dû le faire. Et tout cela en dépit de la mort précoce et amphysémateuse de sa femme Inge, grande Teutonne buveuse de bière et tyrolienne, pour couronner le tout, comme il le disait souvent lui-même, en ajoutant chaque fois que de son temps, lorsque quelqu’un avait survécu aux mille et une mines des Andes, à leurs tunnels précaires et à leurs dantesques galeries, mourir ensuite d’un vulgaire emphysème était quelque chose d’au plus haut point risible, ridicule et même méprisable. Et bon, après tout personne n’avait obligé Inge à rester au Pérou, à s’enterrer avec lui dans une mine après l’autre, encore moins à se marier avec lui, et à vrai dire la bisaïeule Inge devait s’estimer heureuse de s’être approprié le premier nom de famille de son époux en renonçant totalement au sien, ce qui au fond était assez compréhensible, à vrai dire, vu que son nom tyrolien était franchement horrible, mais s’approprier inutilement aussi le second nom de son mari ? Eh bien non. Ça non, alors. Et le fait est que c’était là un manque absolu de décence et de tout dans cette vie.
– Mais, oncle Tadeíto… tu ne l’as jamais aimée, peut-être ? Ce n’est pas toi, peut-être, qui lui as fait la cour, d’abord, et as demandé sa main, ensuite ?
– Jusqu’à ce que la mort nous ait séparés, c’est bien possible. Et de façon assez semblable, je crois que d’une certaine manière je lui ai promis tout ça devant le curé du diable qui nous a mariés. Eh bien oui, peut-être bien que oui, même si aujourd’hui je dirais, plutôt…
– Non, s’il te plaît, ne dis rien, oncle Tadeíto. Et le souvenir ? Hein, mon oncle, et le souvenir ?
– Quel souvenir, il n’y a pas de souvenir qui tienne, Adelita ! Je suis presque aveugle mais je veux que tu saches que j’ai toujours les yeux bien fixés sur le futur, uniquement sur le futur, jamais sur le passé, et désormais simplement sur le futur de l’industrie cubaine des tabacs, évidemment. Mets-toi au moins ça dans la tête, parce que la seule chose qui m’intéresse maintenant, c’est le tabac de cette île, avec mes timbres et aussi vous tous, évidemment, bien que vous ne soyez plus qu’à une troisième place bien méritée, parce que fumeur, philatéliste et très sincère, je crois que je l’ai toujours été et que je le serai toujours, jusqu’à ce que le Seigneur tout-puissant m’invite à fumer auprès de lui. Et ce n’est pas une plaisanterie, tu peux bien me croire, Adelita…
– Mais tante Inge, oncle…
– Putain ! Laissez les gens fumer en paix ou alors sautons tous autant que nous sommes ! Réservoir à oxygène, serre, toi, Adelita, et même la demoiselle travailleuse à coiffe, sautons tous ! Regarde un peu… Regarde un peu comme je tente le diable.
– Mon oncle, mon petit tonton, s’il te plaît, lâche cette allumette !
– Eh bien alors laissez-moi fumer en paix ou j’interdis toutes les visites à ma serre.
– Et tu seras bien seul dans ce cas, mon petit tonton.
– Cesse une bonne fois de m’appeler ton petit tonton, ma fille, tu me donnes l’impression d’être un singe ou un chimpanzé. Et toi, Sandrita, mets-toi bien dans la tête, plutôt, que c’est quand on est seul, vraiment seul, dans la plus absolue des solitudes, ma fille, qu’on jouit le mieux d’une cigarette. Et si en plus c’est du tabac brun et qu’il vient de Cuba, comme le mien, eh bien c’est un vrai plaisir des dieux, Marisita.
Il va sans dire que pas plus que leurs autres sœurs un peu plus tôt, ni Marisita, ni Sandrita, ni Adelita n’existaient ni n’avaient jamais existé, mais il faut savoir que le bisaïeul Tadeo de Ontañeta s’était inventé avec les ans une très copieuse salade de nièces, qui, de plus, changeaient assez souvent de nom avec le temps, à cause de son désir désespéré et vain d’effacer à tout jamais le souvenir si douloureux de ses quatre enfants, deux garçons et deux filles, à savoir les grands-oncles Froilán et Octavio et les grands-tantes Beatriz et Florencia, tous morts dans le même bus tombé dans un ravin en revenant de Cerro de Pasco à Lima. Mais il faut dire aussi, malheureusement, que ce penchant total pour les petites-nièces, dans ce si douloureux méli-mélo mental, qui avait presque toujours totalement exclu les petits-neveux de l’imagination débordante et pathétique du vieillard, n’était rien de moins que le fruit du penchant pervers qu’avait toujours manifesté don Tadeo pour les petites filles en très bas âge. Malgré tout, avec le long passage des ans et des décennies, don Fermín Antonio, l’aîné de ses enfants, s’était convaincu que ce penchant pervers n’était plus qu’une des caractéristiques d’un passé désormais très lointain.
Dans le tragique accident survenu lors de ce voyage de Cerro de Pasco à Lima avaient aussi été grièvement blessés le grand-père Fermín Antonio et son frère Fernando, qui avaient cependant survécu pour tout raconter, mais tout raconter de différente manière, et surtout pour convertir en équilibre et mesure, l’un, et en franche et ouverte démesure, l’autre, tout ce que leur père, le bisaïeul Tadeo de Ontañeta Tristán, avait converti à son tour en déséquilibre et même en franc libertinage, sitôt le décès de Inge la Tyrolienne, comme on appelle aujourd’hui encore la célèbre Teutonne de la famille.
Mais grand-père Fermín Antonio et son frère Fernando, notre grand-oncle, mirent assez longtemps à redresser le cap, et beaucoup plus le second que le premier, d’ailleurs, ce qui est quelque chose d’assez bien établi pour nous, les sœurs De Ontañeta Basombrío, car tant papa que maman durent se précipiter mille et une fois, avec une véritable bordée de tasses de tilleul et de menthe pour calmer grand-mère Madamina, notre grand-mère Madamina adorée, rendue folle une fois de plus, la pauvre, par une nouvelle incartade de l’homme le plus sérieux du monde, mais qui avait à son actif, ça oui, un véritable arsenal de prouesses galantes qu’il justifiait comme étant des obligations attribuables avant tout à sa qualité de caballero. C’était d’ailleurs, s’agissant de lui, assez admissible, car grand-père Fermín Antonio de Ontañeta Tristán, haut de taille, maigre comme un clou, sexagénaire à l’époque, très émacié, nez aquilin et grande élégance classique, avait toujours été un homme de parole, de très fortes convictions et de bon exemple, même si en ce qui concerne ses épisodes galants il serait préférable de le juger selon des critères véritablement avancés ou très très larges, ce qui peut-être lui donnerait en partie raison, tout comme si on remettait à plus tard, ou plutôt, si on laissait en suspens le modèle de vertu inhérent à sa qualité de caballero. Mais en fin de compte, le mieux et le plus sain, avait toujours opiné son grand ami Ezequiel Lisboa, était de faire semblant de ne rien voir, de fermer les yeux sur tout.
À vrai dire, ce qui est sûr aussi c’est que durant ces secrètes et galantes occasions, autrement dit ces raids et incursions nocturnes, le très maigre, sec et grand caballero se servait toujours de l’une des mille clés d’autant de maisons situées presque toutes dans ce qu’on appelle le Damier de Pizarro ou dans les environs – il y avait, aussi, un autre porte-clés, plus petit, pour la saison d’été à la station balnéaire de La Punta –, qui pendaient, sonores, à un porte-clés gigantesque, celui-là, un énorme anneau, plutôt, que Claudio, son éternel chauffeur de nationalité chilienne, tirait toujours aussi opportunément que secrètement du coffre d’une Chrysler bleu nuit, comme quelqu’un qui découvre à la fois un trésor et mille outils, en fermant aussitôt les yeux pour ne jamais rien savoir, absolument rien, au sujet de la porte par laquelle entrerait don Fermín Antonio et de la clé qu’il utilisait à cette fin. Car parmi ses obligations la plus importante était sans le moindre doute une discrétion absolue, même s’il y avait aussi, bien sûr, une grande affection pour un homme qui ne se fatiguait jamais de répéter : “Je fais la guerre au gouvernement du Chili, jamais aux citoyens chiliens, et vous-même en êtes la preuve la plus éclatante, Claudio, qui depuis vingt-cinq ans endossez vos uniformes pour chaque saison et aussi pour chaque occasion, sans compter celui qui est exclusivement réservé au Palais du Gouvernement, au volant de mes très diverses Chrysler bleu nuit, car celles-ci changent et se renouvellent, mais vous, non, Claudio, parce que vous, je ne vous changerai jamais et, plus important encore, tant que vous-même et madame votre épouse le souhaiterez, l’accord auquel nous sommes jadis arrivés se renouvellera tout seul, sauf en ce qui concerne vos rétributions mensuelles, bien entendu.”
De même qu’il fut toujours très clair que les eaux rentraient chaque fois dans leur lit lorsque le grand-père rentrait, quant à lui, dans sa seigneuriale demeure liménienne, après une sereine – et très négociée – semaine de self-control et de modération dans la suite présidentielle du Gran Hotel Bolívar. D’ailleurs, il suffisait pour cela que grand-mère Madamina envoie notre mère parlementer avec grand-père, et que celle-ci, à son tour, demande à sa mère d’y envoyer papa à sa place, mais accompagné de notre joyeux oncle Klaus von Schulten, le mari de tante María Isabel, sœur cadette de maman, car papa, qui en plus d’être son gendre est le neveu du caballero dissolu – quoique dans son cas, ça oui, d’un tempérament absolument anglo-saxon qui lui vient de son côté Wingfield, aucun doute là-dessus vu que c’est la personne la plus flegmatique du monde, et d’une extrême sévérité –, car papa, disais-je, aurait même été capable d’exiger de lui quelque chose d’aussi quaker que la remise immédiate de son anneau magique, clé par clé, jusqu’à la dernière maison de Lima et des stations balnéaires, à savoir également le porte-clés estival réservé à La Punta, bien qu’il existât aussi, à ce que devait nous raconter un jour un Claudio retraité, vieux et toujours très diligent et très minutieux, un troisième petit porte-clés, réservé celui-là à de rapides incursions dans la naissante station balnéaire d’Ancón.
Malgré tout, cette sévérité de notre père était tout à fait fondée, vu que l’oncle Klaus von Schulten, qui ne fait pas pour rien et à tout bout de champ du scandale au bar du Lima Golf Club, pouvait exiger, une fois de plus, que grand-père lui remette l’une des pièces de ce porte-clés qu’il appréciait le plus : rien de moins que celle de la maison de sa mère, veuve toute récente de don Hans Von Schulten, et encore à consoler.
– Pauvre don Fermín Antonio, répétait Claudio lors de ces occasions, compliquées et silencieuses, où la seule chose qui fût claire pour les domestiques de la maison – quoique nettement plus claire pour certains que pour d’autres, en fonction de leur rang et de leur ancienneté chez leurs maîtres – lorsqu’ils constataient cette nouvelle absence de don Fermín et l’air plus que contrarié de doña Madamina, et par voie de conséquence l’incessante ingurgitation de tilleul et de tisanes à l’étage des maîtres, bref, la seule chose qui était vraiment claire pour tous, dans la zone de service, c’était qu’il y avait eu, une fois de plus, du grabuge dans la grande demeure de l’avenue Alfonso Ugarte. Et il devait y avoir une raison à ça…
Car il devait bien y avoir une raison, indéniablement. Et c’était alors que les domestiques fraîchement descendus des Andes, obéissant à une loi de la vie, optaient pour la plus muette et la plus humble disparition, obligés qu’ils y étaient, bien sûr, par les yeux suppliants avec lesquels les serviteurs plus anciens ou moins andins regardaient don Claudio qui, étranger et blond aux yeux verts comme il est, doit évidemment être plus au courant que nous, aussi vrai que deux et deux font quatre. D’ailleurs, don Claudio travaille directement avec quelqu’un qui s’absente aussi soudainement que fréquemment, à quoi bon le nier, que la vérité soit dite, et qui est assurément le responsable de tout ce tilleul et de toutes ces tisanes pour les nerfs complètement dérangés de doña Madamina, la pauvre, tout le monde sait que c’est et que ce sera toujours une sainte, alors, bref, pour résumer, ce ne pouvait absolument pas être sa faute à elle.
Alors Claudio, plus que jamais respectueux de la maison, pas simplement de ses propriétaires mais aussi de tous ceux qui y habitaient ou y travaillaient, exception faite de ces exceptions andines pour l’heure disparues, choisissait de faire retomber tout le monde sur terre, mais toujours avec la discrétion de mise chez un chauffeur qui, certes, bien que blond aux yeux verts, est avant tout au service du caballero don Fermín Antonio ou don Fermín tout court, pour être plus bref :
– Eh bien moi je dirais, intervenait enfin Claudio, je dirais qu’à mon humble avis et selon moi don Fermín Antonio est de nouveau resté un petit moment sans pouvoir accomplir son devoir de caballero, y compris hors de chez lui.
Certains, là, comprenaient mieux que les autres, bien sûr, bien que cette histoire d’à mon humble avis et selon moi, dans la bouche, en plus, d’un étranger blond et de belle mine, dût forcément sortir du fond du cœur de ce chauffeur en uniforme adapté à la saison et casquette idem, sans parler de ces yeux verts et étrangers et de cet accent comme souriant et glissant, mais qui, chinois ou chilien, revenait en l’occurrence exactement au même.
– Clair comme de l’eau de roche, dit à son assistante de fille la vieille cuisinière Juana Briceño, une fois dans la chambre qu’elles occupaient à l’étage populaire (l’étage familial était nettement plus élevé), et tandis que les employés de sexe masculin traversaient le petit pont qui menait à leurs chambres et blocs sanitaires, et que d’ailleurs on aurait dit destiné à les éloigner au maximum, surtout maintenant, de l’énorme tentation qui venait d’arriver et de s’installer de l’autre côté de la rivière, mais, il est vrai, au rez-de-chaussée de la grande demeure.
En effet, la subtile inspection que don Fermín Antonio en personne menait dans les vastes et commodes secteurs réservés à la domesticité, le dernier jour de chaque mois et sous prétexte de remettre à chacun une enveloppe avec son salaire, lui avait permis de remarquer Mechita, une ondulante et curviligne grande fille aux airs aussi doux que subitement rapaces, oui, Madamina, si subitement rapaces que seule une sainte comme toi peut avoir l’idée d’engager quelqu’un qui à coup sûr finira par mettre le poulailler sens dessus dessous, et même pousser à l’insolence, sinon à la rébellion, la domesticité de la maison tout entière. Et je n’en exclus même pas Claudio…
Mais la vérité est qu’à cet instant précis, don Fermín Antonio se vit lui-même, oui, lui-même, en train de partir nocturnement en quête d’un poulailler à ameuter, tandis que Claudio fermait les yeux et lui tendait comme toujours son gros anneau liménien, mais en y ajoutant cette fois une très prévoyante et très sourde lampe de poche qui, en fait, ne put rien faire de mieux que d’éclairer pour don Fermín Antonio le chemin de la dure réalité.
– Mon Dieu, ajouta le sec et nocturne caballero, mon Dieu, Madamina, la dénommée Mechita…
– Mechita est arrivée munie d’une excellente lettre de recommandation. Et signée de la femme de ton grand ami Eudocio Colmenares, rien de moins…
– S’il en est ainsi, tu veux certainement dire que la dénommée Mechita est titulaire d’une brillante feuille de service, ce qui en l’occurrence veut précisément dire que la fille est exactement tout le contraire de… Enfin, tout le contraire de tout ce dont nous avons besoin dans cette maison, je me fais comprendre, Madamina ?
– Je crois que non, Fermín Antonio.
– Alors, s’il te plaît, dès demain tu me renvoies cette Mechita, Meche ou Mechota, quel que soit le nom de cette je ne sais qui. Et tu me la mets directement à la rue. Tu verras que tout s’arrangera aussitôt, et sans faire de morts ni de blessés, ma chère. Nous sommes d’accord, Madamina ?
– Fermín Antonio, nous ne retrouverons personne à Lima avec une recommandation pareille, avec une si excellente recommandation.
– Alors je fiche le camp au club, et pendant ce temps tu cherches en province. Ce n’est pas toi qui affirmais que les meilleures employées du monde venaient de Cajamarca ?
– Pour le moment, Fermín Antonio, le mieux que je puisse faire est de te rappeler qu’à cette heure-ci le club est fermé.
– Eh bien si c’est comme ça je descends un moment au bar.
– Je t’accompagne et tu me sers un petit verre ?
– Bon, alors la fille reste, d’accord, je ne vais pas non plus refuser une chance à un être humain simplement parce qu’il a été bien doté par la nature. Mais qu’il soit bien clair aussi que si elle reste, c’est sous ta stricte responsabilité. Et maintenant allons au bar tous les deux et buvons à n’importe quoi sauf à la dénommée Mechita.
– Un saint, Fermín Antonio ! J’ai toujours su qu’au fond tu as toujours été et que tu seras toujours un saint homme !
Mais ce furent précisément ces mots, un saint homme, qui ouvrirent brusquement tout grands les yeux de l’ineffable grand-mère Madamina. Si bien que ni Meche, ni Mechita, ni rien qui y ressemblât ne se trouvaient dans la maison le lendemain quand don Fermín Antonio revint, à l’heure du déjeuner.
– Comment ? Et Mechita, Madamina ? lui demanda alors grand-père.
– Personne de ce nom n’est jamais entré dans cette maison. Ni rien ni personne qui y ressemble. C’est clair, Fermín Antonio ?
– Comme deux gouttes d’eau, Madamina.
Et à quatre heures précises chaque après-midi, comme tout au long de tant et tant d’années, don Fermín Antonio entreprenait le chemin de retour quotidien au centre de Lima, et pour ce faire il descendait d’abord au sous-sol de la maison, le traversait d’un bout à l’autre, et au cours de ce long trajet il examinait brièvement les réserves remplies de vieux rossignols au rebut, puis cette autre pièce, relativement plus petite et dissimulée, où le joyau de la couronne était une sorte de gigantesque coffre-fort, absolument invisible, ça oui, dans lequel, parmi d’autres trésors de famille, il y avait des bijoux, des pièces d’or, les plus beaux plats d’argent et de porcelaine, des soupières comme des coupoles de cathédrale, de baroques ou très simples services à thé, de la vaisselle très variée, des couverts d’argent et des couverts d’or, ineffable et absurde toquade du bisaïeul Tadeo de Ontañeta Tristán qui avait jeté l’argent par les fenêtres à Prague, et d’autres ustensiles d’une valeur incalculable, tous réservés aux plus grandes occasions, alors que la seule chose vraiment remarquable est que les grandes occasions sont chaque jour moins nombreuses, et tout cela à cause de ce pauvre niais de Billinghurst[2] et des grèves ouvrières des dernières décennies.
– Vive Piérola[3], putain ! Même si ça a l’air complètement insensé aujourd’hui ! s’excitait alors don Fermín Antonio, s’arrêtant et parlant tout seul.
Finalement, à peine quelques mètres plus loin, exquise, se trouvait la cave parfaitement bien climatisée où grand-père gardait sa grande réserve des meilleurs vins rouges de France, car il avait toujours penché pour les bordeaux et les bourgogne. Sur un des côtés se trouvaient aussi le vin blanc et des douzaines de bouteilles de Dom Pérignon, son préféré parmi les grands champagnes.
Don Fermín Antonio adorait allumer un instant la lumière de sa cave et jeter sur tout cela un coup d’œil quotidien, aussi fugace que savoureux. Puis il reprenait le long couloir qui le conduisait jusqu’au garage où l’attendait Claudio, coiffé bien entendu de la casquette qui correspondait à l’uniforme qu’il avait mis ce jour-là, et toujours bien droit à côté de la Chrysler bleu nuit, porte arrière droite grande ouverte, pour que le caballero puisse monter.
Une fois le grand-père installé sur son siège habituel, la porte de la rue était ouverte par le jeune majordome Honorato, bras droit du parfait et éternel Horacio, premier majordome de l’hôtel particulier espagnol de don Fermín Antonio. Un signe d’Honorato indiquait à Claudio le moment précis où il pouvait reculer jusqu’au trottoir, d’abord, et se placer ensuite sur la chaussée latérale gauche de l’avenue Alfonso Ugarte, quand on regarde de la place Bolognesi vers la place Dos de Mayo. L’avenue Alfonso Ugarte avait été la première artère à quatre voies de Lima et, fruit de l’argent, du hasard ou de la plus absurde et même de la plus ridicule des rivalités, c’est là que s’élevaient les demeures des quatre plus gros banquiers du Pérou. Enfin venait l’éternelle question deux fois répétée chaque jour par Claudio, et toujours à la même et très ponctuelle heure de toute la vie :
– Quelle direction le caballero prendra-t-il pour l’occasion ?
– La banque, Claudio ; ayez l’amabilité de prendre la direction de la Banque Nationale du Pérou.
– À votre service, don Fermín Antonio. Et je vous prie de me pardonner si je vous tourne le dos.
– Ne soyez donc pas sot, Claudio. En ce qui me concerne, je ne vois pas d’autre façon pour vous de conduire ce véhicule sans nous tuer tous les deux.
Il va sans dire que le chemin choisi était toujours le même, sauf en de très rares occasions où don Fermín Antonio décidait de faire une petite partie du parcours à pied, suivi de très près par Claudio au volant de la Chrysler, poussé qu’était ce très liménien caballero par le désir de voir comment grandissait sa belle cité et de penser chaque fois à la niaiserie de certaines personnes qui utilisaient l’expression Je vais à Lima, lorsqu’elles se trouvaient dans tel ou tel quartier, par exemple Barranco, Miraflores ou San Isidro, ignorant que ces quartiers et tous les autres formaient le Grand Lima, et que dans ce cas la correction aurait voulu qu’on dise Je vais dans le centre de Lima ou Je me dirige vers la zone du Cercado… Ou aussi, évidemment, Ma destination, cette fois, est le Damier de Pizarro.
– Et en plus avec des majuscules, Claudio. Avec des majuscules. Vous m’entendez ?
– Bien sûr, don Fermín Antonio, répétait éternellement Claudio, en ouvrant la portière de la Chrysler pour que le caballero puisse occuper de nouveau son siège habituel, d’un bleu marine très foncé, évidemment.
– C’est qu’il y a des gens qui, non contents de rapetisser la ville où ils sont nés, ne prennent même pas la peine de mettre les majuscules qui s’imposent pour chacun des exemples cités, Claudio.
– Ne vous inquiétez pas, don Fermín Antonio, désormais je ferai très attention aux majuscules chaque fois que j’écrirai les mots susdits. Et merci pour la leçon.
– Merci à vous pour ce trajet, Claudio, répétait quotidiennement grand-père Fermín Antonio, matin, après-midi et enfin soir, en rentrant à sa résidence de l’avenue Alfonso Ugarte ou en allant au Club National, auquel cas Claudio l’attendait très ponctuellement une heure et demie de plus, avant d’entreprendre le trajet final et d’échanger avec lui, cette fois oui, dans le garage de la grande demeure, des souhaits de bonne soirée.
Le Club National était l’une des nombreuses institutions que, tout comme auparavant l’Assistance publique, la Caisse des dépôts et consignations ou la Banque centrale de réserve du Pérou, et maintenant sa propre banque, présidait ou avait présidées don Fermín Antonio, bien que rien de tout cela ne l’ait jamais empêché d’arriver au club, le mardi et le jeudi, chronométralement, à huit heures moins dix du soir, car le mardi il y trinquait avec son vieil ami Ezequiel Lisboa, et le jeudi il y répétait exactement les mêmes souhaits à don Felipe José de Zavala, autre de ses grands amis, en employant pour ce faire les mêmes mots ronflants mais cependant sensibles. Et au même instant, chaque mardi et chaque jeudi, les bons amis levaient leurs petits verres remplis d’un très vieux Rémy Martin, esquissaient un petit entrechoc de cristal et prononçaient aussitôt, à l’unisson, leurs souhaits de bonheur.
– Et c’est pour cette raison, Madamina, aucun doute là-dessus, que je n’ai jamais bien saisi ce que me disent ces excellents messieurs.
– Eh bien laisse-les te porter leur toast d’abord.
– Ça, jamais, Madamina.
– Alors surprends-les en levant ton verre à sept heures cinquante-neuf pile. Ils ne peuvent pas t’interrompre, Fermín Antonio, et je n’imagine pas non plus qu’Ezequiel Lisboa ou Felipe José Zavala…
– De Zavala, Madamina.
– Bon sang, Fermín Antonio, que ce toast est donc difficile. Mais bon, je recommence. Je disais que je n’imaginais pas non plus Ezequiel Lisboa, le mardi, et Felipe José de Zavala, le jeudi, anticipant sur ton toast avec les leurs. Laisse-les donc s’entre-tuer pour lever leur verre à ta santé.
– Si les choses de ce monde étaient aussi peu compliquées que tu les vois, Madamina, fit don Fermín Antonio en émettant un grognement long et tendu, comme quelqu’un qui fait un effort surhumain pour comprendre, tout d’un coup, toutes les choses de ce monde, afin de pouvoir ensuite, après les avoir beaucoup simplifiées, expliquer à son épouse tant aimée que nous vivons dans un monde chaque jour plus difficile à comprendre et à expliquer. Oui, crois-moi, ma chère, crois bien que si ce n’était pas le cas, il n’y aurait pas eu de Première Guerre mondiale. Et je dis première parce que tu verras qu’il y en aura une deuxième. Et ensuite, Madamina, devine quoi ?
– Eh bien le monde progressera, oui, Fermín Antonio.
– Vraiment, ma chère, je suis ravi que tu lises tant le dénommé Azorín, celui dont les critiques parlent, si ma mémoire est bonne, comme du philosophe du petit, rien que ça. Ce à quoi j’ajouterais : du philosophe de l’insignifiant et de l’absurde.
– Eh bien moi, au contraire, j’aime de plus en plus Azorín.
– Alors en avant, Madamina. Et comme cela jusqu’à ce que le monde disparaisse.
– Je te trouve un peu pessimiste aujourd’hui, Fermín Antonio. Parce qu’à dire vrai…
Et le fait est que la vie de ce caballero, aucun doute là-dessus, n’était pas le chemin de roses que tant de gens imaginaient, loin de là. À commencer par son père, autorité morale et familiale qu’il était impossible à un chrétien comme lui de ne pas reconnaître et de ne pas respecter, cela va sans dire, mais que la nature s’obstinait à garder en vie, dans un exceptionnel exemple de longévité : cent quatre ans tout ronds, rien que ça, mais fumant tellement, et Dieu seul sait depuis quand, qu’on aurait dit que, sur ces cent quatre ans, quatre-vingt-dix au moins s’étaient passés à fumer comme un pompier du tabac brun importé, et en plus juste à côté d’une véritable kyrielle de réservoirs à oxygène, et ce, depuis plusieurs années… Bon sang, que cette vie peut être absurde et même misérable, quelle misère que cette vie, réellement, et pourquoi donc, lors de cet accident fatal où avait péri une grande partie de la fratrie, n’avaient survécu que lui-même et Fernando, son deuxième frère, bien qu’il eût mieux valu que ce dernier meure aussi, de son point de vue du moins, car sa vie d’incurable ludopathe l’avait même entraîné jusqu’à la prison et finalement jusqu’au mépris de la société où il lui avait été donné de vivre.
Combien de fois don Fermín Antonio aurait-il pu le refréner, le chasser de la famille et même du pays, mais il avait toujours été arrêté dans cet élan, si naturel et si logique, d’ailleurs, oui, il avait été retenu par une absurde et fraternelle impossibilité d’affronter ce cheval sauvage et sans bride, et avait au contraire toujours choisi de le couvrir et de le protéger, dans la mesure de ses possibilités, bien entendu, jusqu’au jour où il se sut incapable de quoi que ce soit et où Fernando se précipita dans un abîme où il disparut à tout jamais, selon les plus crédules, mais non sans avoir auparavant couvert de boue un nom très honorable, ruiné à tout jamais de gros investissements familiaux, tels qu’une magnifique exploitation sucrière, dans le Nord, et une autre, cotonnière, dans le Sud, et lui avoir fait perdre à lui-même le contrôle absolu d’une grande banque dont bien des gens continuaient à croire qu’elle était entièrement à lui.
Pourtant, Fernando n’avait pas disparu, et ils avaient tout à fait raison, ces individus qui affirmaient qu’on voyait encore cet homme dans des tripots de perdition, où les parties étaient accompagnées d’opium, et celui-ci d’odalisques et des rêves les plus enfiévrés, jusqu’au jour où une âme pieuse, l’adorable cousine Rosa María Wingfield, infinie beauté anglo-saxonne dont les portraits ornent encore plus d’un salon familial, l’arracha à ces faubourgs infects, disparut avec le ludopathe, déjà atteint de tuberculose, et s’enterra vivante avec lui à Jauja.
De cette union miraculeuse naquirent quatre enfants, tous appelés De Ontañeta Wingfield, et tous au cours des années heureuses que le grand-oncle Fernando passa au sanatorium de Santo Toribio de Mogrovejo, où il mourut très exactement à vingt-trois heures cinquante-neuf le 31 décembre 1899.
– J’ai toujours aimé faire chier le monde, furent à ce qu’on assure ses dernières paroles, mais on ne put jamais arracher un oui ou un non à ce sujet à l’éternellement jeune et toujours extraordinairement belle tante Rosa María Wingfield.
En revanche, cette grande beauté devait dire un oui catégorique à un membre de la bonne société de Jauja qui répondait au nom d’Hermenegildo Poma Sifuentes, à qui la seule chose que ne pardonna jamais don Fermín Antonio fut d’avoir baptisé de l’horrible prénom d’Arminda sa fille unique, qui à sept ans arriva à Lima pour recevoir une éducation comme il faut, et que nous devrons toujours accueillir, par conséquent, et tout spécialement en pensant à tout ce qu’a signifié pour nous tous Rosa María Wingfield, d’une beauté et d’une bonté infinies, bien qu’elle soit aujourd’hui devenue Rosa Maria Wingfield de Poma, rien de moins.
Mais en fait, la seule chose que don Fermín Antonio ne pardonna jamais à Rosa María Wingfield et à Hermenegildo Poma fut d’avoir toujours appelé leur fille Armindita et non Arminda, et de longues années devaient s’écouler et une grande tragédie familiale se produire avant que don Fermín Antonio s’aperçoive que cet horrible diminutif était le vrai nom de baptême de l’enfant, et non Arminda, comme il s’entêtait à le croire.
– Non, cette enfant ne te regarde même pas, Madamina, si tu l’appelles Arminda. Elle ne fait absolument pas cas de toi. Essaye toi-même, Madamina… Tu vois ? En revanche, dès que je l’appelle Armindita, remarque-le bien, elle se jette tout heureuse dans mes bras.
– Cela doit avoir à voir avec les Andes, Fermín Antonio.
– Écoute-moi bien, une fois pour toutes, Madamina : dans cette famille, la seule chose qui vienne des Andes, ce sont les domestiques, et encore, pas tous, car il y a même un citoyen chilien aux yeux verts et de très belle prestance qui travaille pour nous, je me trompe ? Et ne me sors pas maintenant ton éternel C’est que tu as l’air d’un Anglais en hiver et d’un Andalou en été. Je suis péruvien, aussi péruvien que cette enfant au diminutif atroce. Mais je passe l’été dans la station balnéaire de La Punta, et pas à cinq millions de kilomètres au-dessus du niveau de la mer, disons au bord d’un lac quelconque, d’un marais, quelle horreur, ou ce qui est encore pire, s’il peut y avoir quelque chose de pire, bien sûr, au bord d’un lac immense et glacé horriblement appelé Titicaca.
– Mais, Fermín Antonio, qu’est-ce que ça peut te faire que cette enfant s’appelle Arminda ou Armindita, puisque de toute façon elle est très belle ?
– Alors tu continues à plaisanter sur ce sujet ? Eh bien, cette fois, le club est ouvert et j’y vais tout de suite. Et toi, tu peux te noyer avec ton Armindita dans tout ce titi et tout ce caca, si tu aimes tant… si tu aimes tant… Bon, si tu aimes tant et point final !
Et comme ce jour-là, et à cette heure-là, il n’avait jamais rendez-vous avec personne, Fermín Antonio était à son club pour fuir toutes les Armindita qui ont été et seront jamais en ce bas monde, et pour retomber lentement dans les années où, quittant sa maison de campagne de Chorrillos, un peu vieillotte mais très vaste et très belle, d’abord, puis, quelques années plus tard, et après la naissance de ses deux seules filles, car il n’y eut pas de fils, immense et très muette peine pour don Fermín, sa très belle maison à hautes colonnes et grands jardins de San Miguel, lieu dont le climat avait toujours bien convenu à sa faiblesse pulmonaire congénitale, il avait décidé de faire appel à un grand architecte pour qu’il lui construise, sur la toute nouvelle avenue Alfonso Ugarte, la première artère à quatre voies du Pérou, la grande demeure espagnole dont il avait toujours rêvé.
C’est dans les mêmes années que don Fermín Antonio avait fait bâtir aussi la belle maison d’été pieds dans l’eau, dans la très raffinée péninsule de La Punta, avec un grand patio et un énorme jacaranda au milieu, et qui, comme lui, si souvent et contre tout pronostic, avait survécu. Dans cette station balnéaire, le très grand, très maigre et très sec don Fermín Antonio de Ontañeta Tristán allait nager tous les matins, à midi pile et, chaque soir, il ressortait pour se promener sur l’élégante jetée Figueredo, où eurent d’ailleurs lieu tant de ses furtives rencontres amoureuses, bien après l’heure du dîner familial et même à l’aube, le plus souvent, que plus d’une fois il termina réfugié sur un toit complètement plongé dans l’obscurité. Et avec une telle mauvaise chance, en une maudite occasion, que dans sa tentative de fuite désespérée, et à l’aveuglette, il fit une chute de deux étages, comme un vulgaire sac de patates, et se retrouva au beau milieu du jardin du tailleur Arana, un chaplinesque petit vieillard au bon savoir-faire professionnel duquel don Fermín Antonio devait des mesures de dos et d’épaules qu’il n’avait jamais eues. L’estival caballero se fit une fort vilaine fracture à la jambe droite, si bien que lorsque le tailleur, tout étourdi, sortit voir ce qui se passait, Dieu saint et béni, et simplement avec un petit morceau de bougie, car l’éclairage électrique venait d’être momentanément interrompu, non seulement il s’occupa de don Fermín pour tout ce qui avait trait à la panique sociale que cette formidable chute aurait pu occasionner dans ce monde aussi ancien que paisible et bondieusard, mais il eut en outre la grande amabilité d’appeler les secours publics, en refusant catégoriquement, ça oui, de révéler l’identité de l’embarrassant blessé qui était étalé, furibond, dans le jardin de devant de sa maison, là, en pleine jetée Figueredo, rien de moins, alors qu’il était déjà deux heures du matin passées.
Finalement, toutefois, la pression exercée par le service ambulancier pour que le blessé soit sur-le-champ identifié était si forte que le tailleur, tout étourdi, ne put faire autrement que d’avoir provisoirement recours à un faux nom, on verra plus tard ce que décide don Fermín quand arriveront chauffeur, médecin de garde, infirmiers et ambulance.
L’honorable tailleur ignorait à coup sûr la gravité de l’état de don Fermín, et aussi que ce dernier, en réalité, était de minute en minute plus inconscient. Et si inconscient déjà, que par moments il commençait à voir le passé et le présent en même temps, et le tailleur Arana dans le même flou, Le tailleur Arana, messieurs, n’est rien de cela. C’est moi qui le dis, et que cela suffise. Le tailleur Arana n’est rien de ce que vous croyez, bordel. Qu’est-il alors ? Eh bien dans ce cas très particulier de célibat, messieurs, et étant donné la nature horriblement compliquée de la vie, je vous dirai que tout comme le tailleur Arana n’est pas membre de ce club, mais pas du Club de la Unión non plus, la réponse à votre question est que ce qu’est le tailleur Arana, et rien de plus, messieurs, c’est absolument célibataire, et en aucun cas pédé. Et tenons pour close cette discussion saugrenue sur la condition sexuelle du tailleur Arana…
– Quel prénom et quel nom dois-je donner, don Fermín Antonio ? se désespérait le pauvre tailleur. Quelle fausse identité souhaitez-vous que je donne, en prenant toutes les précautions, bien sûr ? Car il est de mon devoir de vous informer que chez doña María Luisa San Román, il y a un mari qui est fou furieux et des enfants qui crient justice et vengeance…
Les premiers accords d’une ambulance encore lointaine – telle était alors la douceur de la vie, ou plus exactement de la mort pour don Fermín Antonio, parce que, vu les circonstances, n’importe quelle solution, ou plutôt n’importe quel dénouement, revenait exactement au même pour le caballero bien hébété et même bien loin de tout déjà –, ces premiers accords très pâles et très fins, plus l’insistance de ce tailleur évanescent, dans sa démonstration, de plus en plus floue, d’affection et de solidarité humaine, obligèrent don Fermín Antonio, tout à fait plié en deux maintenant, à exhaler quelque chose comme un dernier soupir, ne fût-ce qu’à titre de test. Et c’est ainsi que, comme quelqu’un qui en une fraction de seconde récapitule absolument tout ce qu’il a vécu et même rêvé, à l’instant même de la mort, don Fermín Antonio ouvrit un œil qui essayait de se diriger vers le tailleur Arana, finit par le focaliser, et ce jusqu’au moment où lui vint également à l’esprit un nom qui lui sembla plaisamment approprié à une situation aussi embarrassante que douloureuse.
Quelques instants plus tard, le maigre et infortuné caballero traversait, tout heureux, un très beau pont, entièrement en argent, un pont qui avait en outre la vertu animée de quitter tout seul et juste juste à temps, à un poil près, en réalité, l’horrible maison style bateau de la tapageuse famille San Román, à vrai dire tout cela faisait penser don Fermín Antonio à un dessin animé, à un véritable Walt Disney, oui, et alors il se dit que ces gens-là, en commençant par le médecin et en finissant par le chauffeur, question premiers secours, comme on dit, et même médecine et autres sciences, oui, tout le monde dans cette ambulance devait en connaître un rayon, et même un sacré rayon, si on veut, mais question livres et littérature, en particulier, rien de rien, et c’était peu dire. Si bien que l’opinion générale, dans cette ambulance affolée et alarmante, tantôt rouge et tantôt blanche, et tantôt aussi blanche et rouge à la fois, comme le maillot de l’équipe nationale de football du Pérou, l’opinion générale, disions-nous, était que pour ce M. Dan ou Don Quichotte Mancha, étendu là, c’était une question d’heures et même de minutes, à en juger tant par son pouls que par son battement pectoral gauche, et également par ce petit miroir sur lequel il ne nous exhalait pratiquement rien, ce pauvre monsieur Dan ou Don, s’il vous plaît, dites-nous comment s’appelle exactement le blessé ? Parce que je dois tout noter ici, en date du 21 février à trois heures trente du matin… Quel est son nom exact, siouplaît ?
– Inscris qu’il s’appelle Dan Don Mancha ou Don Dan Mancha, quelque chose comme ça, vieux, parce que, vrai de vrai, tout ce qu’il y a de sûr dans cette ambulance, c’est que cette grande asperge que voilà ne prendra pas ce matin son petit-déjeuner à Lima.
Mais don Fermín Antonio de Ontañeta Tristán avait survécu pour fêter ça, la nuit dorée du nouvel an 1933 où il déménagea de San Miguel pour l’avenue Alfonso Ugarte avec toute sa famille, augmentée désormais d’une Armindita Poma Wingfield, que pouvons-nous y faire, bien que la gamine, qui allait à cette époque sur ses neuf ans, à part son atroce diminutif, soit un véritable amour, mais famille non constituée de fils, terrible douleur pour lui, aucun doute là-dessus, Dieu l’aura voulu ainsi.
C’est avec un grand bal que le très maigre et élégantissime caballero inaugura la résidence la plus belle et la plus originale que de nombreux Liméniens se rappellent avoir vue au cours de ces décennies. Et la plus insolite, aussi, car d’un point de vue strictement architectonique, elle n’avait que très peu, ou même rien du tout à voir avec aucune des autres grandes demeures de Lima.
Et cela, en effet, parce que don Fermín avait pratiquement fait un calque, vraiment très hidalgo, pour la façade et quelques détails de sa très élégante et très rigide bâtisse, d’une série de palais d’Estrémadure, qu’il avait visités dans des villes comme Cáceres et Badajoz, en compagnie de divers architectes péruviens et espagnols. Et c’était à cela qu’était dû le dessin rectiligne de ses portes et de ses fenêtres, le gigantesque porche muni d’un heurtoir très foncé et très rustique, les grosses marches de granit qui menaient à une deuxième porte d’entrée dans la maison, avec sur les côtés deux larges socles, également de granit, sur lesquels reposaient deux énormes lions de bronze.
Une haute porte de chêne très sombre et aux impénétrables vitres de verre taillé permettait ensuite d’entrer dans un grand salon blanc à dalles de marbre, blanc également, entre les longs et austères bancs duquel – toujours de bois très foncé – douze statues de marbre blanc reposaient sur des piédestaux également de marbre, et venaient ensuite, précédés par deux belles et très hautes portes de bois blanc et de verre biseauté, un immense salon doré et un inoubliable patio, très légèrement andalou, à toit pyramidal de verre très fin, toute une aventure pour le petit garçon ou la petite fille qui aurait tenté l’exploit d’aller d’une extrémité à l’autre, en suivant la chatesque progression ascendante, d’abord, puis descendante, par laquelle Horacio, armé de toute sorte de plumeaux, chiffons et liquides indiqués pour cette tâche, gardait absolument propre ce toit à deux pentes, jusqu’au jour où un très dangereux malaise, en pleine traversée, montra à l’évidence que le premier majordome n’était plus d’âge à accomplir ces travaux d’équilibriste. Raison pour laquelle il fut immédiatement remplacé par son jeune neveu Honorato, qui d’ailleurs réalisa sa première escalade et la descente qui la suivit en présence de la moitié de la famille, et avec une si étonnante facilité qu’il montra une fois de plus, à l’évidence, à quel point il aspirait à accéder à la place de premier majordome sitôt que son oncle Horacio prendrait sa retraite, ou même avant, s’il était rappelé plus tôt.
Bien entendu, il y avait aussi, au rez-de-chaussée de cette noble bâtisse, une ample salle à manger carrée dont les quatre murs étaient lambrissés, jusqu’à une hauteur d’un mètre quatre-vingt-dix, de boiseries sombres et très sobrement sculptées, et toutes couronnées d’une large moulure sur laquelle reposaient de grands plats d’argent, et au-dessus de tout cela, pendant presque du plafond, quatre immenses gobelins tissés en France et qui tous les quatre reproduisaient d’imaginatives scènes de chasse dans lesquelles, outre de terribles animaux et des meutes entières, abondaient les faunes, les Cupidon, arc et fléchettes en main, les Diane chasseresses, les nymphes et les très expérimentés chevaliers de la forêt, avec grand étalage d’arcs, de flèches, de quelques trompettes et tous d’une intrépidité et d’une adresse équestres et forestières absolument remarquables.
Là, de plus, dans un coin du salon blanc aux statues de marbre, et à côté d’une vaste pièce destinée au piano à queue, se trouvait depuis toujours, mais sans aucune fonction pour le moment, un autre petit salon, très bien décoré, avec des meubles de prix, parmi lesquels se distinguait une inoubliable vitrine, remplie, ça oui, des mille et une babioles que doña Madamina achetait en Europe, voyage après voyage, et toujours avec l’assentiment de grand-père Fermín Antonio, et comment, car il profitait de ces merveilleux moments pour aller regarder quelques culs à Madrid, Paris, Rome ou Londres. Et il y avait aussi, pour finir, deux très blancs cabinets de toilette, l’un pour la famille et les visites, et l’autre pour l’usage très exclusif de don Fermín, qu’il avait l’habitude de fermer lui-même et presque de murer quand il y avait des visites, pour éviter toute erreur ou confusion. Et c’est avec ces deux petits cabinets de toilette blancs, très blancs, que se terminait la partie noble de ce rez-de-chaussée.
Il y avait, ça oui, un dernier détail, sur l’origine duquel couraient d’ailleurs deux versions qui s’excluaient complètement l’une l’autre. La première disait que les armoiries des De Ontañeta qu’on voyait au-dessus du grand porche de l’entrée, en plein sur cette façade de si estrémadurienne élévation, avaient été placées à la demande de don Fermín Antonio lui-même, après mille et une circonlocutions qui avaient accablé le bon connaisseur qu’était l’architecte, bien que don Fermín Antonio ait toujours allégué, à sa décharge, et dans la seconde version de ces mêmes faits, que c’était ce flagorneur d’architecte qui, profitant du fait qu’il se trouvait en Europe avec toute sa famille, avait plaqué là le blason en question, sans la moindre autorisation. Et chacune de ces deux versions pouvait être parfaitement vraie, assurément, même si avec le temps ce que les gens finirent par réellement se demander, c’était pourquoi, si un flagorneur lui avait flanqué en pleine façade les armes des De Ontañeta, en profitant de l’un de ses élégants voyages en Europe, le caballero indigné et tout surpris n’avait à son retour absolument rien fait pour les retirer. Et c’est ainsi qu’aujourd’hui encore le très seigneurial, mais aussi, faut-il dire, le très inventé écu des De Ontañeta est à sa place au-dessus du porche.
– Cela donne à penser, cela donne beaucoup à penser, se disaient les gens en considérant les choses de ce second point de vue, bien qu’il soit également certain que dans Lima tout entière il ne se trouva aucun homme capable de poser à don Fermín Antonio la moindre question au sujet dudit second et si suspect point de vue.
Mais pour revenir à l’intérieur de la grande bâtisse de l’avenue Alfonso Ugarte, et après en avoir terminé avec le rez-de-chaussée, le moment était venu de monter le très large escalier blanc qui menait au premier, et qui s’arrêtait d’abord à l’entresol, où se trouvait l’inimitable et vraiment unique salon-bureau-bar où don Fermín, à part recevoir ses meilleurs amis pour boire quelques verres avec eux, lisait et relisait toujours les mêmes livres, en commençant bien évidemment par Don Quichotte, dont l’immense édition illustrée et reliée en cuir bleu, avec ses quatre initiales en or repoussé sur son large dos, reposait toujours sur une petite table qui allait parfaitement bien avec les autres meubles d’acajou très foncé et à pattes de lion, aux très sobres incrustations de bronze, tous venus de Londres expressément pour cette si austère et si seigneuriale pièce.
Et, finalement, le moment était venu de continuer à monter ce très large escalier en constatant que le mélange d’élégance et d’austérité estrémaduriennes se répétait tout au long du grand couloir qui menait aux chambres, aux dressings et aux salles de bains, et à la grande terrasse sur laquelle don Fermín sortait chaque jour et où se trouvaient les deux grandes maisons pour chiens, à toits à double pente et couverts, même, de petites tuiles absolument absurdes, destinées à Porthos et à Aramis, ses deux molosses, que Claudio, Horacio et Honorato promenaient chaque jour, matin et soir, et qu’un vétérinaire prussien à grande moustache venait baigner et examiner jusqu’à trois fois par semaine, surtout en été. Porthos et Aramis furent deux des plus grandes joies de la vie de Fermín Antonio, et c’est à coup sûr pour cela que dès qu’ils furent vieux et que l’un d’eux fut devenu aveugle, le caballero décida de les sacrifier tous les deux et renonça à tout jamais aux animaux.
À l’hôtel particulier estrémadurien de l’avenue Alfonso Ugarte, don Fermín ajouta quatre maisons, dont deux étaient destinées à ses deux filles, María Magdalena et María Isabel, le jour où elles se marieraient, bien sûr. Chose étrange, les deux jeunes femmes eurent toujours l’écriture pointue classique du collège San Pedro, bien qu’elles n’y eussent jamais mis les pieds, vu qu’elles furent exclusivement élevées à la maison par des institutrices françaises et anglaises et par des professeurs de piano allemandes, à quoi s’ajoutèrent quelques activités propres à leur sexe, comme le raccommodage, la dentelle et le crochet, pour ce dernier surtout dans le cas de María Isabel, qui était maigrichonne et très nerveuse, raison pour laquelle les travaux vraiment familiaux lui convenaient mieux, car au piano tant le génie de Beethoven et Schubert que celui de Chopin et Liszt l’énervaient toujours trop, pour ne pas dire que ces compositeurs déclenchaient souvent chez la pauvre petite de véritables crises d’une passion des plus fiévreuses et des plus tourmentées, quand ce n’était pas simplement des crises de rire, ou, ce qui était bien pire, de franche hystérie. Enfin, patience, le temps fera son affaire, et alors Dieu y pourvoira, disait toujours dans ces cas-là doña Madamina, bien que don Fermín n’aimât vraiment pas du tout laisser les choses de ce monde entre les seules mains de Dieu, car la dénommée Divine Providence nous a assez pourri la vie à mon père et à moi.
Mais bref, pour en revenir une fois de plus à l’avenue Alfonso Ugarte, au sujet des maisons construites par le maigre et sec caballero en plus de la sienne, il reste à dire que la troisième de ces quatre belles demeures avait depuis toujours été destinée à héberger les enfants de son frère Fernando, tandis que la quatrième fut jusqu’à sa mort à la disposition des amis dont la fortune avait décliné, car pour y en avoir, il y en a, j’en sais malheureusement quelque chose, vous pouvez me croire, se lamentait souvent le caballero.
Et, bien entendu, comme pour les précédentes inaugurations d’une nouvelle résidence, don Fermín Antonio de Ontañeta Tristán fit un voyage en Europe avec toute sa famille, quelques jours à peine après la grande fête qu’il avait donnée ni plus ni moins pour que les gens n’aillent pas croire un seul instant, comme on avait coutume de le murmurer à Lima, qu’à cause de ses si nombreuses et si énormes dépenses le pauvre caballero se retrouvait sans le sou.
Bien sûr, le terrible journaliste Fausto Gastañeta en profita pour publier l’une de ses chroniques sociales toujours très lues et carillonner à tout vent que don Fermín et sa famille, pour l’occasion, avaient décidé de prolonger leur habituel périple européen, à savoir Madrid, Paris, Rome, Vienne, Londres, et point final, jusqu’à la Russie elle-même, puis jusqu’à l’exotique Moyen-Orient, et finalement jusqu’au très lointain et très inquiétant Extrême-Orient. C’est ainsi que don Fermín et sa famille s’en allaient cette fois jusqu’au Japon et la très lointaine Chine, rien de moins, mais famille au grand complet, écrivit le perfide Fausto Gastañeta, car il faut savoir que pour l’occasion celle de don Fermín inclut une enfant qui ne répond qu’au nom d’Armindita Poma, et jamais à celui d’Arminda Poma Wingfield, qui est celui qui de fait et de droit lui correspond, allez savoir pourquoi, gentes dames et caballeros lecteurs.
Bien que pour des raisons professionnelles don Fermín Antonio de Ontañeta Tristán ait dû rentrer bien plus tôt, très discrètement, ça oui, doña Madamina, ses deux filles et Armindita Poma voyagèrent cette fois-là presque jusqu’à l’exténuation. Et si don Fermín ne fit pas assassiner Fausto Gastañeta, c’est tout simplement parce que cet insolent va-nu-pieds n’était rien de moins qu’un neveu de son épouse, et de plus, le fils d’un grand ami à lui.
Et ce fut le même infâme chroniqueur qui, lors de l’heureuse inauguration de la demeure de l’avenue Alfonso Ugarte, et non content de faire voyager à n’en plus finir sa tante Madamina, ses filles et sa jeune nièce, mit dans la bouche de doña Zoraida ou doña Etelvina, deux vieilles cancanières et snobinardes, produit de son imagination oisive, et qui déambulaient dans les rues de Lima en lâchant toutes les inepties possibles, tout simplement la bêtise suivante :
– Regarde-moi un peu, ma chère, quel joli châlet s’est fait côstruire don Ferminacho du Haut Toupet.
Cette fois, il fallut appeler don Fermín Antonio au calme et à la prudence, bien qu’il ne pût pas permettre un seul excès de plus à ce crétin de Fausto Gastañeta, qui, se prenant pour un humoriste et le chroniqueur de la vie sociale de Lima, ne cessait de faire étalage d’un irrespect sans nom, pense à ses pauvres parents, Fermín Antonio, putain, bien sûr que je pense à ses parents et aussi à ma pauvre épouse et à mes filles, mais quelquefois j’ai vraiment envie de provoquer ce guignol en duel.
– Laisse en paix ces merveilleuses cannes-épées, Fermín Antonio, et parle-nous encore de ces nouveaux projets. Je sais qu’ils existent et Felipe José le sait aussi. Et nous savons tous les deux que si tu nous as invités aujourd’hui à déjeuner ici au club, c’est pour nous annoncer quelque chose de nouveau.
– Eh bien prenons un bon petit verre avant de passer à table, messieurs.
Ils burent à la santé les uns des autres, et don Fermín Antonio leur raconta que, au fond, c’était à ce crétin de Fausto Gastañeta qu’il devait l’idée de fonder un journal d’opinion, qui ne rivaliserait pas nécessairement avec El Comercio d’Antonio Miró Quesada ni avec La Prensa de mon bon ami Pedro de Osma. Je sais parfaitement quelles idées et quels intérêts ils défendent, et je sais aussi que même s’ils sont parfois similaires en apparence, mes idéaux, d’une part, et mes intérêts, dans l’immédiat du moins, n’ont que peu ou rien à voir avec ceux de ces excellents messieurs. J’aimerais, en fait, représenter un secteur plus dynamique de la société, tel que la banque et certains secteurs miniers, et qui par ailleurs ne manquerait pas de rétablir certains liens avec le monde détruit par la tragique guerre avec le Chili, je veux parler des seigneurs du salpêtre, et même avec le monde d’avant, qui a complètement disparu, je le sais, comme je sais que c’est de ce monde aujourd’hui quasi centenaire que je proviens, par mes deux noms et par mon aïeul Pío Mariano de Ontañeta et Tristán.
– Et comment penses-tu appeler ce journal ?
– J’ai écarté plusieurs noms, comme El País, qui fait prétentieux, El Mundo, qui fait plus prétentieux encore, La Vanguardia que je trouve un peu rouge, et je me dis que le plus prudent serait de l’appeler La Voz de Lima. Les gens ne disent-ils pas souvent que Lima, c’est le Pérou ? Cela ne suffit-il pas, si pour être sincère avec vous, messieurs, je dirais que, pour moi, tant les Andes que l’Amazonie empestent, et que je les vendrais dès demain aux enchères sans y réfléchir à deux fois ? Et il y a même eu dans le passé une voix sensée pour suggérer de vendre ce pays si énorme et d’en acheter un autre, tout petit, si vous voulez, mais à côté de Paris, bien sûr.
– On devrait prendre les humoristes très au sérieux, mon cher Fermín Antonio, fit alors don Felipe José de Zavala.
– Mais au contraire on en fait des clowns, comme vous voyez. Mais bon, allons au fait, conclut don Fermín Antonio. Je trouve que La Voz de Lima sonne très bien.
– Et moi aussi, dirent presque en même temps don Ezequiel Lisboa et don Felipe José de Zavala. Lequel opina, de plus, quand les trois caballeros furent confortablement assis, dans la salle à manger du club, devant un excellent bourgogne pour accompagner leur déjeuner : tu pourras engager quelqu’un, Fermín Antonio, quelqu’un qui ait de l’humour mais aussi de la finesse, pour qu’il anéantisse ton crétin de neveu Fausto…
– Mais bien au contraire, mon cher Felipón, bien au contraire, tout au contraire… Et écoutez-moi bien, messieurs : c’est Machiavel, oui, Machiavel, qui affirme que l’une des meilleures façons disons de neutraliser, sinon d’écraser et même d’anéantir totalement un ennemi, c’est de créer une fonction pour lui. Il existe d’ailleurs un formidable précédent, à la Renaissance même. Là tout de suite, je ne me souviens pas de quel pape il s’agissait, mais ce qui est sûr c’est qu’un condottiere, un certain Malatesta di Rimini, quitta un jour ses terres pour Rome afin d’assassiner le pape en le poignardant. Et il était en pleine audience avec le Souverain Pontife, poignard en main déjà, quand le pape, qui était aussi sans aucun doute un très astucieux chef du Vatican, lui offrit un emploi de prestige. Eh bien croyez-moi, non seulement le dénommé Malatesta tomba sur-le-champ à genoux, mais de plus il jura et rejura au pape (ce qu’il accomplit au pied de la lettre, et sa vie en dépendait, d’ailleurs) qu’il donnerait tout pour lui et pour la papauté tout entière. Et c’est quelque chose de très semblable que fera mon grand crétin de neveu, ou plutôt ce crétin de neveu de ma pauvre femme. C’est moi-même, messieurs, qui lui proposerai un travail très bien rémunéré à La Voz de Lima. Et lui, il se changera très vite en une douce colombe.
– Vous prévoyez tout, mon cher ami, lui dit don Ezequiel Lisboa en levant son verre.
Et pour sa part don José Joaquín de Zavala ne voulut pas être en reste et leva lui aussi son verre :
– Vraiment, notre cher Fermín Antonio est un champion.
Un an plus tard paraissait le premier numéro de La Voz de Lima, et bien que durant les premiers mois nombreux aient été ceux qui disaient je ne sais ce qui peut bien arriver à El Comercio ou à La Prensa, pour qu’ils soient aussi ennuyeux ces derniers temps, non qu’ils lisaient l’un ou l’autre de ces journaux, non, mais La Voz de Lima, qui pour le peu qu’il avait de bien ressemblait à ses deux rivaux, mais les dépassait largement dans ce qu’il avait de mal ; il avait en tout cas permis à don Fermín Antonio de Ontañeta Tristán de s’ôter du pied la petite épine qu’avait toujours représentée l’humour de son jeune et audacieux, et désormais pardonné et même très cher neveu Fausto Gastañeta.
Et l’homme, en vérité, n’avait même pas osé demander pourquoi diable certains, à Lima, de but en blanc, s’étaient mis à le surnommer Malatesta de Rimini, et même, pour les plus pédants et italianisants, Malatesta di Rimini, alors qu’en réalité, le seul point sur lequel il s’était autocensuré, c’était en ce qui concernait le surnom de sa grande asperge sèche d’oncle Fermín, qui de Largo Caballero[4], sobriquet que Fermín Antonio avait toujours abominé parce que c’était le nom d’un célèbre homme politique rouge espagnol, s’appela du jour au lendemain don Fermín non à la Triste, mais à la Longue Figure ; cela avait signifié un véritable faux pas dans la carrière journalistique de Fausto Gastañeta, mais ce qui est sûr, c’est que sa tante Madamina s’appelait Basombrío avant de s’appeler Gastañeta, nom maternel, plutôt, dans le cas de ladite tante, ce qui fait que le jeune journaliste ne voyait pas de ce côté non plus une grande faute ou un faux pas.
Mais c’est alors que le pauvre homme fit un vrai dérapage, alpin et plus qu’enneigé, et tout cela simplement pour avoir essayé de redresser la barre, oui, simplement pour avoir essayé de récupérer la faveur de son public souriant et plutôt rebelle et progressiste, dans ce monde où, malgré tout, les hommes comme son oncle étaient les maîtres des premières classes, du gendarme et même de tout désordre apparent. Et là, alors, sûr que le pauvre chroniqueur avait fait une énorme gaffe, en appelant don Fermín Antonio, bien que simplement de façon allusive et tout à fait désinvolte, Caballero de la Triste Figure, en se disant que tant le public que le caballero lui-même ne verraient là qu’une façon très perspicace et indirecte de lui recoller le surnom de Largo Caballero.
Eh bien non. Non seulement La Voz de Lima atteignit son plus fort tirage ce jour-là, mais il réussit à rendre don Fermín doublement heureux. Les bonnes affaires avant tout, bien évidemment, mais tant chez lui qu’au club, ce que fêta vraiment le longiligne caballero, ce fut un surnom qui au fond le rendait heureux, et le retour au bercail de ce neveu rebelle, typiquement liménien et vraiment insolent, tout cela à l’excès.
Et ce matin-là, ce fut un don Fermín Antonio tout enorgueilli qui décida de ne pas déjeuner chez lui, comme il le faisait toujours, mais d’inviter, pas à son club, non, ça, jamais, ni au Club de Régates de la Punta, non, pas question non plus, mais plutôt voyons voir pour quel restaurant nous allons nous décider, non, c’est ça, plutôt, oui, et maintenant mademoiselle, s’il vous plaît, appelez M. Fausto Gastañeta et dites-lui, écoutez-moi bien, Dorita, dites-lui textuellement qu’il est invité à déjeuner aujourd’hui même, à une heure trente de l’après-midi, et que je l’attends dans mon bureau, mais dans ce bureau de ma banque, Dorita, pas dans celui du journal ni nulle part ailleurs, ce qui veut dire qu’il est formellement invité à une heure trente précise aujourd’hui, et absolument pas ailleurs, ni un autre jour ni à une autre heure, entendu ?
Comme il fut toujours parfaitement entendu, au moins par cet oncle machiavélique et son neveu, qu’ils tiendraient tous les deux leurs familles respectives sur des charbons ardents, jusqu’à très tard cette nuit-là. Et le lendemain, la dernière chose dont ils se souvenaient tous deux c’était d’une peña des Quartiers Hauts, où de bruns sandungueros avaient débité des kyrielles de valses et de marineras, et il y avait même eu quelques chansons dont les paroles faisaient allusion à un certain Sire à la Triste Figure, pour don Fausto, ça c’est pas possib’, mais peut-êt’ bien que pour l’aut’ don, si tu veux, mais plutôt pasqu’il est étique que…
– Plutôt parce qu’il est quoi ?
– Étique, nègre inculte ! Consulte un peu le dictionnaire !
On n’explique jamais ce genre de choses à son épouse, c’est bien certain, mais il fut très clair pour Madamina que son si cher et si plaisantin neveu avait, quoi qu’il en soit, connu son Waterloo la veille au soir. Et il fut aussi très clair pour elle que, finalement, l’amour de son mari pour tout ce qui était la famille lui avait fait accepter qu’Armindita Poma Wingfield ne serait jamais Arminda Poma Wingfield, mais qui plus est, en plusieurs occasions, une très souriante et très heureuse doña Madamina avait surpris son toujours si élégant, si perspicace et si aseptique époux allongé par terre, marchant péniblement à quatre pattes, ou s’écrasant après une pirouette sur l’immense tapis du salon doré, au grand péril de tant de candélabres de cristal et de tant de statuettes de porcelaine ad hoc, de plus ; bref, n’importe quoi, pourvu qu’il rendît heureuse la jolie petite nièce qui, comme nous le savons absolument tous dans cette maison, de même que tout le monde à Lima, n’a absolument rien d’andin ni d’andine, absolument rien, ça non.
[1] Les mots et expressions en italique et suivis d’un astérisque sont en français dans le texte. (Toutes les notes sont du traducteur.)
[2] Guillermo Enrique Billinghurst, élu président du Pérou en 1912, et renversé par l’armée en 1914 à cause de ses actions en faveur des travailleurs.
[3] Nicolás de Piérola, président du Pérou de 1879 à 1881 (suite à un coup d’État), puis (constitutionnellement élu) de 1895 à 1899.
[4] Largo Caballero, textuellement “Long Chevalier”, d’où le jeu de mots que fait Fausto à partir de “Chevalier à la Triste Figure”, surnom comme on le sait de Don Quichotte.