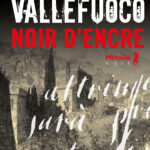Dans les livres de Galsan Tschinag, les nomades touvas de Mongolie dorment sous la yourte et traversent à cheval les étendues sauvages du Haut Altaï. Les bergers rassemblent leurs moutons. Un apprenti chaman chante des vers mystérieux... Etrange dès lors de rencontrer l'auteur dans un hôtel parisien, puis de s'attabler avec lui au bistrot d'à côté.
L'écrivain semble pour sa part à l'aise dans ce décor. Né en 1944 dans une famille, de chamans touvas de Mongolie, il a certes passé sa jeunesse en nomade mais a ensuite étudié à l'Université de Leipzig. Si Galsan Tschinag habite désormais Oulan-Bator, il raconte trois mois par an son monde en Europe et retourne vivre autant de mois l'an sous la yourte, avec les siens.
Deuxième volet d'une trilogie entamée avec " Ciel bleu " et qui se terminera avec " La montagne blanche ", " Le monde gris " (son troisième roman traduit en français) paraît ce trois octobre. Se prenant une fois de plus pour personnage, l'auteur s'y souvient d'avoir été enlevé à son milieu pour causes de scolarisation "civilisatrice". Cela donne un très beau récit, à la vigueur romanesque. Une histoire tout à la fois instructive, touchante et poétique.
Pourtant, Galsan Tschinag n'aime pas écrire. Il avoue : J'aime dormir, manger, paresser. Ecrire, je le fais contre moi. Je suis moi-même le cheval que je fouette. Le travail, c'est toujours le résultat de difficiles luttes intérieures. Je ne suis pas de ces nobles artistes qui ne sauraient pas vivre sans travailler. Ce qui ne m'empêche pas de me lever à quatre heures du matin pour écrire. C'est mon devoir. Pas seulement vis-à-vis de mon peuple, ma petite tribu, mais avant tout envers moi-même.
La " petite tribu " de l'écrivain n'a cessé de croître au fil du temps. Au début, elle était constituée par sa seule famille, puis par les Touvas de Mongolie, puis par tous les Mongoles, puis... Il se sent à présent partie intégrante de la toile cosmique, mais n'oublie pas pour autant de faire preuve d'humour. Il a beau, quand il écrit, avoir l'impression de devoir trouver les mots justes sinon un malheur se produira, dès qu'il redevient un citoyen ordinaire, il sourit de toutes ces pensées, se traite de petit fanfaron, de fou. Mais un fou qui ne fait de mal à personne
Galsan Tschinag ne joue pas les mages à trois sous. Si écrire est pour lui une sorte de prière, le mot " méditation " l'insupporte : Ce mot tellement à la mode, je ne peux plus l'entendre ! En langue touva, de façon beaucoup plus simple et directe, nous disons " penser ", " réfléchir ". Il y a deux formes d'intelligence : la diabolique et la divine. La divine, que nous appelons " sagesse ", est présente en chaque enfant. Et ce livre que j'ai écrit, c'est la tentative de défendre, face à l'adulte vieillissant que je suis devenu, l'enfant que j'ai été un jour. Je veux mettre à genoux devant l'enfant que je fus le petit bourgeois matérialiste qui veille toujours en moi.
L'auteur porte sur ses héros un regard à la fois ému et étonné : Je ne suis que leur secrétaire. Je suis assis, j'observe ce qu'ils font, et la vie d'autrefois ressurgit, mais dans une lumière plus belle. Je souris. Il m'arrive de pleurer. Et ce que j'ai vu, je l'écris.
Il est beaucoup question de ciel dans les récits de Galsan Tschinag. Le ciel visible, qui est au-dessus de nos têtes, y a la part aussi belle que le ciel des dieux. Les deux semblent d'ailleurs n'en faire qu'un pour l'auteur. Cette fusion entre physique et religieux serait-elle une donne de la tradition touva ?
Nombreux sont ceux qui pensent que le ciel est au-dessus. Bien sûr, bien sûr que le ciel est au-dessus. Mais il existe aussi en nous. Le ciel est partout. Le pain que tu manges le matin est un morceau de ciel. Le sommeil que tu as le droit de goûter pendant la nuit est aussi une partie de ciel. Le ciel, c'est l'univers au sens de microcosme et de macrocosme.
La langue touva a un grand nombre d'expressions pour désigner la mort. Une des plus belles signifie " devenir ciel ". Si je pense au ciel en ces termes, je me perçois comme infime partie du tout, et à ce moment-là je me sens parent de tout être humain, confie l'auteur dans son parler d'homme sage.
Galsan Tschinag n'est pas le seul écrivain contemporain à nourrir ses histoires des traditions de son peuple. Le Tchouktche (du nom d'un peuple de Sibérie extrême-orientale) Rytkhéou fait de même, lui aussi dans une langue d'emprunt (le russe en l'occurrence, tandis que Tschinag écrit surtout en allemand). Quel regard porte l'auteur sur ledit Rytkhéou et tous ceux qui, dans leurs livres, racontent des façons de vivre en péril ?
Je connais personnellement Rytkhéou, tout comme je connais Aïtmatov. Nous sommes trois constellations de l'Est. Le premier est Tchouktche, l'autre Kirghize, et je suis Mongol, mais nous tirons en même temps le même attelage. Nous tentons de rendre plus accessible notre monde à l'Occident. Nous nous faisons le relais d'une façon de vivre originelle parfois qualifiée de " primitive " - mais " primitive " renvoie à " premier, primaire, qui est au début ".
Ma petite caractéristique par rapport à ces auteurs bien plus célèbres que moi est que leurs racines ne plongent pas aussi bas que les miennes. Reconnus et célébrés, ils sont devenus des citadins. Moi, je reste un petit berger tout simple. Je martèle le cuir pour faire des lassos. Je viens, d'une certaine manière, du passé de l'humanité.
Galsan Tschinag écrit en allemand, mais aussi en mongol ou en russe. Pourquoi l'allemand ? L'auteur résume : Si j'avais fait mes études à Paris ou à Dijon et pas Leipzig, j'écrirais en français. La langue en tant que telle n'est pour lui rien d'autre qu'un emballage. Il pense en images, dans une langue qui est à son avis celle des origines : la langue de la poésie. N'empêche, l'auteur mongol écrit un allemand séduisant. Il vient d'ailleurs d'obtenir le Prix Doderer en Allemagne.
Le frère du jeune héros et narrateur du " Monde gris " est tenté par le marxisme pur et dur. L'écrivain le fut-il aussi ?Bien sûr. Le marxisme a été le romantisme de notre temps. Celui qui, à quinze ou vingt ans, n'a pas succombé à la maladie du marxisme est un pauvre homme. Mais celui qui n'est pas dégrisé à cinquante ans au plus est un imbécile.
Quand il était enfant de la steppe mongole, Galsan Tschinag voulait être berger. Aujourd'hui écrivain, après avoir notamment été journaliste à Oulan-Bator, il avoue ne pas vraiment savoir ce qu'il est devenu. Je ne suis qu'en route. Mais vers où ? Il y a à peine dix ans, je ne savais pas que je pourrais mettre un jour les pieds à l'Ouest. Munich était pour moi à des années-lumière, et ne parlons pas de Paris, que je considérais comme une capitale du militarisme, peuplée de gens bêtes et vaniteux, raconte l'auteur en buvant paisiblement son thé non loin de Saint-Germain-des-Prés.
Et Galsan Tschinag d'ajouter : Ma guerre froide en Europe est terminée, mais pas ma guerre froide par rapport à l'Amérique. Pour y mettre fin, il faudrait que j'aille là-bas. Je ne le ferai que lorsque le président des Etats-Unis cessera de prétendre dicter sa loi à tous les peuples. Je suis chef d'une tribu et George W. Bush n'est rien d'autre pour moi que le chef d'une tribu. La seule différence est que la sienne compte des centaines de millions d'individus et la mienne quelques personnes. Une autre différence aussi : il produit des armes, et moi de la sagesse.
La présence de l'auteur à Paris (et donc ses dires reproduits ici) date d'avant le 11 septembre? Qu'ajouterait-il à cela depuis le fin fond de la Mongolie, où il est retourné depuis lors ?
Dans la presse
-300x460.jpg)