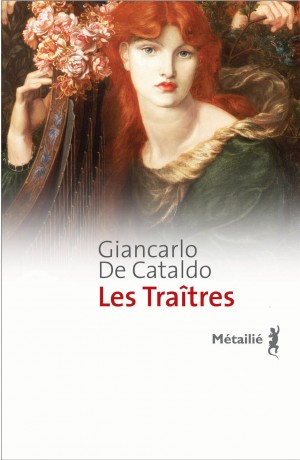1844 : dans la péninsule italienne partagée entre le royaume de Sardaigne et
du Piémont, les provinces du Nord aux mains des Autrichiens, le centre
occupé par les États du pape et le Sud, Sicile comprise, sous la férule
réactionnaire des Bourbons de Naples, un désir d’unification et de
démocratie monte de toute la société. Cette année-là, en Calabre, une
expédition de partisans se heurte à l’indifférence des paysans qu’ils voulaient
soulever, à la répression bourbonienne et à la trahison du bandit Calabrotto.
Le jeune Lorenzo di Vallelaura, noble vénitien déserteur de l’armée
autrichienne, arrache au bûcher Striga, une sorcière muette, génie des
nombres qui sera pour toujours son ombre bienfaisante. Face au peloton
d’exécution, Lorenzo accepte de devenir un traître à la solde de l’Empire
austro-hongrois. Plus tard, à Londres, placé auprès de Mazzini, l’un des trois
futurs pères de la patrie italienne, il sera mêlé à un demi-siècle d’intrigues
entre puissances européennes, marqué par des attentats, des complots et des
soulèvements aux quatre coins de la Botte. Face à lui, Von Aschenbach, chef
des services secrets autrichiens, homosexuel tourmenté, et son homologue
piémontais Vittorelli, cynique pourtant fasciné par l’autre grande figure du
Risorgimento, Cavour. Autour de lui, Striga, qu’il retrouve aux côtés de
Terra di Nessuno, l’héroïque guerrier sarde, et toute une société londonienne
extravagante et géniale, le peintre Rossetti, l’aristocrate exténué Chatam et la
très belle et très désirée lady Cosgrave, ardente adepte de la Cause. Le
chemin de Lorenzo et des autres croisera aussi bien celui de Garibaldi que
ceux de mafieux, de camorristes, de bandits anglais et de terroristes français.
Tandis que dans les coulisses agissent Karl Marx, Victor Emmanuel II ou
Napoléon III, nous sommes transportés de révolutions en réceptions
somptueuses, de tavernes milanaises en sordides prisons napolitaines, des
rues de Palerme en flammes aux chais du marsala, des bordels anglais aux
ghettos de Rome et aux laboratoires où s’inventent les premières machines à
calculer.
Faisant ici montre d’une puissance créatrice qui le porte encore plus
loin que son chef-d’oeuvre Romanzo criminale, Giancarlo De Cataldo brasse les
langues, les dialectes, les saveurs, les légendes et les chansons pour nous
restituer horreurs et splendeurs d’une époque encore en résonnance
profonde avec la nôtre. Maniant l’ironie de l’essayiste et la science du
feuilletoniste, il sait nous attacher aux destins individuels d’une nuée de
personnages, historiques ou romanesques, à leurs ambiguïtés, leurs vilénies
et leurs grandeurs, jusqu’à leurs fins amères, absurdes ou apaisées. A travers
eux, nous assistons à la naissance de cette grande nation moderne, l’Italie,
accouchée par les complots de politiciens, de terroristes et de mafieux.
-
« Les Traîtres de Giancarlo de Cataldo, publié chez Métailié, est un roman historique comme on les aime. C’est la formation de l’Italie contemporaine en mouvement, ce qui a présidé à la création de cette nation unifiée tardivement et les stratégies et coups tordus que De Cataldo nous narre par le menu. Par des chapitres courts et nerveux, on retrouve ici la verve de l’auteur de polar, il nous entraîne littéralement dans les manigances et machinations mises en œuvre par les différents protagonistes pour s’assurer la main mise sur le nouvel État. Et les inévitables trahisons qui ont émaillé, le processus, d’où le titre.... Décidément, Anne Marie Métailié a le don de publier des romans historiques parfaits, rappelons-nous de l’immense livre de Padura publié l’année dernière. »
Marielle Dy -
« Entre batailles et conspirations, entre vies légères et amours compliquées, s'imagine le désir d'un avenir meilleur porté par la jeunesse et l'innocence. Un souffle épique qui nous en apprend de bien belles sur l'histoire de l'Italie. Grandissimo ! »
Doris Séjourné -
« Voilà un roman, un vrai, de ceux qui vous font aimer la littérature et l’Histoire. En mélant personnages historiques et romanesques, De Cataldo nous propose sa vision de Risorgimento. Le texte, dense mais écrit dans une langue haute en couleurs nous montre que dans cette construction de l’Italie moderne se sont planté les germes de la contemporaine, déchirée en deux, politicienne, corrompue et rongée par la Pieuvre.Un très grand livre très certainement, l’un des plus grands plaisir de lecture que je n’avais pas eu depuis longtemps. »
Ladislas BraultLibrairie de Bagatelle (Neuilly-sur-Seine)
-
Plus d'infos ici.LELITTERAIRE.COM
-
Plus d'infos iciMONTREAL 157.BLOG
-
Plus d'infos iciECOLESJUIVES.FR
-
Plus d'infos ici.RTBF
-
«La puissance d’évocation de Giancarlo de Cataldo fait merveille pour ressusciter une période cruciale pour l’Italie et réussit le mariage parfait entre fiction et histoire.»Gérard NoëlVOSGES MATIN
-
« Quelle folie ! Quelle passion ! Il y a une énergie créatrice à la Dumas chez cet écrivain-là. »Yves ViollierLA VIE
-
« Le récit haletant du combat pour l’unité italienne à la fin du XIXe siècle, mêlant fiction et réalité. Dickens, Dumas, Sade et Walter Scott »Elisabeth PhilippeLES INROCKUPTIBLES
-
Lire l'article iciLa semaine de Giancarlo de CataldoLIBERATION
-
« Auteur, narrateur : même combat ? » Plus d'infos ici.Raphaëlle LeyrisLE MONDE DES LIVRES
-
"L'auteur de Romanzo Criminale nous offre une fresque fouillée sur l'unification italienne" . Lire l'article entier ici.Guillaume DelacroixLES ECHOS
-
"Une œuvre foisonnante et bouillonnante"Eliane GirardPRIMA
-
« Porté par un souffle romanesque intarissable, Giancarlo De Cataldo façonne une fresque où le grandiose le dispute au pathétique ».Mickaël DemetsALIBI
-
« Giancarlo de Cataldo, magistrat à la Cour d’assisses de Rome et auteur à succès de romans noirs, donne ici une version complexe et populaire du Guépard ». Lire l'article entier ici.Jean-Baptiste MichelGEO HISTOIRE
-
« Giancarlo De Cataldo dresse une magistrale fresque de l’unification italienne ». Lire l'article entier ici.Fabio GambaroLE MONDE DES LIVRES
-
« Fidèle descendant des romans-feuilletons qui ont fait les riches heures de la littérature mondiale, nous sommes emportés par un tourbillon qui nous emporte aux quatre coins de l’Italie »Michel PaquotL'AVENIR
-
« L’Italie sans repères ». Lire l'article entier ici.Yann PlougastelLE MONDE
Prologue
Carini, Palerme
Le maître de journée introduisit Salvo Matranga dans la bicoque. De grossières toiles de chanvre bouchaient les fenêtres. Quatre hommes à l’air sévère attendaient dans la pénombre, à peine dissipée par la lueur d’une chan-delle. Trois d’entre eux étaient debout?: le chef jeune et deux hommes d’honneur de Villagrazia nommés depuis peu. Don Calò, le chef ancien de la Société siégeait à une table sur laquelle étaient posés les objets nécessaires à la punciuta, le “piquage”?: un calice d’or contenant une hostie consacrée, trois balles de pistolet peintes en noir, une petite image de la Vierge des Douleurs, la chandelle, un poignard, six cigares noirs et tordus. En croisant le regard de l’important personnage, Salvo inclina la tête en signe de respect. Don Calò apprécia d’un sourire à peine esquissé. Puis il fit signe au chef jeune de commencer la cérémonie. Le chef jeune se plaça devant Salvo et commença l’interrogatoire.
-age compagnon, pardon, qu’avez-vous reçu de la Société??
-’ai reçu de la Société un baiser et une poignée de main pour chaque compagnon, plus un baiser du chef jeune.
-ardon, sage compagnon, où vous ont-ils remplacé et comment vous ont-ils remplacé??
-n beau samedi matin le soleil apparaît et n’apparaît pas. D’un cavalier je me sens appelé. La première fois je ne me suis pas retourné et la deuxième fois je me suis retourné. De la main droite il m’a fait signe de m’approcher de lui?: je m’approchai, il m’embarqua sur le cheval, m’emporta au bord de la mer sur laquelle j’ai vu une barque d’or avec trois vaillants marins. Ils m’ont embarqué et me conduisirent au milieu de la mer où il y avait une belle petite île appelée Favignana?: alors, ils m’ont débarqué, ils ont formé et ils m’ont remplacé.
-ardon, beau compagnon, avec votre belle permission… n’y avait-il pas des poissons qui vous ont empêché de naviguer, les requins??
-rand et beau compagnon, sachez bien que les requins se firent petits et les petits se firent gros?: ils se sont transformés.
Le chef jeune regarda vers le don, qui lui fit signe de pour-suivre. Le chef jeune prit les cigares et les distribua, un à chacun. Quand ce fut le tour de Salvo, au lieu de lui donner le cigare, il le fixa droit dans les yeux et recommença à le questionner.
-age compagnon, savez-vous me dire quels dons vous a donnés la Société??
-age compagnon, à moi la Société a donné sept belles choses.
-ardon, vous savez me dire lesquelles??
-umilité, sérieux, politique, force politique, papier, cou-teau et rasoir.
-ardon, beau compagnon, qu’en faites-vous, de l’humi-lité et du sérieux??
-oi, je dois être humble et sérieux avec mes sages compagnons et avec les personnes dignes et méritantes.
-t de la politique, qu’en faites-vous??
-e la politique, j’en parle avec mes sages compagnons et avec les personnes dignes et méritantes.
-ardon, et de la force politique, qu’est-ce que vous en faites??
-ompagnon, vous le savez bien qu’avec la force politique je parle avec les mouchards et les comédiens.
-ue faites-vous du papier et à quoi vous sert-il??
-vec le papier, je dois traiter avec l’argent, centimes et millimes.
-ardon, sage compagnon, votre Société est si pauvre qu’elle compte les centimes et les millimes??
-rand et beau compagnon, ne vous permettez pas de le dire?! Sachez bien que ma Société compte les centimes et les millimes pour ne pas laisser surgir la Camorra. Sachez que ma Société d’une main traite les droits, les centimes et les millimes, et de l’autre dispose de papiers de mille?!
-age compagnon, pardon, que faites-vous du rasoir??
-e rasoir me sert à couper le visage à tous les mouchards et les comédiens.
-t vous n’avez pas le couteau??
-eau compagnon, vous savez bien qu’entre le couteau et le rasoir, il y a une belle différence?!
-rand et beau compagnon, savez-vous me dire quelle différence il y a entre le couteau et le rasoir??
-eau compagnon, sachez-le bien?: cela vous sert à ensei-gner que le couteau est fer mais que le rasoir est fer amer, et quand on coupe un mouchard avec un rasoir, on lui empoisonne le sang et il meurt comme un chien, ainsi qu’il le mérite.
Le chef jeune remit enfin à Salvo aussi le cigare, en hochant la tête. Puis il s’approcha de la table, prit les trois balles et les renferma dans son poing gauche. Enfin, il ouvrit le poing. Les trois balles roulèrent sur le plan de la table. Leur course s’arrêta contre la main ouverte de don Calò.
Don Calò fit signe au jeune homme de s’approcher. Salvo obéit sans hésiter, en regardant l’autre droit dans les yeux. Don Calò fit rougir la pointe du poignard sur la flamme de la bougie. Salvo roula la manche de sa chemise blanche et tendit le bras. Don Calò leva le poignard. Salvo s’obligea à garder les yeux bien ouverts.
De la pointe du couteau, don Calò pratiqua une incision légère à la hauteur du poignet de Salvo. Quelques gouttes de sang coulèrent, qui allèrent mouiller l’image de la Vierge des Douleurs. Le chef jeune se tourna vers le maître de journée qui avait suivi, immobile comme les autres, les phases du rite.
Don Calò hocha la tête.
Salvo se sentait la gorge serrée par la solennité du moment. Il allait devenir un Homme. Un Homme de don Calò, l’intendant du baron de Villagrazia.
-’une main, j’allume la lampe et de l’autre je fais jour, un calice d’or très fin et une hostie consacrée, parole d’omerta moulée sur ce Corps de Société. Puis, certainement, résultat des règlements, des baisers reçus de la Société et toutes les règles qui existent, et donc ce jeune homme est fait et doit être respecté comme un frère et être aimé et aidé en toute question qui se trouve et suffit?!
La cérémonie était terminée, le rite célébré. Salvo Matranga était enfin un Homme. Les toiles furent ôtées de la fenêtre. Une lumière aveuglante qui sentait le printemps précoce enva-hit la maisonnette de campagne. Tous se tournèrent vers Salvo, l’étreignirent et l’embrassèrent trois fois sur les joues. Le maître de journée lui tendit un mouchoir de soie pour essuyer le sang. Don Calò déboucha une bouteille de Malvasie noire et accorda à Salvo l’honneur de la première gorgée.
-u t’es bien comporté avec le chevrier, Salvo.
-’ai fait ce qui devait être fait, don Calò.
i
Calabre, 1844.
Quatre ans auparavant.
Le prêtre a la soutane tachée et le regard enflammé de folie. Il brandit le cierge, hurlant des phrases incohérentes dans un latin approximatif mêlé de l’âpre accent guttural du lieu. Il invoque son dieu, pense Lorenzo avec une pointe de mépris, ou peut-être le diable. Des paysans armés de fourches font écho aux hurlements par un murmure étouffé. Écrasée contre la porte de l’église, une pauvre église de campagne, attachée à un poteau improvisé, sur un tas de fagots secs, la fille aux cheveux roux a sa veste blanche déchirée, des chaussures de corde effilochée aux pieds, et elle fixe le ciel avec un sourire vague. Mais la nuit est noire, il n’y a pas d’étoiles et seul le reflet dansant du cierge illumine une scène qui évoque Goya et les nocturnes des peintres flamands. Dans l’obscurité qui protège les patriotes, les yeux sarcastiques de Calabrotto lancent des éclairs inquiets. Le guide fait le signe de la croix et crache par terre.
-e vous l’avais dit que San Rocchino est un lieu maudit. Ccà ’nci sunnu sulu malacarni, ici il n’y a que des scélérats.
-ue font-ils?? s’informe Lorenzo, et entre-temps il laisse glisser le mousquet de la bandoulière.
-’bbrúscianu ’na strega, ils brûlent une sorcière?!
-Parle italien?!
-’est une sorcière, celle-là.
-t toi, qu’est-ce que tu en sais??
-lle a les cheveux roux. C’est le signe du démon.
Lorenzo fait un signe au natif des Marches qui a déjà le pistolet à la main. Ils se jettent sur le prêtre, ignorant l’impré-cation suffoquée de Calabrotto. Les autres suivent. Trente-trois hommes armés occupent la place. Un cri aigu s’élève du groupe des paysans.
-es brigands?! Les brigands?!
Lorenzo écarte les bras et s’efforce de dominer sa colère. Ils ont débarqué depuis deux jours, et partout la même chanson. Partout à leur passage places désertes, maisons abandonnées, fermes vidées de toutes victuailles. Et ce cri obsédant?: les bri-gands. Les brigands. Où sont les mille cinq cents insur-gés qui, d’après ce qu’ils avaient lu, se trouvaient sur le Medi-terraneo de Malte?? Où sont les Fils de la Jeune Italie qui auraient dû les attendre sur la crête de Santa Roccella??
-ous ne sommes pas des brigands. Nous sommes des patriotes?! Nous sommes venus libérer la Calabre de la domi-nation oppressive du roi bourbon?! Nous sommes là pour vous donner la liberté, frères calabrais?! proclame-t-il, et une pointe de méfiance affleure dans son jeune parler vénitien.
Les paysans reculent, retirant leurs fourches. Un seul reste immobile. L’index pointé vers Calabrotto. Calabrotto qui pose une main sur l’épaule de Lorenzo.
-l est inutile que vous perdiez du temps avec ceux-là, baron, dit-il en dialecte. Ou on leur tire dessus tout de suite, ou on s’en va?!
Le paysan crache par terre. L’index se déplace vers Lorenzo et revient vers Calabrotto.
-Chiddu è ’u Calabrotto, celui-là, c’est Calabrotto, dit enfin, doucement, le paysan, comme s’il s’agissait d’une simple consta-tation. Et vous?? Vous êtes des brigands?! poursuit-il en dialecte.
-Chi vi dissi, qu’est-ce que je vous disais?? Tirez-leur dessus et finissons-en.
Le paysan lâche un autre crachat et rejoint ses compères. Le brouillard les avale, ils disparaissent rapidement, sans un bruit.
-e prêtre?! hurle quelqu’un.
Cinq, dix mains se tendent vers le prêtre, qui est en train d’essayer de mettre le feu au tas de fagots. Mais il se débat, lutte, bave et saute, psalmodie et chante, se libère des assaillants, jusqu’à ce que Lorenzo l’étende à terre d’un coup de poing à la tempe. Une étincelle atteint le bois aride. Le feu jaillit. Lorenzo se jette sur la fille. D’un coup de poignard il lacère les cordes qui la retiennent. Il la soulève et la porte loin des flammes. Elle s’est évanouie. Il la dépose sur une couche de feuilles sèches, s’assure que son cœur bat encore, essaie de la forcer à boire une goutte d’eau. La fille ouvre les yeux. Elle a le regard perdu.
-u es en sécurité, maintenant, murmure Lorenzo.
Elle sourit. Lorenzo lui passe une main dans les cheveux. Ils empestent la chèvre. Plus tard, on met au vote l’exécution du prêtre.
-ous sommes des combattants, pas des assassins, s’insurge Lorenzo.
La proposition est refusée à l’unanimité. Ils décident de le laisser libre. Seul Calabrotto est perplexe. Il crache, se roule un cigare.
-’A strega porta malocchiu, la sorcière porte le mauvais œil, commente-t-il, fixant Lorenzo de travers.
Ils dorment sur la place, se partageant les tours de garde. Au matin, des yeux narquois les regardent partir. Ce n’est que dans l’après-midi qu’un fermier, revenant du pâturage, découvrira le corps du prêtre qui se balance à la branche d’un châtaignier.
Le premier à tomber est l’Irlandais. Une balle lui réduit le front en bouillie. Lorenzo se le retrouve dans les bras, stupeur dans les yeux verts, pureté qui s’éteint dans la rigole de sang, adieu frère, a-t-il le temps de penser, tu rêvais de voir ta terre libérée des Anglais, mais il n’y a pas de place pour les rêves, pas même pour le nôtre. Lorenzo étend sur le sol son compagnon tombé et regarde autour de lui. Ils tirent de la crête, ils tirent de la sapinière, ils tirent de toutes les directions. Nuages de fumée et détonations sèches, continues, couvrent ordres, cris, chants. Un compagnon tombe, foudroyé au cœur, il en tombe deux autres. Lorenzo arme le mousquet. Ils les attendaient. Ils sont tombés dans un piège. L’entreprise est terminée avant même de commencer. Il est sur le point de viser lorsqu’il se sent agrippé. Il se retrouve dans le fourré, le visage écorché par les ronces. C’est la fille. Lorenzo s’en libère d’une poussée. Elle s’agrippe au mousquet, serre fort le canon, le pointe vers le bas, tenace, têtue.
-aisse-moi y aller?!
La fille se démène. Elle ne lâche pas prise. Deux garçons de Bergame se replient à l’extrémité du vallon, partez, partez, ils hurlent, tandis que le Peintre, un cigare au coin de la bouche, essaye de mettre à l’abri ses précieux dessins. Lorenzo fixe la fille, lui parle lentement, avec douceur.
-ars, pars, tu peux arriver à reprendre la vallée du Neto. C’est à deux pas. Pars, pars. Ici, on meurt?!
Mais la fille secoue la tête. Des poussières blanches et des moucherons s’envolent de ses cheveux filasse. Son odeur sauvage couvre un bref moment l’odeur âcre de la poudre. Lorenzo essaie encore de l’éloigner.
-a-t’en?! J’aurais dû te laisser aux mains de ces bêtes, tu es une bête toi aussi, comme eux?!
La fille dégringole, s’arrête contre une ronceraie en fleurs. Dans son regard, maintenant, une lueur indéfinissable?: vexée, peut-être, ou, Dieu sait pourquoi, amusée.
-’est un piège, Lorenzo. Nous avons été trahis.
Le natif des Marches a la veste déchirée, des filets de sang au milieu des poils noirs de la barbe.
-alabrotto??
-isparu après Monasterio. Il a dit qu’il allait en recon-nais-sance. On ne l’a plus revu.
-ls l’ont peut-être pris.
-u peut-être qu’il n’était pas celui qu’il disait être.
Le mousquet pend inerte de la bandoulière de l’homme des Marches, cassé à la hauteur de la crosse. Des armes misé-rables pour une misérable entreprise. Il aurait dû écouter le Maestro. Le Maestro avait déconseillé l’expédition. Le Maestro n’avait accordé aucun crédit aux rumeurs de paysans en révolte et de curés en fuite. Il aurait dû se fier au Maestro. Au Maestro et à son instinct. Mais désormais il était trop tard pour réparer. Entre la poussière et les hurlements, les soldats de Sa Majesté et les agents descendent en tirant furieusement le long de la pente. Dix compagnons ont improvisé un carré. Lorenzo tire à l’aveuglette, puis jette son arme. Il extrait le stylet qu’il emporte partout depuis l’époque de Venise et le passe à un compagnon.
-a veut dire que nous irons à la mort avec dignité.
Le natif des Marches acquiesce.
-ive l’Italie.
-ivat?!
Son compagnon se lève de toute sa haute stature, et avec un rugissement se lance contre l’ennemi. Lorenzo se précipite à sa suite. Il trébuche. Tombe lourdement. Des ronces qui le cinglent, du sang sur le menton. La fille se tient accroupie, de ses lèvres scellées semble partir un chant étouffé. La fille a noué les lacets des brodequins. Elle ne veut pas entendre parler de le laisser mourir. Lorenzo s’emploie à défaire le nœud. Elle est en train d’entailler une canne de rivière. Elle doit encore être en train de faire un de ses damnés pipeaux. Lorenzo est debout, dans la poussière qui commence à se dissiper. Les soldats contrôlent les survivants. Une quin-zaine sont indemnes. Un officier retourne le cadavre du natif des Marches, le cou plié sous un angle bizarre. Lorenzo retourne s’accroupir. La fille indique le fond de la faille. Lorenzo la regarde sans comprendre. La fille dessine avec la pointe du couteau une roche et, dans la roche, une fissure. Elle lui suggère une voie de sortie. Mourir en martyr de la révolution, ou sauver sa peau pour d’autres entreprises plus nobles?? Tout à coup, un vacillement dans ses yeux à elle le fait tourner brusquement.
-Ccà ’n autru, ci nn’è, ici, il y en a un autre?! crie un agent à l’air exalté.
Un lieutenant pâle, courts cheveux sombres, avance pru-demment vers Lorenzo, braquant un pistolet à canon court. La fille est dans son dos. L’officier ne l’a sans doute pas encore remarquée. Peut-être peut-elle encore se sauver. D’un geste décidé Lorenzo se place devant le lieutenant et lui tend le mousquet.
-e m’appelle Lorenzo di Vallelaura. Je suis votre pri-sonnier.
L’autre le scrute, l’air ironique.
-iémontais??
-énitien.
-Ah, ti xe de Venexia, ah, tu es de Venise?? ricane le lieu-tenant en imitant le dialecte vénitien. Puis, sans raison, il le frappe à la tempe avec la crosse du pistolet.