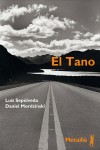Qu’est-ce qui rapproche un pirate de la mer du Nord, mort il y a 600 ans, un militant qui attend le 31 mars l’éclosion des roses d’Atacama, un instituteur exilé qui rêve de son école et s’éveille avec de la craie sur les doigts, un Italien arrivé au Chili par erreur, marié par erreur, heureux à cause d’une autre énorme erreur et qui revendique le droit de se tromper, un Bengali qui aime les bateaux et les amène au chantier où ils seront détruits en leur racontant les beautés des mers qu’ils ont sillonnées? Peut-être cette frontière fragile qui sépare les héros de l’Histoire des inconnus dont les noms resteront dans l’ombre. Leurs pas se croisent dans les pages de ce livre. Voici, riche d’une humanité palpable, dans un style direct et incisif, toutes ces vies recueillies par un voyageur exceptionnel, capable de transformer la tendresse des hommes en littérature.
-
Rencontre dans les Asturies avec l'auteur du « Vieux qui lisait des romans d'amour », révélé en 1992 au festival « Etonnants voyageurs ».Un écrivain à succès a le privilège de pouvoir faire à peu près ce qu'il veut. Un écrivain d'aventures à le talent de ne pas avoir vécu toutes celles qu'il s'attribue. A 51 ans, Luis Sepúlveda est les deux. Il voyage encore beaucoup. Il vit là où il se sent bien, à Gijon dans les Asturies. Il mange des fèves et du chorizo cuit, boit du cidre, blague volontiers et plante des arbres. Il écrit quand il en a envie, milite pour l'environnement et contre la démocratie sans mémoire du Chili. Là-bas, ce combat est mal vu: certains journaux et des écrivains l'accusent d'être en partie mythomane quand il évoque son passé de militant de gauche révolutionnaire, ses années de prison sous Pinochet, ses multiples vagabondages. Ce genre de rumeurs viennent du pays natal et parfument toujours les exilés quand ils deviennent célèbres. Celle-ci est née au moment précis où Sepúlveda s'en est pris à la lâcheté des gouvernants et de certains intellectuels chiliens quand Pinochet fut arrêté: il fallait détruire la légitimité du gêneur. Il est possible que l'écrivain-voyageur ait arrangé son parcours, qu'il l'ait semé d'inventions: un biographe anglo-saxon finira, comme toujours, par visiter sa tombe. Mais tout écrivain fabrique son personnage comme il imagine les autres: avec des mots, des récits, des idées. Et, avec le temps, ce personnage de phrases devient plus vrai que vrai: il impose sa vérité. Sepúlveda a creusé le sien dans la nostalgie active de Jules Verne, de Stevenson, d'Hemingway, et en s'aventurant du côté des perdants. Savoir perdre est un savoir vivre. Savoir vivre est une aventure. Encore faut-il savoir l'écrire. Le Chilien naturalisé allemand a attendu l'âge de 40 ans pour le faire. Dans son bon roman policier, Un nom de torero, l'ex-révolutionnaire Juan Belmonte, devenu privé malgré lui pour une grosse compagnie d'assurances, le résume ainsi: «Perdre est une question de méthode. » Révolutionnaires défaits, militants oubliés, altruistes silencieux, Sepúlveda aime les perdants et ne raconte que leurs histoires: «Ils ont l'orgueil, dit-il, d'avoir osé quelque chose pour que l'ordre change et ils sont à l'image de l'Histoire : elle avance, d'échec en échec, jusqu'à la victoire finale.» Laquelle n'existe peut-être que dans des livres. Son nouveau recueil de récits, les Roses d'Atacama, conte brièvement la vie de ces militants obscurs dont la planète est le jardin Sepúlveda, c'est Terre humaine: l'esthète convivial et ambulant des causes perdues. Solide, corpulent, increvable, il a tué sous lui les semelles des autres. Il a été militant communiste puis socialiste chilien, peut-être dans la garde de Salvador Allende, détenu un certain temps par les matons de Pinochet, exilé en Amérique centrale, peut être guérillero sandiniste au Nicaragua, auteur et metteur en scène de théâtre en Equateur; exilé en Allemagne, reporter pour Der Spiegel et pour la télévision, militant avec Greenpeace et finalement globe-auteur de livres à succès. Il aima Cuba, et Castro aurait pensé à lui pour écrire sa biographie, «j'ai refusé». Ces jours-ci, à achève son premier film tourné dans le nord de l'Argentine avec Harvey Keitel, Nowhere, et il va se mettre au latin: «J'ai l'impression qu'un monde m'échappe. Je veux pouvoir lire cette langue pour d'abord lire Virgile . » Près de chez lui, il a trouvé un vieux curé espagnol qui va lui donner des cours particuliers. Virgile semble avoir été inventé pour qu'un reviveur écologiste comme Sepúlveda puisse un jour se l'approprier en langue morte. Il est devenu célèbre en 1992 avec un roman d'aventures, Le vieux qui lisait des romans d'amour . Un vieil homme dont l'épouse est morte, tuée par les conditions tropicales, y vit en osmose avec la rude Amazonie et ses Indiens. Il lit des romans d'amour vrai, «celui où l'on souffre», pour oublier la sauvagerie égoïste des Blancs qui l'entourent. L'histoire fut inspirée à Sepúlveda par un long voyage sur place, en 1978, pour le compte de l'Unesco. Ecrite et publiée en Espagne bien plus tard, elle se vendit à 150 exemplaires (« dont cent achetés par moi»). 0n peut encore voir, sur l'édition originale, la tête mince, chevelue et barbue d'un Guevara sentimental. En 1992, l'éditrice Anne-Marie Métailié découvre ce texte inconnu à la foire de Francfort et l'achète. Le livre prend son envol la même année, à l'occasion du festival Etonnants Voyageurs, organisé par Michel Le Bris à Saint-Malo. Un éditeur français a, une fois encore, révélé au monde un auteur latino-américain. Sepúlveda est, avant tout, un excellent conteur. Sa simplicité, son goût de l'aventure et sa sensibilité humaniste annoncent l'inquiétude démocratique et écologique du temps des idéologies tombées. En Italie, ses livres se vendent parfois à plusieurs millions d'exemplaires. En France, les critiques l'ont d'abord ignoré, puis, souvent, méprisé: trop facile, trop sentimental, trop grand public pour ne pas être considéré comme démagogue. Sepúlveda, Coelho d'extrême gauche: cette opinion d'un cénacle blasé est devenue la règle. L'Agence France-Presse, qui répète tout bas ce que certains disent tout haut évoquait encore, en mars dernier, à propos du film que Rolf de Heer a tiré de son best-seller, «une fable un peu pontifiante sur le respect de la nature et de l'environnement». Sepúlveda a vécu quatre ans à Paris dans les années 90.La France, pour lui, c'était Balzac, Dumas. Il adore la province, le petit salé aux lentilles et le Juliénas, mais il déteste le nouveau roman et la plupart des écrivains bourgeois parisiens, en qui il ne voit que des «fabricants inertes d'exercices de style». L'un de ses petits plaisirs était de s'installer en terrasse à Saint-Germain-des-Prés, avec des amis latinos, globe-trotters militants comme lui. «Nous regardions passer les spécimens intellectuels de la gauche caviar (il déglutit cette expression en français, comme pour mieux déguster le produit du terroir qu'elle désigne) et nous riions à nous en étouffer » Un jour, au Salon du livre, Ils rient trop fort: « Un éditeur local s'est approché et il a dit que nous trivialisions l'image de la littérature. Eh bien, pourquoi pas?» A Gijon, la vie est plus simple. Pour survivre l'omniprésence des bars, les Espagnols marchent vite en basket sur le paseo, le long d'une mer qui envahit tout. Sepúlveda y vit depuis quatre ans Il a découvert la ville en 1984. Son ami, l'écrivain Paco Ignacio Taibo II, y est né. Il y organise en mai depuis quinze ans, avec une bande d'auteurs dont Jean-Claude Izzo faisait partie, la «Semaine noire» 0n y boit, on y chante. Les écrivains concourent au tir avec les policiers de la ville. C'est la fête à l'espagnole. «La Semaine Noire est importante pour nous, dit Sepúlveda. C'est l'un festivals où nous nous retrouvons. Je crois que nous voulons maintenir l'esprit d'Emile Zola. Nous nous soutenons. Nous nous relisons nos textes à distance. Nous aimons vivre et écrire sans nous prendre pour des écrivains. » Luis Sepúlveda se remet aujourd'hui de trois mois. de tournage dans le désert argentin et d'une indigestion aux fruits de mer. Il plante des arbres, en compagnie de son frère silencieux qui l'a aidé sur le film, dans son joli lotissement près de la mer. Deux magnifiques bergers allemands l'entourent. L'un d'eux s'appelle Zarko: le nom du garde du corps d'Allende. Sa femme, l'excellente poète Carmen Llanez, l'enveloppe de charme et d'une délicate fragilité: elle adoucit sa brutalité. Ils se sont connus à la fin des années 60 au Chili. Ils ont alors vingt ans et sont militants de gauche. Un enfant naît: Carlos Lenine. Aujourd'hui âgé de 29 ans, il a effacé Lenine et dirige, en Suède, un groupe de hard rock, Psychor. Au début des années 70, Luis et Carmen se séparent. La dictature arrive: Ils sont emprisonnés. Lui sort, après deux ans et demi, dit-il, après quelques jours affirment d'autres, et s'en va découvrir l'Amérique Latine. Son passeport est marqué de la lettre L, elle en fait un indésirable dans les nombreuses dictatures du continent. Il n'a jamais su ce qu'elle pouvait signifier. Il a raconté (ou réinventé) ses aventures dans le très beau Neveu d'Amérique. Carmen est emprisonnée et torturée dans l'une des pires prisons de Pinochet. On la croit morte. Un vieil homme la retrouve, des années plus tard, nue et inanimée, sur une décharge publique. Sepúlveda s'installe à Hambourg en 1980. Il a connu en Equateur une infirmière allemande, avec qui il aura trois enfants. Treize ans plus tard, il s'installe à Paris: c'est là qu'il revoit Carmen, dans un hôtel situé près de la place d'Italie. Depuis quatre ans, ils vivent de nouveau ensemble. L'histoire de Carmen, la Brune et la blonde, ferme les Roses d'Atacama. C'est un hommage discret, quelques pages, à un combat lointain et à l'amour retrouvé - à leur écho. A Gijon, Sepúlveda songe parfois à ne plus écrire, à simplement vivre Mais la vie est si belle quand on la réécrit. Et il y'a tant de causes à défendre, à raconter, pour ne pas échouer. Sepúlveda a écrit: «Les pauvres pardonnent tout sauf l'échec. » Gijon est peut-être un remède sentimental contre l'échec. Ce port industriel du nord de l'Espagne a ses bateaux rouillés et ses illusions perdues; mais il garde ses mineurs, une bonne gauche, et on y vit bien. L' écrivain rêvait depuis longtemps de s'y installer: «Ici, les gens sont simples, directs et désinhibés. » Ils ont une longue tradition de lutte ouvrière. Ils ont leurs martyrs en dignité, révoltés puis massacrés par le jeune Franco en 1934. Sepúlveda rappelle volontiers que les mineurs asturiens ont soutenu les grévistes chiliens. Et ils sont, eux aussi, du côté des perdants. Une histoire de famille, puisque, perdant, «mon grand-père lui aussi l'a été». Gerardo Sepúlveda est un andalou d'origine séfarade. Anarchiste, il doit fuir l'Espagne. Il rejoint les Philippines, puis l'Equateur. Il y monte une fabrique d'huile d'olive, poursuit sa lutte politique, perd tout, rejoint le Chili. Les Sepúlveda sont communistes et cultivés. Luis a grandi dans cette ambiance. Le père dirige un restaurant. Son fils lit tous les romans d'aventure et, plus tard, Gramsci. Marx sera plutôt découvert en Allemagne, Luis n'aime guère Pablo Neruda, le pape chilien des lettres: « la poésie fait mauvais ménage avec la rhétorique, et Neruda est excessivement rhétorique». Il révère Francisco Coloane, «un des plus grands auteurs chiliens », et Julio Cortazar, qui «écrit sous la peau du lecteur». De Borges, il dit: «Je l'ai beaucoup aimé, jusqu'au moment où j'ai compris qu'il racontait toujours la même histoire. Jeu magnifique, mais dangereux! Il a tout inventé sa bibliographie, ses références. Je le compare à Villon et à Quevedo pour son déchaînement ludique. Le moins drôle n'est pas tous ces gens qui le prennent terriblement au sérieux Il a fait des conférences pour se moquer de ceux qui font des conférences, et des livres pleins de fausses références pour se moquer des exégètes. Bravo! » Un jour, bien plus tard, à Cologne, il croit le voir, coincé dans un ascenseur perpétuel de type Pater Noster de la radio allemande; c'est bien lui: le vieil homme tourne, avec sa canne, dans cet enfer transparent et circulaire. «Vous êtes Borges? », demande Sepúlveda. «Oui. Aidez-moi à sortir!» lui dit l'auteur des Fictions.. «J'allais aux toilettes, et me voilà pris là-dedans. J'ai pensé que cette machine allait m'amener droit en enfer. » «C'était une histoire de Borges», conclut Sepúlveda, et l'on préférerait qu'elle soit fausse, tant elle semble vraie. >Son grand patron reste Hemingway: «Je le respecte plus que tout. » Il en a fait son maître en sobriété. 0n flaire, dans Le vieux qui lisait des romans d'amour, l'influence du Vieil homme et la mer Il y manque l'intrinsèque perspective de la mort et la force d'une langue réinventée pour survivre. Mais, partout ailleurs, on sent la trace du maître: sa convivialité virile et arrosée, son sens de la nature et des combats perdus, sa formidable mythification de l'engagement politique, son sens si profond de la vérité du mensonge. Le mensonge est probablement l'une des qualités qui permet à Sepúlveda, dans ses livres, d'être aussi juste. La Patagonie est sa terre intime et ce n'est pas un hasard. Sur cette terre vivent des êtres étranges et autonomes. Ils arrangent leur passé comme ils l'entendent. Ils vivent, comme certains chevaux, en liberté. Chaque vie devient un destin qui attend un témoin, ou personne, pour s'achever dans l'horizon. Un jour; il y assiste à un formidable concours de mensonges; l'un des concurrents le prévient: «Sur cette terre nous mentons pour être heureux. Mais personne ici ne confond mensonge et duperie.» Quel écrivain ne vit pas en Patagonie? Sepúlveda y retourne souvent, par liberté et par amitié. Un jour, dans un bar de Zurich, un éditeur organise une rencontre avec Bruce Chatwin. Sepúlveda l'a raconté dans le Neveu d'Amérique. Les deux hommes sympathisent. Chatwin a écrit ce très beau livre, En Patagonie «En bon Anglais, dit Sepúlveda, il allait quelque part pour vérifier ce qu'il pensait. Les Européens nous ont toujours dit ce que nous étions, nous Sud-Américains, comme s'ils le savaient mieux que n'importe qui. C'est leur charme et leur limite. » Chatwin meurt avant qu'ils réalisent leur projet commun: partir sur les traces de Butch Cassidy et Sundance Kid, qui achevèrent là bas, sous les balles, leur vie d'aventuriers pilleurs de banque. Sepúlveda y est allé seul. Avec un ami photographe, il a retrouvé la fille, âgée de 98 ans, du policier de l'agence Pinkerton qui pourchassa les deux héros: il tomba amoureux de cette terre et y resta. En Patagonie les militaires chiliens reléguaient les prisonniers politiques qu'ils n'exécutaient ou n'exilaient pas. Sepúlveda est revenu au Chili en 1990. «Je pensais peut-être y rester, mais j'ai compris que vivre là n'avait plus aucun sens pour moi. » Le Chili est cet étrange pays, dit-il, «où l'hymne national très beau, transformé en victoires des désastres militaires nationaux. » En quoi Sepúlveda, l'ami des perdants, est infiniment chilien. Sa position envers Pinochet et ses associés fut radicale : «ni pardon, ni oubli». Il n'a cessé de dénoncer les complaisances de la nouvelle démocratie. «La dictature nous a laissé la haine. Les haineux représentent la moitié du Chili. J'ai vu des pauvres manifester pour la libération de Pinochet: ce lumpen n'a jamais eu aucune référence morale et veut un pouvoir fort et pervers.» Sur Pinochet, il est aujourd'hui nuancé: « J'ai de la pitié pour lui. Je crois que c'est un vieux, qui ne saisit plus ce qui lui arrive. Un malin qui n'a rien compris. » La déchéance de Pinochet lui rappelle celle d'Erich Honecker. Il affirme avoir vu par hasard l'ancien président de la RDA juste avant sa mort, dans son exil final au Chili. Le vieil homme marchait dans la rue quand il vit des ouvriers sur un chantier: «Il s'approche d'eux, et cet homme, qui ne parle pas dix mots d'espagnol, commence à leur vanter, en allemand, Marx et la Révolution. je me suis approché: il vivait dans son rêve, croyait que la Révolution se préparait en Allemagne, comme si rien n'avait eu lieu depuis cinquante ans.» Cette formidable rencontre avec le spectre gâteux résonne pour le militant de gauche, toujours séduit par Cuba, comme une menace: celle de l'anachronisme. Le 6 juin, Luis Sepúlveda devrait recevoir, à Barcelone, des mains du président chilien Ricardo Lagos, la médaille de chevalier des Arts et Lettres. L'ambassade chilienne en Espagne ne semble pas informée, mais lui, dit-il, va accepter: «Je vais en profiter pour dire à Lagos ce que je pense de la démocratie chilienne. » Il assure qu'on lui a proposé de reprendre sa nationalité d'origine, moyennant un dépôt dans une banque de 10 000 dollars: «j'ai refusé!» L'ambassade du Chili en France assure qu'il ne l'a jamais perdue. Les histoires continuent, et tant mieux.Philippe LançonLIBERATION
-
Ecrivain nomade, voyageant où. le poussent des vents imprévisibles, l'auteur du best-seller mondial «Le Vieux qui lisait des romans d'amour» a sillonné les pays andins, la Suède et toute l'Europe. De port en port, de bar en bar, l'ancien guérillero aujourd'hui engagé dans le combat écologique a croisé des «héros mineurs» dont il a raconté, dans «Les Roses d'Atacama», un recueil qui rassemble une trentaine de ces «Histoires Marginales », la vie souvent tachée de sang comme l'est celle des résistants.Ruth ValentiniLE NOUVEL OBSERVATEUR
-
"Désir d'écriture et devoir de mémoire se mêlent dans ce recueil de trente quatre courts récits, et avec eux réalité et invention."jean-Louis AragonLE MONDE
-
« Des portraits arrachés à l'oubli, dans les coulisses de l'Histoire. Il y ajoute son humour, et cette nostalgie discrète qui a le parfum de l'éphémère. »André ClavelL'EXPRESS
Histoires marginales
Il y a quelques années j'ai visité le camp de concentration de Bergen Belsen, en Allemagne. Dans un silence atroce j'ai parcouru les fosses communes où gisent des milliers de victimes de l'horreur, en me demandant dans laquelle se trouvaient les restes de cette enfant qui nous a légué le plus émouvant témoignage sur la barbarie nazie et la certitude que la parole écrite est le plus grand et le plus invulnérable des refuges, car ses pierres sont soudées par le mortier de la mémoire. J'ai marché, cherché, mais je n'ai trouvé aucune indication qui me conduise jusqu'à la tombe d'Anne Frank.
A la mort physique les bourreaux avaient ajouté la deuxième mort de l'oubli et de l'anonymat. Un mort est un scandale, mille morts sont une statistique, affirmait Goebbels, c'est ce que répétèrent et répètent encore les militaires chiliens, argentins et leurs complices déguisés en démocrates. C'est ce que répétèrent et répètent encore les Milosevic, Mladic et leurs complices déguisés en négociateurs de paix. C'est ce que nous crachent les massacreurs d'Algérie, si près de l'Europe.
Bergen Belsen n'est certes pas un lieu de promenade, car le poids de l'infamie y est oppressant, et à l'angoissante question "Qu'est-ce que je peux faire, moi, pour que cela ne se reproduise pas?" répond le désir de connaître et de raconter l'histoire de chacune des victimes, de s'accrocher à la parole comme unique conjuration contre l'oubli, de raconter, de nommer les faits glorieux ou insignifiants de nos pères, les amours, les enfants, les voisins, les amis, de faire de la vie une méthode de résistance contre l'oubli, car, comme le soulignait le poète Guimarães Rosa, raconter c'est résister.
A une extrémité du camp, tout près de l'endroit où se dressaient les infâmes fours crématoires, sur la surface rugueuse d'une pierre, quelqu'un - mais qui?- avait gravé, peut-être à la pointe d'un couteau ou d'un clou, le plus dramatique des messages : "J'étais ici et personne ne racontera mon histoire."
J'ai vu l'œuvre de nombreux peintres mais, qu'ils me pardonnent, jusqu'à maintenant j'ignore le choc émotionnel que - hormis Le cri de Munch- peut provoquer un tableau. J'ai regardé d'innombrables sculptures mais je n'ai trouvé la passion et la tendresse, exprimées en un langage que les mots n'atteindront jamais, que dans celles d'Agustin Ibarrola. J'ai dû lire des milliers de livres, mais jamais un texte ne m'a semblé aussi dur, énigmatique, beau et en même temps déchirant que cet écrit sur une pierre.
"J'étais ici et personne ne racontera mon histoire", avait écrit, quand ? une femme ? un homme? L'avait-il fait en pensant à sa saga personnelle, unique, singulière, ou peut-être au nom de tous ceux dont on ne parle pas dans les journaux, qui n'ont pour toute biographie qu'un passage oublié dans les rues de la vie ?
J'ignore combien de temps je suis resté devant cette pierre, mais à mesure que le soir tombait je voyais d'autres mains frotter l'inscription pour éviter qu'elle ne fût recouverte par la poussière de l'oubli : une Russe, Vlaska, qui devant la carcasse desséchée de la mer d'Aral, m'avait parlé de sa lutte contre cette folie qui avait culminé dans la mort d'une mer pleine de vie. Un Allemand, Friedrich Niemand - Frédéric Personne - qui avait été déclaré mort en 1940 et qui, jusqu'en 1966, avait usé ses semelles dans les ministères et autres temples bureaucratiques pour démontrer qu'il était bien vivant. Un Argentin, Lucas, qui, écœuré des discours hypocrites, avait résolu de sauver les bois de la Patagonie andine avec l'aide de ses seules mains. Un Chilien, le professeur Galvez, qui, dans un exil qu'il ne comprit jamais, rêvait de ses vieilles salles de classe et se réveillait les mains pleines de craie. Un Equatorien, Vidal, qui résistait aux tabassages des propriétaires terriens en invoquant Greta Garbo. Une Uruguayenne, Camila, qui, à soixante-dix ans, décida que tous les gamins poursuivis étaient des membres de sa famille. Un Italien, Giuseppe, qui arriva au Chili par erreur, se maria par erreur, eut ses meilleurs amis par erreur, fut heureux à cause d'une autre énorme erreur et revendiqua le droit de se tromper. Un Bengali, Mister Simpah, qui aime les bateaux et les conduit à la casse en leur rappelant les beautés des mers qu'ils ont sillonnées. Et mon ami Fredy Taberna, qui a affronté ses assassins en chantant…
Eux tous et beaucoup d'autres étaient là, passant leurs mains sur les mots gravés dans la pierre, et j'ai su que je devais raconter leurs histoires.
UNE NUIT DANS LA FORÊT AGUARUNA
Je ne connais pas cet homme qui s'arrête au bord du fleuve, respire profondément et sourit en reconnaissant les arômes qui flottent dans l'air. Je ne le connais pas, mais je sais que cet homme est mon frère.
Cet homme qui sait que le pollen voyage emporté par la volonté arbitraire du vent, mais confiant et rêvant à la terre fertile qui l'attend, cet homme est mon frère.
Et il sait beaucoup de choses, mon frère. Il sait, par exemple, qu'un gramme de pollen est comme un gramme de soi-même, doucement prédestiné à la boue germinale, au mystère d'où il se dressera tout vivant de branches, de fruits et d'enfants, avec la belle certitude des transformations, du commencement inévitable et de la nécessaire fin, car l'immuable recèle le danger de l'éternel et seuls les dieux ont du temps pour l'éternité
Cet homme qui pousse son canot sur la plage de sable fin et se prépare à accueillir le miracle qui, chaque soir, dans la forêt, ouvre les portes du mystère, cet homme est nécessairement mon frère.
Pendant que la subtile résistance de la lumière diurne se laisse vaincre amoureusement par l'étreinte des ténèbres, je l'écoute marmotter les mots justes que son canot mérite : "Je t'ai trouvé quand tu n'étais pas plus gros qu'une branche, j'ai nettoyé le terrain qui t'entourait, je t'ai protégé de la fourmi blanche et des termites, j'ai orienté la verticalité de ton tronc et, en t'abattant pour que tu sois mon prolongement dans l'eau, j'ai tracé à chaque coup de hache une cicatrice sur mes bras. Une fois dans l'eau, j'ai promis que nous continuerions ensemble le voyage commencé en ton temps de graine. J'ai tenu ma promesse. Nous sommes en paix".
Alors, cet homme contemple comme tout change, se transforme à l'instant précis où le soleil se fatigue d'être réduit en milliers de particules, multiplié dans les paillettes d'or que charrient les ruisseaux.
La forêt éteint son intense couleur verte. Le toucan replie l'éclat de ses plumes. Les pupilles du coati cessent de refléter l'innocence des fruits. L'infatigable fourmi suspend le déménagement du monde dans sa demeure conique. Le yacaré décide d'ouvrir les yeux pour que les ombres lui montrent ce qu'il a évité de regarder pendant la journée. Le cours du fleuve devient paisible, ingénu dans sa terrible grandeur.
Cet homme qui dispose sur la plage ses amulettes protectrices, les pierres vertes et bleues qui maintiendront le fleuve à sa place, cet homme est mon frère, et avec lui je regarde la lune qui se montre par moments entre les nuages et baigne d'argent la cime des arbres. Je l'écoute murmurer : "Tout va bien. La nuit presse la pulpe des fruits, éveille le désir des insectes, calme l'inquiétude des oiseaux, rafraîchit la peau des reptiles, ordonne aux lucioles de danser. Oui, tout va bien. "
Du haut de son autel de pierres, l'anaconda lové sur la malédiction de son corps dresse la tête pour observer le ciel avec l'innocence des irrémédiablement forts. Ses yeux jaunes sont deux gemmes absentes, étrangères à la rumeur des félins qui, la faim collée aux côtes, pistent leurs victimes dans la brise de cette saison sans pluie qui emporte le pollen vers les clairières ouvertes par l'habileté ou la mesquinerie des hommes, ou par la cruauté électrique de la foudre.
Cet homme qui répand maintenant sur le sable les graines de tout ce qui pousse sur son territoire d'origine, et qui allonge ensuite sur elles son corps fatigué, cet homme est mon indispensable frère.
Dures sont les graines du cusculi, mais elles ramèneront dans ses rêves toutes les bouches avides qui reçurent sa saveur aigre-douce au temps de l'amour. Âpres sont les graines d'achiote, mais leur pulpe rouge orne les visages et les corps des élues. Piquantes sont les graines de la yahuasca, peut-être parce qu'elles dissimulent ainsi la douce liqueur qu'elles produisent et qui, bue sous la protection des vieux sages, dissipe le tourment des doutes sans fournir de réponses, mais en enrichissant l'ignorance du cœur.
Sur une haute branche qui les protège du puma, les singes sursautent en voyant une lueur au loin. C'est cet homme, mon frère, qui vient d'allumer un foyer et m'invite à partager ses biens tandis qu'il murmure tranquillement : "Tout va bien. Le feu attire les insectes. Le jaguar et le fourmillier observent de loin. Le paresseux et le lézard aimeraient s'approcher. Le scarabée et le mille-pattes se montrent à travers le feuillage. Les langues du feu disent que le bois brûle sans rancœur. Oui. Tout va bien".
Cet homme, mon frère, m'apprend que je dois approcher mes pieds du foyer et soigner avec la cendre tiède les plaies ouvertes par la longue marche. La pénombre empêche de reconnaître ses tatouages et les traits qu'il a peints sur son visage, mais la forêt connaît la dignité de sa tribu, l'importance du rang dont témoignent ses ornements.
Enveloppé par la nuit, il est simplement un homme, un homme de la forêt qui observe la lune, les étoiles, les nuages, tout en écoutant et en identifiant chaque son qui naît dans l'épaisseur des arbres: le cri terrifiant du singe dans les griffes du félin, la monotonie télégraphique des grillons, le souffle véhément des sangliers, la crécelle du crotale qui maudit sa venimeuse solitude, les pas fatigués des tortues qui viennent pondre sur la plage, la calme respiration des perroquets rendus muets par l'obscurité.
Ainsi, lentement, il s'endort, reconnaissant de faire partie de la nuit sauvage. Du mystère qui l'apparente à la minuscule larve et au bois qui gémit tandis que se tendent les muscles centenaires d'un ombu.
Je le regarde dormir et je me sens heureux de partager le mystère serein qui délimite l'espace entre les tendres questions de la vie et la réponse définitive de la mort.
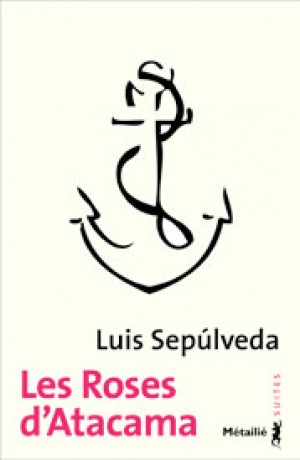





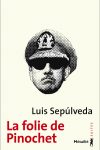










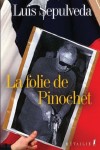




-100x150.jpg)





-100x150.jpg)