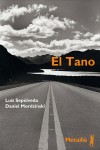En 1990, Sepúlveda revient au Chili après la chute de la dictature, il emporte une photo représentant un groupe de cinq enfants d’une banlieue ouvrière. Avec la photographe qui l’avait prise dans les années 70, il entreprend de reconstituer le groupe pour refaire la même photo. Ils retrouvent ceux qui sont maintenant devenus des jeunes gens mais l’un d’eux manque, il a disparu. A partir de
l’histoire de cet enfant, Sepúlveda raconte l’histoire du Chili après 17 ans de dictature.
Vingt-deux histoires, chroniques toujours ironiques et tendres, parfois féroces, aussi, nous transportent à travers le monde, de l’Amérique latine à l’Europe, ici et ailleurs, à travers des situations différentes, des milieux différents, mais les mots de l’auteur nous ramènent toujours sur le même territoire littéraire, celui des vaincus qui refusent d’accepter la défaite. Un territoire que tous les lecteurs de Luis Sepúlveda connaissent et où ils
retrouveront quelques-uns des meilleurs moments de son œuvre littéraire et de son inimitable force narrative, de son talent pour transformer observations et anecdotes en histoires fascinantes.
Un recueil qui se place dans la continuité des Roses d’Atacama.
-
« Dans la continuité des Roses d’Atacama, Luis Sepúlveda nous offre un recueil de chroniques qui décrivent avec ironie le monde tel qu’il est. Ironie, mais aussi tendresse et légèreté. (…) Alors s’il ne devait exister qu’un mot pour qualifier ce livre, ce serait : la vie ! »
Aurélie JanssensLIBRAIRIE PAGE ET PLUME (Limoges)
-
Plus d'infos ici.Martine AbatFrance INTER « L’Humeur vagabonde »
-
Plus d'infos ici.EDITIONS DE L’ERMITAGE
-
Plus d'infos ici.David AssolenECOLES JUIVES.FR
-
« Ce sont ses rencontres, ses souvenirs, ses espoirs aussi qu’il raconte dans ce livre engagé, fractionné en autant d’histoires où percent la révolte, l’amour des autres, l’humour aussi. »LA VOIX DU NORD
-
« Ou comment, de l’addition d’un vieil homme, d’une nuit d’orage dans la jungle, d’un hamac et d’une Olivetti peut naître un chef-d’œuvre. »Frédérique BréhautLE MAINE LIBRE
-
« Sepulveda, l’éternel exilé chilien, nous revient avec un recueil de textes. Qui éclairent ses romans, et quelques fondamentaux de la littérature hispano-américaine. » Lire l'article entier ici.Olivier van VaerenberghFOCUS VIF
-
« Ces fragments acides ou tendres, graves ou légers, trouvent leur dénominateur commun dans le pessimisme teinté d’ironie de Sepúlveda. Car aussi tragiques que soient les destins qu’il embrasse, aussi désenchanté que soit son regard sur la ruine du monde, l’écrivain préfère le pouvoir de l’anecdote ou la fantaisie du conte à la rhétorique du drame. L’éloquence de quelques souvenirs au poids mort d’un long et laborieux discours. » Plus d'infos ici.Thomas FlamerionMYBOOX.FR
-
« Journaliste lui-même, Sepúlveda se sent pareil au vénérable hidalgo qui, finalement vaincu, regarde l’ignorance danser joyeusement dans la cour de sa maison autour du bûcher où flambent ses livres. A méditer… »Corina CiocarlieJEUDI
-
« … un mélange percutant. »A.N.TELE MOUSTIQUE
-
« Sepúlveda, l’éternel exilé chilien, nous revient avec un recueil de textes qui éclairent ses romans, et quelques fondamentaux de la littérature hispano-américaine. »Olivier Van VaerenberghFOCUS VIF
-
« Les héros silencieux de Luis Sepúlveda » entretien à lire ici.Camille de MarcillyLA LIBRE Belgique
-
« Décidément, le "vieux cœur rouge et noir" de Sepúlveda n’a jamais été aussi agréable à entendre battre. »Michel GensonLE REPUBLICAIN LORRAIN
-
« Les lecteurs de Luis Sepúlveda y retrouveront quelques-uns des meilleurs moments de son œuvre littéraire et de son inimitable force narrative. Son talent est de transformer observations et anecdotes en histoires fascinantes. »OUEST FRANCE
-
« Un beau moment d’humanisme en 22 histoires tendres et émouvantes. »Jean-Paul GuéryLE COURRIER DE L’OUEST
-
« Un recueil de nouvelles à la puissante force narrative où les anecdotes se métamorphosent en histoires fascinantes. »Patrick BeaumontLA GAZETTE DU NORD-PAS-DE-CALAIS
-
« Sur la barricade des mots, Sepúlveda a toujours ses gants, prêts au combat pour les idées et pour les hommes. »Daniel RuizCENTRE FRANCE
-
« On retrouve le regard aigu, parfois caustique, du militant qui avait connu la prison sous Pinochet, et aussi et surtout, son talent pour habiller la réalité aux couleurs de la fiction nuancée de poésie. »Pierre SchaveyTHE LION MAGAZINE
-
« Un beau livre qui mêle étroitement la poésie de conteur de Sepúlveda et son leitmotiv politique qu’est le refus d’accepter la défaite… »Vincent LabaumeTOUT PREVOIR
-
« Tout est prétexte à poésie chez l’auteur du Vieux qui lisait des romans d’amour… »TEMOIGNAGE CHRETIEN
-
« Luis Sepúlveda revient, à travers vingt-cinq historiettes, sur ses thèmes de prédilection, qui ont forgé sa vie et son parcours d’écrivain. »Thierry ClermontFIGARO LITTERAIRE
-
« Alors, comme en visite chez lui, il comprit que l’exil n’est rien, qu’il accompagne la mélancolie du voyageur et lui fait parfois écrire les plus beaux livres. »Olivier MonyLIVRES HEBDO
-
« Chronique après chronique, l’auteur chilien se confie. Histoires d’ici et d’ailleurs est un livre d’amis et de conviction. » Entretien à lire ici.entretien avec Adrienne NizetLE SOIR
-
« D’un récit à l’autre, le Chilien brandit sa lanterne d’Aladin sur une époque qu’il rêve de réenchanter »André ClavelLIRE
Portrait de groupe sur fond d'absence : un reportage
Un : un jour de 2009. Gijón. Asturies
Ce reportage a surgi soudain au milieu des cartons de vieux documents, de papiers anonymes, de textes conservés sans savoir pourquoi. Daté de mai 1990, il est écrit dans un gros cahier de fabrication chinoise, acheté peut-être au Speichert d'Hambourg.
Retrouver de vieux textes c'est comme se retrouver soi-même et ces retrouvailles sont toujours émouvantes. Je l'ai lu, j'ai fait tourner la machine de la mémoire, je me suis rappelé qu'il avait été publié un an plus tard dans le Lateinamerika Nachrichten du mois de mai 1991 et que sa première intention était de raconter l'histoire de deux photographies. Mais ces images ont disparu et il ne reste plus que les mots. De vieux mots écrits il y a presque vingt ans.
Je suis heureux de reconnaître que le Chili décrit dans ce reportage a beaucoup changé en bien et en mal : les noms des victimes ont été revendiqués, de nombreux criminels sont en prison, le tyran est mort comme un misérable voleur et ceux à qui le pouvoir a fourni une occasion de s'enrichir y sont parvenus et sont de plus en plus riches.
Mais ces vieux mots gardent leur inaltérable colère.
Deux : mars 1991. Hambourg. Allemagne
Au cours de ma vie, j'ai affronté beaucoup de situations qui m'ont longtemps obligé à me taire, le verbe paralysé par une sclérose qui ne connaît d'autre thérapie que la colère ou l'action.
Il y a exactement douze mois, j'ai fait un voyage au Chili après quatorze ans d'exil. Je voulais vivre les derniers jours officiels d'une dictature trop cruelle pour être effacée par une simple cérémonie civique, et les débuts du retour à une démocratie, fruit du désespoir plus que du courage et qui, dans un passé encore récent, avait renversé le tyran. Une démocratie fatiguée dès sa naissance, surveillée, autorisée et liée par un pacte monstrueux : construire l'euphémisme permettant de sauver la face d'un État de délinquants, en acceptant publiquement l'existence des crimes commis mais pas les noms des criminels.
Un curieux accord des forces politiques a défini ce pacte comme étant le “prix de la modernité” et, pour cela, on se réfère à d'autres expériences de transition entre des dictatures et des systèmes démocratiques, comme celle de l'Espagne après la mort de Franco ou de l'Allemagne après la capitulation du Troisième Reich et la dénazification de l'État. Dans ces deux cas on impose l'oubli au nom de la raison d'État mais les pères de cette formule ignorent qu'au Chili nous sommes imbattables dans tous les domaines : dans l'audace et la naïveté, les succès et les erreurs, le talent et la stupidité.
À titre d'exemple, citons la devise de notre blason national “Par la raison ou par la force”. Le plus parfait des contresens. Un véritable appel à la barbarie.
Tous les exils durent trop longtemps et chaque expérience est unique elle aussi. Dans le cas des Chiliens, il s'est traduit pour certains par le reniement de leurs anciennes convictions et, après des serments dans les antichambres des fondations Konrad Adenauer, Pablo Iglesias ou Friedrich Ebert, ils ont repris brillamment leurs carrières politiques : le pouvoir les attendait.
D'autres se sont interminablement cogné la tête contre les évidences qui démontraient l'échec de la justice et de l'égalité imposées par décrets : après avoir relu leurs anciens manuels de tactique et de stratégie, ils n'ont pas hésité à qualifier de traîtres les peuples qui s'étaient débarrassés de tyrannies médiocres et séniles et ont fini par traiter d'égarés les pauvres gars obéissants qu'ils envoyaient se battre dans des forêts inexistantes, prendre des armes qui n'arrivaient pas, conduire des masses qui ne les attendaient pas et mourir pour de vrai tandis qu'eux se réservaient pour des temps meilleurs : le pouvoir les attendait.
D'autres encore, les moins nombreux, ont affronté l'exil comme une sorte de bourse d'études, de découvertes, et n'y ont trouvé que des doutes : doutes sur l'histoire, doutes sur les recettes pour la changer, doutes sur la légitimité du pouvoir.
Un an s'est écoulé depuis mon retour au Chili et tout reste pareil même si, dans le discours officiel, tout a changé : maintenant on appelle ignorance le manque de courage civil et la complicité avec les criminels en uniforme, l'oubli des devoirs élémentaires est devenu de la négligence et l'assassinat, un excès.
Le cynisme inonde les dictionnaires et le vieil art de la politique s'est transformé en concours d'euphémismes. C'est l'éthique du nouvel ordre international, l'ordre de la fin du siècle. Mais ces certitudes permettent au moins de savoir à quoi s'en tenir et, pour ma part, de rompre un long silence, la colère contenue me délivre de la sclérose et je peux enfin affronter le sujet avec un an de retard.
Autre raison de mon retour au Chili : des visages d'enfants souriants. Quand j'ai vu pour la première fois ce portrait d'un groupe de gamins, j'ai su que je ne pourrais jamais l'oublier. C'était chez Anna Petersen, l'auteur de la photographie. Je venais d'arriver en Allemagne, mon exil ne durait que depuis quatre ans mais ils avaient suffi pour que le Chili devienne pour moi une référence douloureuse et de plus en plus lointaine.
J'ai d'abord été impressionné par la douceur de ces visages puis, après avoir examiné plus attentivement les attitudes, j'ai trouvé le grand secret de ce portrait de groupe : la pureté.
Il y avait chez ces gamins la pureté originelle que nous trouvons sur les milliers de photos prises tous les jours dans les jardins d'enfants ou les écoles européennes. Mais ces gosses ne vivaient pas en Europe. Ils vivaient au Chili, à La Victoria, un quartier pauvre de Santiago et l'un des plus touchés par la répression et la misère. Alors, j'ai tremblé de peur devant cette pureté et j'ai voulu me demander combien de temps il leur faudrait pour la perdre.
Les années ont passé. L'exil s'est prolongé au-delà des discours triomphalistes jusqu'en février 1990. Pendant toutes ces années j'ai conservé la photo car la pureté de ces enfants représentait tout ce qui me restait du Chili que j'avais connu.
Entraînée par ma passion pour ces visages, Anna Petersen a accepté de refaire le voyage afin de les retrouver et de les reprendre en photo au même endroit. Nous avons pensé que les deux photographies et le temps écoulé entre les deux pouvaient constituer un récit ou un reportage. Mon billet en poche, je me suis donc rendu pour la dernière fois au consulat du Chili de Hambourg pour m'assurer de nouveau que je pouvais rentrer.
–Oui, vous pouvez. Votre nom figure sur la troisième liste des personnes autorisées à voyager, m'a dit un fonctionnaire protégé par une vitre à l'épreuve des balles.
J'ai quitté le consulat en me disant que la générosité de la dictature était humiliante. Le droit de se déplacer ou pas est inhérent à l'être humain. La permission de se déplacer ou pas est une atteinte, cruelle et planifiée, à la liberté individuelle.
Trois : mars 1990. Santiago du Chili
La dictature a pris fin il y a moins d'une semaine. C'est encore l'été. Un épais nuage de pollution couvre la ville et s'approprie les distances, en rendant les contours incertains. Je dis au chauffeur de taxi que l'air de Santiago est pire que dans mon souvenir.
–Il ne faut pas se plaindre, en Angleterre ils ont du brouillard et, comme nous sommes les Anglais de l'Amérique du Sud, enfin, un succédané, on doit se montrer à la hauteur, répond-il, les yeux fixés sur la rue.
En passant dans les quartiers sud on voit de nombreux groupes de Chiliens se livrer aux mille activités de la vie quotidienne, des choses sans intérêt comme acheter du pain, attendre le bus, lire les journaux accrochés dans les kiosques ou simplement regarder vaguement dans une direction sans savoir ce qu'on cherche à voir. La vie toute simple. La vie des êtres anonymes au nom desquels, paraît-il, on fait les révolutions. Mais ces habitants des quartiers pauvres ont un point commun, un caractère distinctif comme une marque au fer rouge : sur leurs visages on lit le désespoir, l'apathie, l'ennui qui ont succédé à une vie en société jadis très riche et, pour cette raison, brutalement éliminée.
Je les regarde – je regarde les miens – et j'ai du mal à croire que ce sont les mêmes qui participaient, comme moi, à une vie sociale si bouillonnante qu'on ne sentait pas la fatigue. Une vie démocratique, essentiellement démocratique qui plus est.
Ils participaient et votaient dans les syndicats.
Ils participaient et votaient dans les associations de parents d'élèves.
Ils participaient et votaient dans les associations de quartier.
Ils participaient et votaient dans les organismes de secours mutuels.
Ils participaient et votaient dans les centres sociaux.
Ils participaient et votaient dans les instances de base des partis politiques.
Chaque Chilien était membre d'au moins trois associations différentes. En y repensant, le mot élire m'a semblé beau et lointain, le simple geste de lever la main, de demander la parole, d'écrire un nom sur un modeste bulletin, digne et secret, au moment de désigner le dirigeant d'une organisation quelconque. Et je me suis également rappelé, avec un mélange de douleur et de honte, que j'avais fait partie de ceux qui, avec dans une main les plus douteuses interprétations du marxisme et dans l'autre les plus nobles intentions, avaient porté les premiers coups mortels à cette vie démocratique et saine.
Les organisations populaires chiliennes de toutes natures, excepté les partis politiques, étaient régies par un conglomérat de normes destinées à assurer la participation et à remplacer les dirigeants inefficaces ou simplement désireux de quitter leur poste. Tout était soumis à des normes. Brusquement, un jour, dans le plus modeste des clubs sportifs du quartier le plus reculé de Concepción, de Santiago ou de Valparaíso, après un vote pour désigner un nouveau président, son prédécesseur prononçait dans son discours d'adieu une phrase à graver dans le marbre : “Les hommes passent, les institutions restent.” Et ils le croyaient. Nous le croyions. Salvador Allende a dit un jour, avec raison, que nous étions un pays notarial. On faisait confiance et on croyait à la légalité parce qu'on la pratiquait. Tous les jours, dans un bar quelconque, quand deux poivrots se disputaient, l'un disait soudain à l'autre : “Tu es un imbécile.” Et la réponse inévitable était : “Tu vas me répéter ça devant un notaire.”
Mais nos catéchismes de gauche nous ont dit que c'étaient des comportements bourgeois et, pour imposer les arguments des partis politiques, nous avons sapé l'unité des organisations sociales. C'était notre manière de conquérir le pouvoir : la fin justifie les moyens, celui qui n'est pas avec nous est contre nous. Et pourtant toutes ces organisations nées de l'influence des premiers anarchistes ont adhéré à notre rêve collectif, à l'effort des mille jours du gouvernement d'Allende. Jamais un leader n'avait reçu, comme Salvador Allende, l'appui de son peuple. Et sa mort à La Moneda était la seule manière de répondre dignement à autant de dévouement et de générosité.
Je demande à l'un de ces visages qui regardent vaguement dans une direction comme pour chercher l'avenir dans le nuage de pollution ce qu'il pense de la nouvelle situation, du récent retour à la démocratie.
Il hausse les épaules et me répond :
–Les choses ne peuvent pas être pires qu'avant, mon vieux.
Entrer dans le quartier de La Victoria n'a pas été facile. Ses habitants n'aiment ni les curieux ni les touristes de la misère. Par l'intermédiaire de la Vicaría de la Solidaridad, cette institution de l'église catholique chilienne qui, pendant les années de dictature, a fait office de ministère de la douleur, de seul lieu de consolation possible, nous avons obtenu une sorte de sauf-conduit permettant de pénétrer dans le ghetto et d'y faire exactement ce que nous avons déclaré : rechercher les enfants de la photo, essayer d'en faire une autre au même endroit et parler avec eux des huit ans séparant les deux clichés.
Notre contact s'appelle Alicia, c'est une déléguée de quartier qui travaille au Front anti-alcoolisme et fait fonctionner une crèche fièrement appelée Kindergarten. Elle nous reçoit entourée de mouflets. Les plus jeunes ont trois ans et les plus grands, six ou davantage pour certains.
Les enfants nous entourent, nous décernent le titre de tíos et entonnent pour nous Gana la gente, l'hymne de la coalition opposée à la dictature qui a porté Patricio Aylwin à la présidence après seize ans de tyrannie. Malgré la douceur de leurs voix, les phrases, les vers boiteux semblent lointains, métalliques, peut-être même froids. Quand ils ont fini, je leur en demande une autre, une bien à eux, une de celles qu'ils chantent devant leurs bureaux lilliputiens, au Kindergarten.
Alors une fillette se lance : “Petit cheval blanc, emporte-moi, conduis-moi vers la terre où je suis née…”






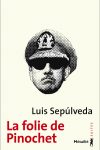










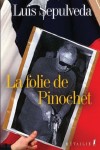




-100x150.jpg)





-100x150.jpg)