Si votre mari va aux toilettes dans un aéroport et disparaît, si ensuite vous recevez une demande de rançon venant d'une organisation terroriste et que vous êtes l'auteur d'une série de livres pour enfants dont le héros est Belinda la cocotte, que faire ? Pleurer d'abord puis décider de comprendre ce qui vous arrive. Et si la chance veut que vous rencontriez vos voisins de palier dont l'un se révèle être un vieil anarchiste octogénaire, ancien torero, compagnon de Durruti, dont les récits de la guerre d'Espagne vont former la toile de fond de vos soirées, et l'autre un on e 20 ans naïf et terriblement attirant, vous découvrez comme Lucia que vous ne tenez finalement pas tant que ça à ce mari disparu et qu'il est temps de donner un sens à votre vie.
Ce trio disparate va mener l'enquête et découvrir un monde fait de mensonges et de personnages retors que l'habileté du vieil anarchiste, Fortuna, réussira à contrôler.
Entre thriller et roman initiatique, ce beau roman, prenant, bien construit, plein d'humour et d'émotion, raconte à trois voix le passage de la jeunesse à la maturité, cette frontière de la quarantaine où l'univers se réorganise et où nous croyons pouvoir déchiffrer l'énigme que nous sommes pour nous-même.
PRIX PRIMAVERA 1997
-
"[...] derrière la légèreté apparente, la plume alerte de Rosa Montero nous livre une réflexion sensible sur l'identité, l'étrangeté insondable de l'autre, la trahison. >C'est là toute la force de ce roman, désenchanté et désopilant à la fois. Portrait d'une génération d'Espagnols devenus adultes à la fin du franquisme. Portrait d'une femme qui voit s'enfuir sa jeunesse. Et portrait malicieux d'une écrivaine qui adore lâcher la bride à son imagination, pour mieux célébrer la vie. Revigorant.Corinne BourbeillonOUEST FRANCE
-
« Lucia a pour Ramon, son époux grassouillet, des sentiments qui s'effilochent depuis longtemps déjà. [...] Confrontée à une sombre demande de rançon, la narratrice décide de jouer les détectives [...] le tout piqué, avec une écriture jubilatoire et moqueuse, d'observations irrésistibles sur la grammaire des sentiments. [...] R. Montero prouve encore une fois que littérature et fantaisie débridée forment l'un des rares couples que ne guette pas l'usure. »Clémence BoulouqueMADAME FIGARO
-
"Un récit est un immeuble. Pour tenir, il lui faut des fondations solides, plantées dans les tréfonds de la terre. Et aussi un art de l'empilement. Rosa Montero est une architecte hors pair. [...] Rosa Montero jongle avec les formes narratives, sa plume joue aux ascenseurs espiègles : elle peut revenir au rez-de-chaussée, pour reprendre l'aventure policière, s'arrêter à la comédie, avant de filer vers le drame intime."Clara Dupont-MonodMARIANNE
-
"Alternance des voix pour une alternance des rôles entre trois personnages qui racontent le passage de la jeunesse à la maturité, avec ce cap de la quarantaine où les réponses semblent enfin l'emporter sur les questions. Tu parles ! suggère aussitôt Rosa Montero, tantôt grave et lucide, ironique et drôle, prompte à brouiller toutes les pistes sans renoncer à une construction en béton. Sans renoncer non plus à une profonde réflexion sur l'identité qui domine ce roman épatant dont Félix résume si bien l'idée maîtresse : " Vivre, c'est perdre. "Delphine PerasLIRE
La plus grande révélation que j'ai eue dans ma vie a commencé par l'observation de la porte battante de toilettes publiques. J'ai remarqué que la réalité a tendance à se manifester ainsi, absurde, inconcevable et paradoxale, si bien que de la grossièreté naît souvent le sublime; de l'horreur, la beauté, et de la transcendance, l'idiotie la plus totale. De la même manière, quand ce jour-là ma vie a changé pour toujours, je n'étais pas en train d'étudier l'analytique transcendantale de Kant ni de découvrir dans un laboratoire comment guérir le Sida ou de clore un gigantesque achat d'actions à la Bourse de Tokyo, mais simplement de regarder d'un œil distrait la porte beige de vulgaires toilettes pour hommes de l'aéroport de Barajas.
Au départ, je ne me suis même pas rendu compte qu'il se passait quelque chose d'anormal. C'était le 28 décembre, et Ramón et moi allions passer la fin de l'année à Vienne. Ramón est mon mari: il y avait un an que nous étions mariés, et neuf que nous vivions ensemble. Nous avions déjà passé le contrôle des passeports et nous étions dans la salle d'embarquement, attendant le départ de notre vol, quand Ramón a eu envie d'aller aux toilettes. Je dois avoir quelque ancêtre berger dans mon obscure généalogie de plébéienne, parce que je ne supporte pas que les gens qui sont avec moi se dispersent et telle ma Chienne-Phoque qui cherche à garder sa portée autour d'elle, j'essaie de retenir les amis avec qui je sors. Je fais partie de ce genre de personnes qui recomptent à tout bout de champ les gens de leur groupe, demandent à ceux qui traînent de se hâter et à ceux qui sont devant de ne pas courir si vite, et qui, lorsqu'elles entrent avec d'autres dans un bar bondé, ne sont pas rassurées tant qu'elles n'ont pas installé ceux qui les accompagnent dans un petit coin de la pièce, tous côte à côte. Aussi comprendra-t-on aisément qu'avec un tel tempérament, je n'étais guère ravie que Ramón s'en aille juste au moment où nous attendions l'embarquement. Mais nous disposions encore de pas mal de temps et les toilettes étaient en face de nous, tout près, visibles, juste à trente mètres de mon siège. Si bien que j'ai pris les choses calmement et lui ai demandé seulement deux fois de ne pas traîner.
- Ne traîne pas, d'accord? Ne traîne pas.
Je l'ai regardé pendant qu'il traversait la pièce: grand mais gras, bouée autour de la taille, fesses et ventre proéminents, sommet du crâne un peu dégarni émergeant d'une bande de cheveux châtains et fins. Il n'était pas laid: il était mou. Quand j'avais fait sa connaissance, dix ans auparavant, il était plus mince, et l'apparence de vigueur que lui donnait son squelette m'avait fait penser que sa mollesse intérieure était purement et simplement de la sensibilité. Ce sont de ces confusions irréparables que sont faits les quatre cinquièmes des couples. Au fil du temps, ses fesses et l'ennui qu'il distille avaient pris du poids, et au moment où nous ne pouvions plus passer plus d'une heure ensemble sans nous décrocher la mâchoire à force de bâiller, nous avions eu la bonne idée de nous marier pour voir si les choses s'amélioreraient. La réponse est non.
J'étais vaguement absorbée par toutes ces pensées, je veux dire que je ne leur accordais pas un intérêt démesuré, laissant ma tête voguer d'une idée à l'autre tout en regardant la porte des toilettes battre. Je pensais donc à Ramón, mais aussi que je devais parler avec l'illustrateur de mon dernier conte pour lui dire de changer les esquisses du Petit Âne Bavard parce qu'il ressemblait plutôt à une Petite Vache Vociférante, et que je commençais à avoir faim. Je me suis dit que j'irais voir la Vénus de Willendorf à Vienne, et l'image de cette statuette ventrue m'a fait repenser à Ramón, qui traînait trop. Les hommes entraient de temps à autre dans les toilettes, puis en ressortaient, tous plus expéditifs que mon mari. Par exemple, ce garçon qui poussait en ce moment la porte était entré bien après Ramón. Comme tant d'autres fois, j'ai commencé à le haïr. Une haine banale, familière, ennuyeuse.
Maintenant un gilet rouge sortait des toilettes un vieux monsieur à moitié chauve, assis dans un fauteuil roulant. J'ai réfléchi quelques minutes à la foule de vieillards qui se déplacent actuellement dans des fauteuils roulants dans les aéroports. Oui, beaucoup de vieillards, mais surtout beaucoup de vieilles femmes. Sarmenteuses et vieilles comme Mathusalem, rendues par l'âge prisonnières de leurs fauteuils et transportées d'un endroit à l'autre comme des paquets: dans les ascenseurs, on les installe face au mur et elles contemplent stoïquement le pan de métal pendant tout le trajet. Mais, par ailleurs, ce sont de vieilles dames triomphantes qui ont vaincu la mort, les maris, les probables pénuries de leur vie passée; vieilles voyageuses, fouinardes, supersoniques, qui se trouvent dans un aéroport parce qu'elles vont d'un endroit à l'autre comme des fusées et sont probablement enchantées d'être transportées par un gilet rouge; enchantées, que dis-je? Bien plus, à coup sûr se sentent-elles vengées: elles, qui ont porté des foules d'enfants pendant tant d'années, sont maintenant portées comme des reines sur ce trône conquis de haute lutte qu'est leur fauteuil roulant. Un jour, je suis tombée sur l'une de ces vieilles dames volantes dans l'ascenseur de je ne sais quel aéroport. Elle était encastrée dans son fauteuil comme une huître dans sa coquille et c'était un tout petit bout d'être humain, une minuscule momie édentée aux yeux rendus vitreux par l'âge. Je l'observais en catimini, à mi-chemin entre la compassion et la curiosité, quand la vieille femme a tout à coup levé la tête et rivé son regard laiteux sur moi: "Il faut jouir de la vie tant qu'on peut, a-t-elle dit d'une petite voix fine mais ferme; puis elle a fait un large sourire, d'une satisfaction presque féroce. Telle est la victoire finale de ces êtres décrépits.
Et Ramón ne sortait pas. Je commençais à m'inquiéter.
Je me suis alors demandé, je ne sais pas très bien pourquoi, si quelqu'un saurait m'identifier si je me perdais. Un jour, dans un autre aéroport, j'ai vu un homme qui me rappelait un ancien amant. J'avais passé plusieurs mois avec lui et il y avait tout juste deux ans que je ne le voyais plus, toutefois, à ce moment-là, je n'étais pas du tout sûre s'il s'agissait, oui ou non, de Tomás. Je le regardais de l'autre bout de la salle et, par moments, il lui ressemblait comme deux gouttes d'eau: même corps, même manière de se déplacer, même catogan, même ligne de la mâchoire, mêmes yeux battus comme ceux d'un panda. Mais un instant plus tard, la ressemblance s'estompait et je me disais qu'ils n'avaient rien en commun, ni l'expression ni la physionomie ni le regard. Je me suis approchée un peu de lui, en catimini, pour en avoir le cœur net, et même de plus près je n'ai pas réussi à me faire une opinion; j'étais aussi vite convaincue que c'était lui, et je me souvenais de moi-même passant le bout de ma langue sur ses lèvres gourmandes, que j'étais tout à coup sûre et certaine d'observer un visage qui m'était complètement étranger. Je veux dire que, ne l'ayant pas vu depuis seulement deux ans, je n'étais plus capable de le reconstruire avec mes yeux, comme si pour pouvoir reconnaître l'identité de l'autre, de n'importe quel autre, il fallait toujours être en contact avec lui. Parce que l'identité de chacun est quelque chose de fugitif, de fortuit et de changeant, si bien que si l'on cesse de regarder quelqu'un pendant longtemps, on peut le perdre pour toujours, exactement comme si l'on était en train de suivre des yeux un petit poisson dans un immense aquarium et que, tout à coup, on se laissait distraire, et lorsqu'on regarde de nouveau, il n'y a plus rien qui le distingue de tous les autres de son espèce. Je me disais qu'il pourrait m'arriver la même chose, que si, un jour, je me perdais, peut-être personne n'arriverait à se souvenir de moi. Heureusement que dans de telles situations, on peut avoir recours aux signes d'identité, toujours si utiles: Lucía Romero, grande, brune, yeux gris, mince, quarante et un ans, cicatrice d'appendicite sur le ventre, cicatrice en forme de croissant au genou gauche à la suite d'une chute de bicyclette, grain de beauté rond et très gracieux à la commissure des lèvres.
À ce moment-là, les haut-parleurs ont commencé à nous appeler pour embarquer et toute la salle s'est levée. J'ai pris le sac de Ramón et le mien, et je me suis dirigée, furieuse, vers la porte battante des toilettes, en sens contraire de tout le monde, ayant l'impression d'être une maladroite fugitive qui, au moment crucial où tous fuient la ville assiégée, prend la mauvaise direction. Dans toutes les montées ou toutes les descentes d'avion, il y a quelque chose d'un exode frénétique. J'ai appelé de la porte:
- Ramón! Ramón! L'avion part! Qu'est-ce que tu fais là-dedans?
Des toilettes sont sortis précipitamment deux adolescents et un monsieur d'une cinquantaine d'années qui avait l'air d'avoir des problèmes de prostate. Mais point de Ramón! J'ai poussé un peu la porte battante et ai regardé à l'intérieur. Tout semblait vide. Le désespoir et l'inquiétude croissante m'ont donné la force de briser le tabou des urinoirs masculins (territoire interdit, sacralisé, étranger), et j'y suis entrée d'un pas ferme. C'était un grand local, blanc comme une salle d'opérations. À droite, il y avait une file de cabinets fermés par des portes; à gauche, les sempiternelles pissotières ventrues contre le mur; au fond, les lavabos. Pas d'autre sortie et pas une seule fenêtre.
- Pardon! ai-je crié en demandant des excuses au monde entier pour mon audace. Ramón? Ramón! Où es-tu? On va rater l'avion!
Dans le silence, on n'entendait que le tintement de l'eau. J'ai avancé vers le mur des lavabos, ouvrant les portes des cabinets et craignant de trouver Ramón affalé par terre: un infarctus, une embolie, un évanouissement. Mais non. Il n'y avait personne. Comment était-ce possible? J'étais sûre et certaine d'avoir surveillé en permanence l'entrée des toilettes. Disons que j'en étais presque sûre: il était évident que Ramón était sorti, aussi avais-je dû, à un moment ou à un autre, me laisser distraire; à tous les coups, Ramón devait maintenant m'attendre dehors, peut-être même irrité de ne pas me trouver; tout compte fait, c'était moi qui avais les billets. Je suis sortie en courant des toilettes et me suis dirigée vers la porte d'embarquement, devant laquelle s'agglutinaient encore pas mal de gens, et j'ai cherché Ramón des yeux dans la foule bigarrée des voyageurs. Rien. Je l'ai alors haï comme je le hais d'ordinaire, l'une de ces haines répétitives, sèches et fulgurantes, si fréquentes dans la vie des couples.
- Mais quelle ordure! Où diable peut-il être? À tous les coups il est encore allé s'acheter des cigarettes au free shop, c'est toujours pareil, comme s'il ne savait pas dans quel état de nerfs les voyages me mettent, ai-je marmonné d'une voix presque audible.
Puis je me suis éloignée de la queue, vers un endroit bien visible, posant les lourds sacs par terre et attendant désespérément son retour.
Les heures suivantes comptent parmi les plus ingrates de ma vie. D'abord, la foule de passagers qui s'entassaient devant la porte a décru, de façon fluide, implacable, comme un sablier qui se vide, et un peu plus tard, il n'y avait plus personne devant le comptoir. L'employée d'Iberia m'a dit de passer, je lui ai expliqué que j'attendais mon mari, elle m'a demandé d'aller le chercher parce que le vol avait beaucoup de retard.
- Oui, bien sûr, mais où? ai-je répondu, navrée.
Toutefois, je l'ai cherché, j'ai laissé les sacs à l'employée et j'ai couru comme une folle dans l'aéroport, me suis montrée au free shop, au bar, dans les boutiques, au kiosque à journaux tout en entendant les haut-parleurs commencer à appeler: "Don Ramón Iruña Díaz, passager du vol Iberia 349 à destination de Vienne, doit se présenter d'urgence à la porte d'embarquement B26.
J'ai rebroussé chemin à bout de souffle et en nage dans mes vêtements d'hiver, espérant le retrouver devant la porte, penaud et avec quelque explication plausible à la bouche. Maintenant il y avait deux hommes et deux femmes en uniforme.
- Madame, l'avion doit partir, nous ne pouvons pas attendre plus longtemps votre mari.
Qu'on m'appelle "madame m'a toujours déprimé, mais à ce moment-là, j'ai souhaité mourir.
- Ne vous inquiétez pas, ça arrive très souvent. Puis ils arrivent pompettes, disait l'une des femmes, je suppose pour me consoler.
Et moi qui devais balbutier que Ramón était sobre!
- Ou alors ils sont partis comme ça, tranquilles comme Baptiste. Tu te souviens de ce type qui a pris un autre vol pour aller passer un week-end avec sa secrétaire? a demandé à son collègue l'un des deux hommes.
Moi, j'essayais de me raccrocher à un reste de dignité pour dire que non, que Ramón n'aurait jamais, bien sûr, fait une chose pareille.
J'ai cru remarquer, encore absorbée par ma mésaventure, que dans les commentaires des employés d'Iberia affleurait une irritation considérable, chose d'une certaine manière normale car il ne faut pas oublier qu'ils avaient dû sortir nos bagages de la soute et que, à force, le vol avait presque une heure et demie de retard. Une responsable d'Iberia et un monsieur en civil qui, par la suite, s'est révélé être un policier ont parlé avec moi pendant quelques minutes. Je leur ai raconté pour la énième fois l'histoire des toilettes et le policier est allé les inspecter.
- Apparemment, rien de bizarre. Voyez-vous, madame, si j'étais à votre place, je rentrerais chez moi. Sûr qu'il va finir par apparaître; dans les couples, ces choses arrivent plus souvent que vous ne le pensez.
Mais quelles choses? La phrase du policier était mystérieuse, abominable. J'ai eu tout à coup l'impression d'être une adolescente naïve et sotte qui ignore les réalités les plus élémentaires de la vie adulte: comment, mais tu ne sais pas que les maris ont toujours une étrange tendance à se volatiliser quand ils entrent dans les toilettes publiques? Mes joues ont rougi et je me suis sentie coupable, comme si j'étais d'une certaine façon à l'origine de la disparition de Ramón.
La responsable a vu mon visage devenir cramoisi et a profité de mon trouble pour se débarrasser du bébé et prendre la tangente. Le policier en a fait autant et je me suis tout à coup retrouvée seule au beau milieu de la salle d'embarquement vide, seule avec un chariot chargé de valises qui n'allaient plus nulle part, seule dans cet aéroport désolé et désert, voyageuse bloquée et sans destination, aussi désemparée que quelqu'un qui s'est perdu dans un mauvais rêve.
J'ai passé quelques petites heures, je ne sais combien, dans cet état de stupeur, attendant l'arrivée miraculeuse de Ramón. J'ai parcouru plusieurs fois l'aéroport en poussant l'encombrant chariot et ai assisté à l'embarquement d'un nombre infini de vols à partir de la fatidique porte B26. La certitude qu'il ne reviendrait pas a commencé à me trotter dans la tête. Il m'a sans doute abandonnée, me suis-je dit, comme l'affirmait clairement le policier. Peut-être est-il parti avec sa secrétaire aux Bahamas (mais Marina avait soixante ans). Ou peut-être encore est-il, en effet, ivre mort, affalé et caché dans un coin. Mais comment aurait-il pu faire tout ça sans sortir des toilettes? Je l'avais vu entrer, mais il n'était pas ressorti.
Si bien que j'ai hélé un taxi et je suis rentrée à la maison et, après avoir vérifié ce que je savais déjà fort bien, que Ramón n'était pas là non plus, je me suis dirigée vers le commissariat pour déposer une plainte. On m'a posé mille questions, toutes désagréables: comment lui et moi nous entendions, Ramón avait-il des maîtresses, des ennemis, nous étions-nous disputés, était-il nerveux, prenait-il des drogues, son comportement avait-il changé ces derniers temps? Et, même si j'ai simulé une assurance outragée en leur répondant, l'interrogatoire m'a fait remarquer le peu d'attention que j'accordais à mon mari, à quel point je connaissais mal les réponses, l'immense ignorance avec laquelle la routine recouvre l'autre.
Mais cette nuit-là, dans le lit, abasourdie par la dimension incompréhensible des choses, j'ai été étonnée d'éprouver une souffrance que j'avais perdue de vue depuis longtemps: la souffrance due à l'absence de Ramón. Tout compte fait, il y avait dix ans que nous vivions ensemble, dormions ensemble, supportant nos ronflements et nos quintes de toux, les chaleurs d'août, les pieds glacés en hiver. Je ne l'aimais pas et, comme si ça ne suffisait pas, il m'irritait, il y avait très longtemps que j'envisageais la possibilité de me séparer de lui, mais il était le seul à m'attendre quand je revenais de voyage et j'étais la seule à savoir qu'il frottait tous les matins son crâne chauve avec une lotion. L'intimité de l'air qui se respire à deux, la transpiration qui se mêle, la tendresse animale de l'irrémédiable, ce sont de tels liens qui caractérisent la vie quotidienne. Aussi cette nuit-là, insomniaque et angoissée dans le lit vide, j'ai compris que je devais le chercher et le retrouver, que je ne pourrais pas me reposer tant que je ne saurais pas ce qui lui était arrivé. J'étais responsable de Ramón, non pas parce qu'il était mon homme, mais parce qu'il était mon habitude.
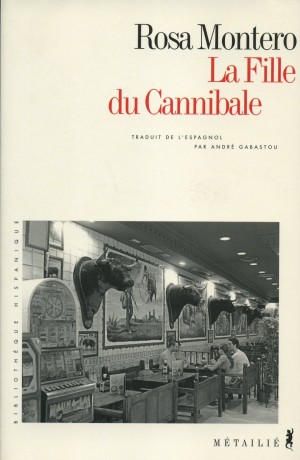











-100x150.jpg)

