David Le Breton revient ici au corps, mieux, à la peau et à son apparence, à son toucher. Il essaie de comprendre le rôle que jouent les cicatrices, ces traces permanentes d’existence passée qui ne sont pas toutes lisibles mais d’une certaine façon contaminent le sentiment d’identité tout entier, qui marquent à jamais le corps sur sa superficie des « avants » et des « après ».
Même si elles remplacent parfois le non-souvenir, sa permanence, sa rugosité sur notre frontière physique qui sépare le dedans du dehors, les cicatrices nous interdisent d’échapper à notre propre histoire physique. Elles rappellent un ancien corps à corps avec le monde et parfois même avec la société quand elle n’est pas provocation volontaire, voire anagramme du désir pour le plus positif, flétrissure pour le pire.
Un texte important sur un sujet qui concerne tout le monde.
-
Cicatrices, une sociologie de ces "traces d'événements". Spécialiste de la sociologie du corps, David Le Breton propose ici de s'intéresser aux cicatrices, ces "traces d'événements" qui nous marquent à jamais. Des cicatrices rituelles aux scarifications adolescentes, de l'acné à la cicatrice esthétique, vous saurez tout sur cette "existence dans la peau". A découvrir...Emmanuel Languille
-
"Motif cinématographique bien connu - celle de Harry Potter incarne toute sa destinée -, la cicatrice, grâce à David Le Breton, devient un objet anthropologique à part entière. […] Dans un style élégant, il explore toutes les voies par lesquelles les détails du corps physique ouvrent sur le corps politique."Sidonie BlaiseLe Monde des Livres
-
"Ce livre de David Le Breton, passionnant, embrasse à plein son sujet. II s'abreuve à plusieurs sources, de la médecine à la peinture, en passant par la philosophie, la litté rature, le cinéma, la psychologie... […] David Le Breton propose une réflexion stimulante et inédite, tout à la fois savante et populaire, sur un thème peu envisagé, qui concerne absolument tout le monde, le doute là-dessus n'est pas permis."Muriel SteinmetzL'Humanité
-
"Avec intelligence, l'auteur puise à toutes les sources - littérature, peinture, cinéma ou sciences - et nous promène des esclaves ou des Juifs marqués comme du bétail aux fières héroïnes de Hunger Games de Suzanne Collins, adapté au cinéma. Passionnant."Ariane BoisPsychologies Magazine
-
"En quelque 200 pages [David Le Breton] balaie nombre de clichés qui ont décidément la peau dure. Un livre savant et utile."Alice DeveleyLe Figaro littéraire
-
Ecouter le podcast de l'émission iciJulien MagnollayRTS - Tribu
-
"L'enjeu existentiel affleure dans chacun des livres de David Le Breton, dans sa façon de montrer comment nos identités s'expriment, ou se cherchent, dans les codes sociaux et les regards que nous portons les uns sur les autres. Et si la dimension autobiographique, comme en écho aux thèmes qu'il aborde, n'est également jamais très loin, c'est qu'il a importé à l'intérieur du champ universitaire les thèmes qui l'habitaient depuis sa jeunesse. Un chercheur qui n'a de cesse de se chercher lui-même, et qui aide ses lecteurs à se trouver."Frédéric ManziniSciences Humaines
Introduction
“J’étais dans ses bras. J’avais remonté la manche de son chemisier jusqu’à l’épaule pour voir la cicatrice de son vaccin. J’aime ça, dis-je. Cette auréole pâle sur son bras. Je vois l’instrument égratigner puis injecter le sérum avant de ressortir de sa peau. Cela s’est passé il y a des années, quand elle avait neuf ans. Dans la salle de gymnastique de l’école.”
Michael Ondaatje, Le Patient anglais
Les cicatrices participent à la géographie singulière de la peau. Déjà, celle de la blessure des origines qui détache l’enfant de sa mère pour le livrer à son existence propre. Le nombril est la trace de la rupture du cordon ombilical. Cicatrice inaugurale qui sera suivie de bien d’autres. On imagine mal un homme ou une femme qui en soit dépourvu, à telle enseigne que la chirurgie plastique s’efforce d’en fabriquer pour des enfants nés avec une extrusion des organes abdominaux hors de la paroi abdominale pendant la grossesse afin de ne pas les exposer aux moqueries de leurs camarades. Certaines interventions chirurgicales à l’abdomen exigent son élimination, mais aussi la forte aspiration à le reconstruire. En contrepoint le refus de toute dette de vie amène une adolescente en pleine détresse à essayer de découper son nombril dans le fantasme de couper tout lien avec sa mère, de ne plus lui être redevable de sa naissance.
Une cicatrice cristallise un moment de heurt avec le monde, elle est dans la peau comme un hiéroglyphe dont seule la personne qui la porte en elle connaît le sens. Ouverture de mémoire sur des fragments d’existence, parfois des abîmes laissés par les circonstances, elle raconte l’épisode d’une histoire à même la chair, dans son langage propre, et contribue à l’individualisation du sujet. D’une marque à l’autre s’esquisse une biographie sensible. Une jeune femme regarde un ancien compagnon qui se hisse sur la berge d’une rivière qu’il vient de traverser à la nage : “J’ai reconnu le grain de beauté sur son sein droit, la longue cicatrice pourpre juste en dessous, là où une branche d’arbre submergée lui avait déchiré la peau. Une autre cicatrice, plus claire, moins visible, marquait l’endroit où un rocher lui avait enfoncé trois côtes” (Rash, 2016, 101). Les traces de ses anciennes blessures le définissent à la fois comme individu singulier tout en pointant également sa passion pour le canoé sur une rivière sauvage.
Généralement, les cicatrices sont indemnes de douleur si la déchirure de la peau est lointaine, elles ne font plus aucun mal ou rarement, sauf si elles sont récentes, dans ce cas elles incarnent aussi une mémoire sensorielle. Zones d’intensité sensibles aux caresses, souvent investies dans les jeux amoureux, elles furent d’abord étrangères, répliques à des effractions, à la fois produites par le corps mais le débordant en modifiant son apparence. En amont, il y a une blessure ou une maladie, une altération de soi qui déchire la peau et suscite une émotion par le heurt brutal avec les aspérités du monde et l’écoulement du sang, la crainte aussi d’une affection durable, d’une trace peu esthétique sur soi. Elles sont une offense à l’ordre moral du corps, des anomalies, surtout si elles frappent par leur emplacement (le visage, par exemple) ou si elles sont très étendues. Elles sont ce qui reste de la destruction des tissus. Mais leur ambiguïté justement les rend parfois fascinantes. Elles sont des corps étrangers dont l’inscription implique la complicité des processus biologiques. Dans nos sociétés, elles ne sont jamais tout à fait à leur place, elles rompent l’unité de la peau et introduisent un chaos corporel qui suscite l’attention, à la différence des sociétés traditionnelles pour lesquelles, si elles s’inscrivent dans la culture, elles sont un haut lieu de l’affirmation d’une identité commune, et donc revêtent une valeur essentielle.
L’intrusion d’une cicatrice n’est pas dans l’ordre des choses. En s’incrustant dans la chair, elle en perturbe l’unité. Survenue dans un contexte d’agression, elle est péniblement vécue, elle enkyste un traumatisme qui se réveille à chaque regard sur soi ou à chaque question des autres. Victime d’une agression sexuelle, Line commence à se reconstruire lentement après la disparition de sa cicatrice grâce à une intervention de chirurgie réparatrice lui permettant de ne plus avoir en permanence sous les yeux le rappel de la violence subie. Parfois en effet, dans ce contexte la honte ou l’injustice du sort imprègnent la peau et font écran au sentiment de soi, rappellent sans fin l’indignité ou l’injustice vécues. Associée à une souillure, la cicatrice est alors synonyme d’opprobre. Elle contamine le sentiment d’identité tout entier. Elle garde affectivement la mémoire du moment, et elle fait encore mal.
Les cicatrices durent plus ou moins longtemps, accidentelles ou provoquées par des processus pathogènes. Sous nos yeux, le corps semble vivre son existence propre d’ouverture et de rétractation, la peau mobilise ses ressources de guérison sans solliciter l’attention ou la volonté. Certaines égratignures, griffures, plaies, ne tiennent que quelques jours avant de se refermer sans laisser de traces, mais d’autres accompagnent une vie entière. Il arrive qu’elles s’estompent peu à peu au fil du temps. Si la peau est sérieusement lésée, il faut des mois ou des années pour qu’elles cessent de donner une apparence moins à vif, moins boursouflée, et s’intègrent dans le paysage cutané avec plus ou moins de discrétion. Elles durent selon la gravité de la blessure, sa localisation, les soins, l’âge, chacune a sa vie propre… Certaines blessures donnent d’abord une belle apparence et portent la promesse de se résorber bien vite, mais elles finissent par rougir et se boursoufler avant d’aller lentement après plusieurs mois vers le blanchiment et l’apaisement.
Survivant du massacre perpétré par des islamistes dans les locaux de Charlie Hebdo en janvier 2015, Philippe Lançon est gravement blessé. Il évoque les suites d’opérations qui lui laissent douze meurtrissures fraîches qui devaient cicatriser en même temps mais qui, contre toute attente, restent dans le même état. “Je me sens coupable de mes cicatrices car il arrive toujours un moment où je me sens seul avec elles […]. Le patient ne fait pas ce qu’on lui dit de faire, ou mal, ou pas assez. Il masse trop peu ses cicatrices. Il ne met pas assez de vaseline dessus. Il a oublié d’acheter cette huile” (2018, 463). Il se sent en faute face aux médecins. Et les relations amoureuses ne sont pas aisées dans ce contexte quand son amie Gabriela lui rend visite : “Je ne pouvais l’embrasser véritablement, j’avais peur moi aussi de désunir les cicatrices et d’étaler sur son visage la vaseline qui les protégeait”
(466). Un homme opéré de la jambe s’insurge auprès de son chirurgien de l’état désagréable de sa cicatrice qui se détériore, alors qu’elle semblait anodine aux lendemains de l’intervention. Il ignore que chacune a son existence biologique échappant aux impatiences individuelles et à la toute-puissance du médecin.
En latin, cicatrice vient de cicatrix qui renvoie aux cicatrices, aux marques, aux blessures, aux lézardes… D’autres pensent que l’éthymologie vient de caecare : rendre aveugle, c’est-à-dire fermer une blessure, colmater les fissures ouvertes au sein du corps. Mais la brèche ainsi réparée demeure indiscrète. Le corps n’a pas toujours eu cette apparence. Une encoche de mémoire tissulaire rappelle l’incident. La trace cutanée se mue en signe d’identité. Elle est souvent utilisée pour identifier des corps demeurés anonymes dans les affaires criminelles ou sur les champs de bataille. Les “signes particuliers”, comme les tatouages ou d’autres singularités à fleur de peau, sont la seule carte d’identité désormais possible pour l’administration ou la police. Les cicatrices ne sont pourtant que des bribes d’une archive de soi, elles sont infimes au regard des mille événements qui traversent même un jour d’une vie, la peau n’est pas en mesure de les retenir tous, elle ne garde que les traces de ceux qui l’ont percutée sensiblement, même s’ils n’étaient pas les plus douloureux. Elles dessinent une sémiotique corporelle parfois énigmatique, elles incarnent une modalité du paradigme indiciaire exposé par Carlo Ginzburg (1989). Elles fixent un moment de l’histoire personnelle, mais elles ne sont pas toujours lisibles, elles ne sont pas toutes inscrites dans la mémoire. Leur détail n’ouvre pas toujours sur une totalité existentielle dont elle serait l’indice à déplier.
Dans Chronique d’hiver, Paul Auster effectue un inventaire des événements de son histoire qui l’ont marqué affectivement à ce moment où il approche de ce qu’il nomme “l’hiver de sa vie” (2019, 250). Immanquablement, il en vient à considérer ceux qu’il a dans la peau et que gardent ses cicatrices. Notamment celles de son visage qu’il voit chaque jour en se rasant ou en se peignant. Il les décrit comme “les lettres d’un alphabet secret qui raconte l’histoire de la personne que tu es, car chaque cicatrice est la trace d’une blessure guérie, et chaque blessure a été provoquée par une collision inattendue avec le monde” (11). Il se remémore les circonstances ayant ainsi laissé leur empreinte sur sa peau.
À trois ans, un médecin lui a recousu la joue après une chute sévère. Ce jour-là, sa mère craignit qu’il ne perde un œil ou ne soit défiguré : “La cicatrice s’est estompée au fil des années, mais elle est encore là chaque fois que tu la cherches, et tu porteras ce signe de bonne fortune (œil intact ! pas mort !) jusqu’à ta tombe” (13). Il se souvient de ses autres cicatrices, toutes acquises au moment de l’adolescence dans la turbulence de jeu ou d’activités sportives. Mais l’une d’elles reste une énigme sur laquelle il s’interroge : “Aucune histoire n’accompagne cette cicatrice-là, ta mère ne t’en a jamais parlé (en tout cas tu ne t’en souviens pas), et il te semble bizarre, voire carrément déconcertant, que cette trace permanente ait été gravée sur ton menton par une main invisible, que ton corps soit le site d’événements qui ont été effacés de l’histoire” (14). La succession des cicatrices décline les épisodes d’une histoire de vie, des fils narratifs qui rappellent la fragilité de toute existence. Elle laisse aussi des blancs énigmatiques, comme si un pan de l’histoire personnelle n’avait jamais existé.
Un personnage de Haruki Murakami se souvient d’une blessure faite par un éclat de verre enfoui dans un bac à sable où il jouait écolier. Son index gauche porte “une cicatrice d’environ sept millimètres, comme un petit morceau de fil blanc”. Un jour, signe d’intimité et d’amitié, il entreprend un inventaire de ses cicatrices auprès de deux amies : “Un vrai catalogue. D’abord, mon œil gauche qui avait été touché au cours d’un match de foot. Aujourd’hui encore, il me restait une marque sur la rétine. Ensuite, le nez, encore une fois à cause du foot. Alors que je m’apprêtais à marquer de la tête, je m’étais cogné contre les dents d’un gars d’en face. Et à ma lèvre inférieure, tenez, sept points de suture. Chute de vélo. Pour éviter un camion. Et encore, regardez, là, cette dent ébréchée…” (Murakami, 2016, 223). Les cicatrices sont les pages dépareillées d’une biographie intime, elles déclinent des moments d’existence, les reliques d’une confrontation brutale avec le monde. Elles sont parfois ce qui nous reste de l’enfance, de nos premiers pas, de nos premières expériences du vélo ou les vestiges de quelques joutes d’écolier. Pour les générations les plus anciennes, les traces de la vaccination antivariolique sur l’épaule signalaient un brevet d’appartenance à un pays où elles étaient alors obligatoires. Désormais, la maladie n’existe plus, et les autres vaccinations sont seulement attestées sur le papier ou l’écran, non plus sur la peau, elles n’impriment plus la peau.
Les cicatrices sont d’abord des significations, elles incarnent une valeur qui dépend de leur interprétation par leurs porteurs selon leur histoire de vie, des circonstances de leurs survenues. Celles valorisées par les uns sont répugnantes pour les autres. Certaines sont indifférentes, oubliées, sans histoire, sans incidence sur le sentiment de soi ou la vie quotidienne. Elles exigent un effort de remémoration, des hésitations. Elles demeurent dans l’insouciance de la vie. D’autres, pour le meilleur ou pour le pire, participent en profondeur du sentiment d’identité. Il arrive qu’elles soient stigmatisées, surtout si elles sautent d’emblée aux yeux, quand elles portent notamment sur le visage. Archive d’un moment heureux ou d’une ancienne indignité, d’une étourderie ou d’une agression extérieure, d’une blessure délibérée, d’un moment de gloire… Souvent étiquetées ironiquement comme “belles”, elles sont perçues comme donnant un charme, une séduction, selon leur emplacement, leur apparence. Elles sont souvent alors discrètes, blanches, sans relief, n’altérant guère l’apparence du corps. D’autres sont intolérables à la vue, la sienne ou celle des autres, et imposent des artifices comme le maquillage, le tatouage, le recours à des cosmétiques ou le fait de porter des vêtements qui les recouvrent : des manches longues, des écharpes, des pantalons plutôt que des jupes, etc. Selon leur histoire et leur localisation, elles participent ou non du sentiment d’identité.
Si le regard porté sur soi est la première source de sens, alors il s’enracine d’abord sur le regard des autres sur soi. La relation amoureuse par exemple érotise parfois une cicatrice et efface alors les connotations pénibles qu’elle revêtait peut-être. Mais elle peut être aussi source d’une difficulté, opposer au désir l’objection d’un corps perçu comme abîmé et indigne. Si elle est une encoche de mémoire sur la peau, elle n’est pas immuable. Elle cristallise du sens qui change au fil du temps, des circonstances, des regards portés sur soi, elle n’est jamais figée dans l’éternité, elle n’est qu’une question d’interprétation, de jugement. Toute relation intime au corps de soi ou de l’autre est une fiction, une histoire que l’on se raconte. Si les cicatrices sont toujours des empreintes du passé, Kassner, le personnage de Malraux dans Le Temps du mépris, entend en faire une trace venue du futur. Refusant que le monde ne se plie pas à sa volonté, il se trace au couteau dans la paume de la main une autre ligne de vie. La peau est toujours une surface de projection de l’affectivité.
Dans un court roman de Yôko Ogawa (1999), un étrange taxidermiste naturalise des objets auxquels les clients sont particulièrement attachés. Rangés dans des tubes, répertoriés, classés, leurs propriétaires s’en dessaisissent en sachant que, recueillis dans ces cryptes, ils ne disparaîtront jamais. Une assistante accueille les clients venus apporter des ossements d’oiseaux, des champignons microscopiques, une mélodie… Un jour, une jeune femme exprime son désir de naturaliser une discrète cicatrice de brûlure sur sa joue. Elle disparaît dans l’atelier du taxidermiste, suscitant la jalousie de l’assistante qui, dès lors, décide de naturaliser une blessure née de l’amputation ancienne de son annulaire, sachant qu’elle n’en reviendra pas. Enlever une cicatrice n’est pas toujours pensable sans retrancher une part de son histoire ou sans s’effacer soi-même. Appartenant au corps, elle est l’un des éléments de la personne. Si une fée proposait à maints sujets de les leur enlever, la plupart se récuseraient, même celles qui ont été vécues longtemps douloureusement. Salomé porte la cicatrice d’une vaccination ayant suppuré : “Si un jour je me lève et qu’elle n’est plus là, confesse-t-elle, je me dirai : ‘Tant mieux’, mais je n’irai pas faire la démarche de l’enlever” (in Dall’Agnola, 2013, 60). Aucune gomme n’efface tout à fait une cicatrice, on la modifie, on la contourne, on l’esthétise, on la redéfinit, mais on ne l’enlève pas. Elle est incrustée dans la peau avec l’événement qui l’a provoquée. L’en soustraire est une tâche presque impossible malgré les avancées de la dermatologie. Des techniques existent mais presque toutes sont invasives, exigeant des soins répétés, un peu douloureux, à l’image de l’action du laser ou d’autres techniques comme la radiofréquence, et elles laissent des cicatrices secondaires. Il faut vivre avec elles pour le meilleur ou pour le pire. Ce n’est pas tant la trace cutanée que le sujet souhaite enlever, que la mémoire inscrite dans la peau d’un moment où il a affronté une aspérité de son existence, ses rémanences qui continuent à le hanter. Souvent un travail intérieur sur le sens cristallisé par la cicatrice, dans une psychothérapie par exemple, suffit à abandonner l’idée de ce recours.
Des anciennes pratiques corporelles revêtues socialement d’une connotation négative sont aujourd’hui valorisées comme des techniques heureuses de transformation de soi, des affirmations esthétiques parfois associées à une démarche thérapeutique. Le tatouage, le piercing, le burning, le cutting, le branding, les implants sous-cutanés, étaient, jusque dans les années 80, des formes de dissidences radicales dans nos sociétés occidentales, une rébellion morale contre les impératifs de présentation de soi, et les normes de genre. Aujourd’hui leur statut a profondément changé du fait de leur diffusion qui les transforme en ressources communes pour la fabrique de soi par l’ajout de signes cutanés valorisés, parfois dans la surenchère avec des formes peu usitées comme des piercings, des tatouages ou des scarifications sur le visage, la nuque, le cou, ou les mains qui suscitent une attention indiscrète. Agir sur la peau en y gravant une cicatrice délibérée autorise une action sur soi, sur la totalité du rapport au monde afin de glisser d’une dimension de soi à une autre. Dans un contexte de détresse personnelle, les blessures délibérées (scarifications, brûlures, excoriations, grattages, coups, etc.) ont le pouvoir paradoxal d’apaiser, de soigner, elles laissent souvent des cicatrices, et touchent surtout les jeunes générations en situation de souffrance (Le Breton, 2017).
Voici une poignée des thèmes abordés dans cet ouvrage sur les cicatrices qui ne surgit pas inopinément dans mon parcours. Outre l’anthropologie du corps, de manière plus spécifique la blessure est un fil rouge de mes recherches depuis des années, je l’ai croisée dans mon travail sur le visage (2022), sur la douleur (2010 ; 2014 ; 2016) et la torture (2010) ; sur les conduites à risque des adolescents (2007 ; 2013) et, bien entendu, sur les scarifications des adolescents (2017) ou celles des artistes du body art, sur les cicatrices ouvragées à visée esthétique (2015). L’interrogation du statut anthropologique de la peau sous différents angles est aussi au cœur de mon travail (2006 ; 2017). Les cicatrices m’accompagnent depuis toujours, même si j’ai mis du temps à les aborder de front. Mais depuis bien des années j’accumule du matériau, des lectures, des entretiens. J’ai tous les jours sous les yeux une cicatrice d’enfance au genou, mémoire incarnée d’un jeu avec des copains quand j’avais 7 ou 8 ans. Je cherchais une cachette dans un immense grenier, quand soudain j’ai entendu approcher celui qui me cherchait. J’ai plongé au sol sans voir une cloche de verre qui servait pour le jardinage. Elle s’est brisée et m’a coupé le genou, suscitant, je m’en souviens encore, la visite chez un médecin qui a recousu la plaie. L’enfance laisse ses traces sur la peau. On regrette finalement d’en avoir si peu.









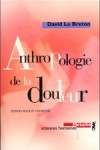





-100x150.jpg)
-100x150.jpg)



 (s)-100x150.jpg)



