Il est difficile de se construire à seize ans, on en meurt parfois.
Laure et Olivier sont partis sur la route, en stop, pour échapper à la violence de leur vie familiale, ils ont fui l’enfer. Max les a suivis mais lui, ses parents l’aiment, ce sont juste des parents ordinaires, une vie ordinaire. Jetés dans un monde ennemi, ils connaissent la misère des squats, la saleté, la promiscuité, et parfois ils rencontrent l’horreur, l’indicible.
Anna, elle, a fui la misère des Balkans. Thomas est un peu cassé par ses missions sur les théâtres de guerre, le hasard va le projeter violemment dans cet univers adolescent où la douleur permet de fuir la souffrance. Il découvre que des jeunes disparaissent, que des prédateurs sont à l’affût, et mène en solitaire une enquête dangereuse, dans cette ville de Strasbourg si belle et si cruelle.
David Le Breton écrit ici un roman noir passionnant et très documenté sur la douleur de grandir dans un monde hostile.
-
« L’histoire débute avec le parcours erratique de 3 jeunes, deux en couple déjà bien installé sur la route et Max, le petit nouveau qui vient de faire sa rupture avec ses parents qui le délaissent, et lui, désireux d’une cassure franche. Il n’ira pas très loin dans son périple, mort de froid une fois la nuit passée dans une pauvre cabane au bord de la route, après une tempête de neige. Voilà comment débute ce roman sur l’humanité d’en bas, l’infra- humanité, les sdf, ceux qui vivent en tas dans les squats et tous les salopards qui profitent de la misère de ce pauvre monde pour faire leurs affaires, vendre la chair fraîche à de grands pervers. Le héros du roman, universitaire strasbourgeois victime collatérale des dommages faits aux délaissés, va mener une enquête opiniâtre et solitaire.
Le récit tient de l’enquête journalistique et du roman ; du premier, il a le style neutre et sans affect, les références aux lourdes et sanglantes tragédies récentes : celles de l’ex-Yougoslavie et du Rwanda, avec les criminels de guerre reconvertis dans les trafics de corps. Et l’auteur a su décrire en termes volontaires et véhéments la lutte de ces corps meurtris, de ces visages défaits contre un destin noir tout tracé. Et l’accroche au roman surgit de cette ligne de partage entre fiction et documentaire. »Bernard DaguerreL’OURS POLAR -
« […] l'auteur, à qui l'on doit déjà de nombreux essais, nous donne ici un premier roman passionnant et très documenté sur la douleur de vivre dans un monde hostile. »
Robert QuiriconiASSOCIATED PRESS -
« David Le Breton, qui a publié de nombreux essais sur le rapport au corps, les conduites à risques ou l'errance chez les adolescents, nous propose un roman qui nous plonge dans le monde de la rue. Un univers aux marges de la société fait de violences, de crasse, de solitude, de promiscuité et de douleurs enfouies. C'est écrit avec finesse et élégance, y compris lorsque l'auteur décrit des scènes insoutenables. Le suspense, intense, est préservé de bout en bout. Un premier roman prometteur. »
Emmanuel RomerLA CROIX
1
Ils marchaient le long de la nationale, frigorifiés, se retournant et levant parfois le pouce quand une voiture s’approchait. Manifestement, personne ne souhaitait s’embarrasser de trois jeunes avec leurs sacs à dos. Ils cheminaient depuis des heures. Ils étaient partis en fin d’après-midi de Saint-Chély après avoir tenté de prendre le train, mais le chef de gare avait menacé d’appeler la police. Il les savait sans billets et tenait les squatters en horreur.
Ils allaient non loin de là, à une trentaine de kilomètres, à Marvejols. On était en février, il faisait froid mais quand ils s’étaient mis en marche le soleil de la fin de l’après midi rendait la température encore supportable. Peu à peu avec la tombée du soir le froid ne cessa d’augmenter. Ils étaient trop loin de la ville pour revenir, trop loin aussi de leur but. Pris au piège, ils continuèrent à avancer. Ensuite la neige fit son apparition. De petits flocons tout d’abord, et puis la tempête rendit leur progression difficile. Le vent cinglait leurs visages. La neige les transforma peu à peu en choses informes sur le bord de la nationale.
Max, dix-sept ans, était sur les routes depuis quelques heures seulement. Son père, médecin, n’était jamais là. Sa mère enseignait la physique dans une université à une centaine de kilomètres de leur maison. Pour ses parents il était une sorte de Martien. Ils lui donnaient le vivre et le couvert, l’associaient aux fêtes de famille les rares fois où il y en avait. Le reste du temps il disposait de la clé de
la maison et du frigidaire pour se débrouiller. Il ne manquait de rien, comme lui avait dit une fois sa mère qui lui trouvait l’air un peu triste et le rabrouait à ce propos.
– On t’a toujours tout donné.
Ce jour-là il eut envie de lui répondre que ce n’était pas cela qu’il attendait, mais il s’était arrêté ne sachant pas vraiment ce qu’il attendait d’eux. Il savait seulement que quelque chose n’allait pas. Dans sa rue à Aurillac, un squat s’ouvrit en dépit de l’hostilité des voisins. Il trouva auprès des jeunes qui allaient et venaient un remède à sa solitude. Il pensait parfois avoir rencontré là sa seconde famille, ou sa première. Tout dépendait de la manière dont on prenait les choses.
Il aimait entendre les récits de voyage des uns et des autres, il en rêvait la nuit. Il s’imaginait comme un nouveau Rimbaud allant de ville en ville son baluchon sur le dos. Il se lia avec Laure et Olivier, qui l’accompagnaient sur les routes enneigées de la Lozère. Il s’émerveilla de les voir si libres, sans attaches, pourtant ensemble. Il décida ce jour-là de franchir le pas avec eux et de partir à l’aventure. Son père ne découvrirait sans doute pas son départ avant deux ou trois jours. Mais il ne serait guère inquiet.
Sa mère était partie pour un colloque à Montréal, elle devait y passer une bonne semaine. Il était convaincu que sa disparition ne les tracasserait pas beaucoup. Quant à lui, ses parents ne lui manquaient pas du tout. Pour la première fois il avait des amis et existait à leurs yeux. Il entrait dans la vraie vie.
La neige continuait à tomber. Il devait faire plusieurs degrés en dessous de zéro. Max sentait sa résistance faiblir peu à peu. Son pull et sa veste n’étaient guère appropriés à une longue marche dans ces conditions. Il grelottait tout en s’efforçant de tenir le coup. C’était ses premières heures de liberté, il ne voulait pas les gâcher, mais il avait du mal à ne pas se laisser entamer.
Olivier portait un vieux manteau de l’armée oublié par son ancien propriétaire et récupéré dans un squat de Valenciennes. Laure avait enfilé deux pulls l’un sur l’autre, et un large foulard s’enroulait plusieurs fois autour de son cou et de son visage. L’un et l’autre vivaient à la dure depuis des années et s’étaient peu à peu adaptés.
Une voiture passa en klaxonnant. Dans le paysage brouillé de neige, les trois adolescents n’étaient visibles qu’au dernier moment. Silhouettes fantomatiques, inattendues, engourdies par le froid, ils se mêlaient à la blancheur et ne se découvraient qu’à quelques dizaines de mètres. Ils n’avaient pas conscience du danger.
Max essayait de chasser de son esprit le souvenir de sa chambre quittée quelques heures auparavant. Au moins là il n’avait pas froid, même s’il s’y sentait seul. Il commençait à se demander quel est le pire du froid ou de la solitude. Mais il ne voulait pour rien au monde flancher après si peu de temps et devenir la risée de ses compagnons de route. Il pensa à ses CD, des chansons de bossa-nova. Il avait dû laisser ses enregistrements de Vinícius de Moraes et de Tom Jobim. Il sentait les larmes lui monter aux yeux. Il commençait à se demander s’il avait bien fait.
Ou alors il fallait partir en été. En été il ne fait pas aussi froid. Il repoussa l’idée avec horreur. Il n’était quand même pas un touriste !
Il se sentait gelé jusqu’aux os et se demandait comment il pouvait encore marcher. Il avait lu un jour un livre écrit par un alpiniste qui faillit mourir de froid sur l’un des sommets de l’Himalaya. Le type décrivait le froid qui montait en lui comme un engourdissement bienheureux. Il s’était arrêté, adossé à un rocher, et attendait la mort avec tranquillité comme s’il entrait dans le sommeil. Une autre expédition le découvrit. On le secoua, on lui hurla de se réveiller. Peu à peu, il revint à lui. Mais au départ il ne voulait pas sortir de son engourdissement tant il se sentait bien. Les autres durent le harceler pour l’arracher à sa léthargie. Depuis l’homme n’avait plus jamais eu peur de la mort. Il la décrivait comme maternelle. L’image fascina longtemps Max car il la comprenait mal.
Mais maintenant, alors qu’il tremblait de tous ses membres, il se demandait comment le type avait pu imaginer que le froid était si doux. Il lui semblait quant à lui que des milliers d’aiguilles de glace le pénétraient.
La nuit enveloppait l’espace, composant avec la neige un paysage de rêve. Une voiture passa en trombe en les rasant de près. Le chauffeur excédé klaxonna un moment manifestement en colère sans penser qu’il aurait pu les prendre. Olivier lui fit un bras d’honneur.
Peu à peu les voitures se firent rares. Et elles disparurent. La neige tombait sans relâche et leurs pieds s’enfonçaient à chaque pas. Ils n’avaient pas d’autre choix que de continuer à avancer en espérant arriver à Marvejols au plus vite.
A un croisement, un panneau indicateur signalait la ville à vingt kilomètres. Olivier et Laure se regardèrent, inquiets. C’était vraiment trop loin, inaccessible dans ces conditions.
Max n’avait rien vu et avançait comme un automate dont on a oublié d’enlever la pile. Là-bas, il y avait le paradis, un squat dont on leur avait parlé à Aurillac. En fait ils n’en avaient même pas l’adresse. Ils étaient partis sans penser qu’ils mettraient autant de temps, et ils s’attendaient à trouver des copains dans les parages des cafés du centre-ville pour leur dire où s’installer. Ils ne croyaient pas que la météo se détériorerait à ce point. Il devait être aux environs de minuit. Le temps d’arriver, tous les copains seraient endormis et les cafés fermés.
S’ils continuaient à marcher, ils iraient dans la salle d’attente de la gare si elle était ouverte. Mais ce n’était pas sûr. Au pire, ils dormiraient dans un hall d’immeuble. Mais il fallait arriver là-bas. Leurs corps devenaient de plus en plus lourds. Les chaussures de Laure prenaient l’eau et elle avait les pieds glacés. Max continuait à avancer avec vaillance mais il se sentait de plus en plus exsangue. Il avait l’impression de marcher à côté de lui tant son esprit commençait à flotter.
Un bruit de moteur se fit entendre, mais la voiture allait à l’opposé et ils ne bougèrent même pas. Ce qui n’empêcha pas le conducteur de klaxonner lui aussi dans la nuit avec un temps de retard.
– Salaud ! hurla Laure, les larmes aux yeux.
– J’en ai marre, j’en peux plus, dit Olivier.
Max ne disait rien. Son visage devenait de marbre. Il n’arrivait plus à le bouger. Ses joues le brûlaient. En se retournant vers Laure et Olivier, il aperçut une cabane en contrebas de la route, près d’un bois. Il la désigna à Olivier, incapable d’émettre le moindre son. Laure se retourna à son tour. C’était leur chance, ils allaient pouvoir s’abriter et se réchauffer un peu.
– On y va, dit-elle.
– On pourra y passer la nuit. On n’arrivera jamais à Marvejols ce soir avec la neige, dit Olivier.
Ils glissèrent sur la pente neigeuse. La cabane, sans doute abandonnée depuis des années, avait dû servir de rangement à un paysan du coin ou à un berger. La fenêtre était presque opaque à cause des toiles d’araignée et de la poussière, les planches vermoulues. La cabane était délabrée, mais elle tenait encore et les protégerait du froid.
Olivier tira sur la porte dont le bois se brisa aussitôt. En tâtonnant il sortit un briquet de sa poche. La flamme révéla une pièce minuscule, des outils entassés çà et là. Sur une table branlante et couverte de poussière reposait une bouteille de bière vide. Olivier la heurta et elle roula sur le sol sans se briser. La table s’effondra en morceaux. Il les ramassa et les jeta dehors pour faire de la place.
De nombreux sacs de chanvre vides s’entassaient dans un angle du mur. Max s’y précipita en soulevant des années de poussière, mais cela n’avait guère d’importance au regard du froid qu’il ressentait. Il s’enfouit dans le tas en grelottant. C’était pour lui à ce moment une image du paradis. Mais il avait l’impression d’être encore sous la neige, et il se demandait s’il arriverait un jour à échapper à ce terrible sentiment. Il s’imaginait dans l’Himalaya gravissant un sommet, le Makalu par exemple. Un récit d’expédition là-bas l’avait ébloui. Il n’aurait jamais cru qu’on puisse avoir aussi froid et rester vivant.
Olivier allait et venait dans la minuscule cabane en faisant des mouvements pour se réchauffer. Il sortit pour pisser en se demandant si son urine allait geler. Un jour on lui avait raconté quelque chose comme ça. Mais il ne se passa rien. Il se dépêcha de rentrer. Max le suivait des yeux. Il en avait envie lui aussi depuis des heures, mais maintenant sa gêne disparaissait et il n’imaginait pas de retourner affronter la neige au-dehors.
Laure s’assit parterre. Elle ne se souvenait pas d’avoir connu un tel froid. Heureusement elle avait réussi à maintenir ses mains bien enroulées sous son pull, mais elles étaient glacées. Elle regardait Max qui semblait mal en point. Il n’était pas taillé pour le monde des squats. Petit, maigre, il ressemblait à un gamin de quinze ans. Il n’avait pas eu de chance pour son premier départ. Il n’avait pas de vrais conflits avec ses parents. Ils ne s’intéressaient pas à lui, c’était tout. Ils travaillaient l’un et l’autre et manquaient de temps. Laure aurait aimé connaître une telle situation. Elle ne serait pas dans cette cabane misérable. Mais personne ne vivait les choses de la même façon.
Demain elle inciterait Max à retourner chez lui. Il rêvait d’aventure, de liberté, de voyage. Il lui suffisait d’attendre, d’être plus âgé, plus aguerri. Bien sûr, ils avaient le même âge en apparence, mais il avait toujours été protégé. Il ne le savait pas. Il faudrait être diplomate pour qu’il ne prenne pas la mouche, car il était susceptible. Et son départ sur les routes était important pour lui. Depuis des semaines il leur rebattait les oreilles à ce propos.
Les flocons de neige voltigeaient de manière sinistre derrière la fenêtre. Le paysage paraissait celui d’un conte de fées, mais c’étaient des sorcières et un monde de cruauté qui se déployaient au-dehors.
La cabane ne leur épargnait pas le froid, mais elle les abritait de la neige. Elle leur donnait un répit. Ce soir-là Laure n’avait plus envie d’exister. Elle voulait s’endormir et que tout s’arrête. Elle n’avait aucun lieu où retourner, contrairement à Max qui ne connaissait pas sa chance. Au moins son père le respectait. Sa mère aussi. Elle se serait volontiers accommodée de l’absence de ses parents. Elle aurait lu, comme elle aimait tant le faire avant que son père ne détruise ce qu’elle était. Elle n’avait pas ouvert un livre depuis longtemps.
Elle glissait dans le sommeil malgré sa position inconfortable, la tête appuyée contre le mur, les jambes allongées sur la terre dure et inégale de la cabane. Elle n’en pouvait plus de ces errances sans fin, de ces squats sordides, de la promiscuité sexuelle qu’elle subissait parfois, même si elle essayait de ne pas montrer son dégoût.
Soudain il n’y eut plus rien. Elle dormait.
Dans son rêve Laure était dans un jardin, elle regardait terrifiée son jeune frère qui courait sur la margelle d’un puits, elle voulait s’élancer vers lui, lui crier d’arrêter. Elle se réveilla en gémissant et essaya de reprendre ses esprits. Elle ouvrit les yeux. Et apercevoir dans la pénombre le corps étendu d’Olivier et, enfoui sous ses sacs, celui de Max, lui glaça à nouveau les os. Que faisaient-ils ici, le corps meurtri, harcelés par le froid ? Elle n’était nulle part à sa place. Elle resta un moment à scruter l’obscurité sans pouvoir se rendormir. Soudain elle sursauta, une branche venait de se briser à l’extérieur. Elle entendit un bruit de pas.
Quelqu’un marchait derrière les planches de la cabane. Elle restait aux aguets en essayant de dégager du crissement de la neige les sons minimes qu’elle avait entendus. Quelqu’un était-il au-dehors ? Avec quelle intention ? La peur montait en elle. Les yeux braqués sur la fenêtre, elle voyait seulement le magma blanc de la neige.
Elle n’entendait plus rien. Peut-être avait-elle rêvé ? Elle avait moins froid. Avant de se coucher, elle s’était enveloppée, comme Olivier, de sacs de chanvre abandonnés sur le sol, indifférente à leur saleté. Elle frissonna en repensant à leur marche infernale.
Elle allait se rendormir quand elle entendit à nouveau un bruit de pas. Quelqu’un tournait autour de la cabane. Olivier dormait la tête sur son sac à dos. Elle hésitait à le réveiller.
Les minutes passèrent. Un craquement la fit sursauter. Il n’y avait plus de doute. Quelqu’un rôdait autour de la cabane. Olivier bougea près d’elle, il se réveillait. Il soupira et se leva pour aller pisser.
– Je crois qu’il y a quelqu’un dehors, chuchota Laure.
Olivier la regarda. Il s’approcha de la fenêtre.
– Je vais voir. De toute façon il faut que je sorte.
Il ouvrit doucement la porte. Laure entrevit les flocons. La neige continuait à tomber, cela ne présageait rien de bon pour le lendemain s’il fallait reprendre la route.
Olivier regardait dehors sans rien voir de suspect. Il crut entendre du bruit sur sa gauche, mais il ne vit rien. Il se soulagea et rentra.
– J’ai rien vu, t’as dû rêver. Il fait sacrément froid dehors. Demain ça va pas être facile.
Il se pelotonna sur le sol et s’endormit aussitôt. Laure resta encore un moment éveillée, mais la fatigue l’emporta.
Un autre bruit de pas l’arracha encore au sommeil. Maintenant l’inquiétude la tenaillait. Quelqu’un se déplaçait doucement près de la cabane et voulait sans doute entrer, mais ses intentions étaient douteuses puisqu’il rôdait, indécis sur sa conduite. Il les avait peut-être observés par la fenêtre. La cabane était sombre, mais on ne sait jamais. Peut-être cette personne les avait-elle vus se diriger en contrebas de la route tout à l’heure. Laure se perdait en raisonnements aussi tortueux les uns que les autres. Elle voyait la forme sombre de Max profondément endormi. Et celle d’Olivier qui bougeait dans son sommeil.
Elle se leva doucement. Elle voulait en avoir le cœur net. La seule manière de supprimer la peur était de l’affronter. Malgré sa terreur, elle ne supportait plus d’attendre. Elle avait trop l’impression d’être un insecte dans une toile d’araignée. Elle secoua Olivier.
– Il y a quelqu’un dehors, chuchota-t-elle.
– Hein, mais qui ? Qu’est-ce que tu racontes, comment tu sais ça ? J’ai vu personne.
– J’ai entendu du bruit, et ce n’était ni le vent ni les arbres. Plusieurs fois j’ai entendu des branches craquer comme si quelqu’un marchait autour de la cabane.
La peur le gagna à son tour. Il se leva et scruta la fenêtre sans y voir autre chose que la blancheur de la neige qui tombait toujours.
– Écoute, j’en peux plus. J’aime mieux aller voir.
– T’es dingue ! Si c’est un cinglé !
– On va pas passer toute la nuit comme ça, j’aime mieux savoir tout de suite. Je vais ouvrir la porte et regarder. Après tout c’est peut-être un type comme nous qui a froid et qui n’ose pas rentrer.
– Tu dis n’importe quoi. Le mec serait forcément rentré, il est pas idiot !
Mais elle s’était déjà levée et entrebâillait la porte. Une bouffée d’air froid pénétra la cabane. Laure se demandait si elle n’avait pas rêvé. Plus elle y pensait, moins elle comprenait l’attitude de ce type rôdant dans le froid sans chercher à entrer. Sauf s’il voulait délibérément les terrifier ou s’il poursuivait d’autres objectifs, mais lesquels ?
Elle ouvrit la porte. Il neigeait toujours. Elle respira fort comme si elle était encore sur les hauts rochers d’où elle plongeait enfant lors d’un séjour en Bretagne. Elle ne vit rien. Elle se demandait quelle heure il pouvait être. Le froid était toujours aussi piquant. Elle avança encore et entreprit de tourner autour de la cabane prête à crier en cas de danger, mais sans illusion sur l’aide que lui apporteraient Max ou Olivier. Elle sentit son cœur battre à toute allure. La neige crissait sous ses pieds.
Elle sursauta et crut mourir. Un bruit de pas se faisait entendre devant elle mais elle ne voyait rien. Un écran de neige dissipait le contour des choses. Elle était pétrifiée, incapable de se défendre. Les pas se rapprochaient. Un cri montait dans sa gorge sans en sortir comme s’il avait gelé en elle. Cela ressemblait tellement à ses rêves qu’elle crut un instant être encore endormie.
Et soudain, du flou de la blancheur surgit une forme vague de plus en plus massive et réelle. Un cerf venait vers elle comme porté par la grâce. Elle tendit la main vers l’animal qui n’avait pas fui en la voyant. Elle sentait la chaleur de son haleine. Ils se regardèrent un moment comme s’il y avait un lien secret entre eux, ou une révélation mutuelle à se faire. Quelque chose qui échappait à tous les mots, pensa Laure.
Le cerf resta ainsi un moment avant de s’éloigner à pas lents et de se perdre dans l’obscurité, effrayé sans doute par la voix d’Olivier remuant soudain la nuit. Elle ne put retenir des larmes qui gelèrent aussitôt sur son visage.
– Laure ! Laure ! Qu’est-ce qui se passe bon Dieu ?
Il ne voyait rien, mais le bruit de pas l’avait surpris. Il était terrifié à son tour et n’osait pas bouger.
Laure resta un moment à contempler l’endroit où le cerf avait disparu. Elle cherchait à faire durer l’instant, mais elle entendit la voix angoissée d’Olivier et elle se dirigea tristement vers la cabane en pensant qu’elle garderait comme un trésor cette image du cerf surgissant du brouillard et venant vers elle sans peur.
Max continuait à dormir. Il n’avait rien entendu.
Olivier se réveilla mal en point, endolori. Il regarda Laure toujours endormie. Il se demandait ce qu’elle avait vu dehors pendant la nuit, elle n’avait rien dit et s’était recouchée en silence. Il avait entendu un bruit de fuite, mais qui cela pouvait-il être ? Il se redressa avec peine et s’étira en essayant de ne pas faire de bruit. Max dormait pelotonné dans ses sacs, on ne lui voyait que la tête. Sa bouche ouverte lui donnait l’aspect d’un nourrisson.
Il sortit. La neige avait tenu. Il faisait moins froid. Le vent était tombé. Le paysage était paisible. Tout était blanc autour de lui.
Il alla pisser contre un arbre et entreprit de se nettoyer les mains et le visage avec la neige. Cela faisait un moment qu’il ne s’était pas lavé le reste du corps. L’été avait cet avantage que l’on pouvait se baigner presque partout, mais à l’automne la chance était rare de trouver des douches et suffisamment d’intimité dans les rares squats où il y en avait.
Il songea aux foyers d’accueil dont des squatters lui avaient parlé : un lit à soi, un vrai petit-déjeuner, des repas à heures fixes, des douches, le bonheur. Mais il ne réussissait pas à convaincre Laure. Pourtant Dieu sait si elle en bavait certaines fois. Il n’était pas de taille à la défendre même s’il ne l’imaginait pas sans lui.
Qu’est-ce qu’elle avait vu dans la nuit ? C’était un mystère. Parfois elle restait longtemps silencieuse. Il n’était pas sûr qu’elle le lui dirait ce matin.
Quand il rentra Laure était assise, elle se frottait les yeux. Elle sourit à Olivier et sortit à son tour pour pisser et faire sa toilette dans la neige. Elle aimait la sensation de fraîcheur sur ses cuisses ou sur son visage. Elle aurait aimé se rouler nue dans la neige. Elle l’avait fait une fois et elle savait que l’idée, si elle était belle dans l’imagination, tenait plus difficilement dans la réalité. Elle ôtait ses vêtements un à un pour se nettoyer. Elle le savait depuis toujours, il fallait se contenter de ce qui était là et pouvait de toute façon lui être arraché le jour même.
Elle regardait les lieux où avait disparu le cerf pendant la nuit. Elle le revoyait avec son pelage fumant, son regard sur elle. Il n’avait pas eu l’air étonné de la voir. On aurait dit qu’il était venu pour elle. Et il n’avait pas eu peur. Il était comme le visiteur de la chance. Elle se souviendrait de lui les jours de grisaille. Et justement la plupart avaient cette couleur.
– Max a toujours l’air de dormir, dit Olivier quand elle revint à la cabane.
Ils sortirent leurs maigres provisions. Une banane, une orange, un paquet de galettes bretonnes, un reste de jambon.
Laure regarda Max. Il n’avait pas bougé depuis tout à l’heure avec sa bouche curieusement ouverte. Il donnait l’impression d’être plus fragile encore que la veille lors de leur marche dans la tourmente. Elle allait ce matin essayer de le convaincre que leur existence de routards n’était guère enviable. Ils vivaient bien plus de moments durs que de moments heureux. Hier soir il avait vécu l’enfer, elle en était sûre.
– Qu’est-ce qui s’est passé cette nuit ?
– C’était un cerf. J’ai vu un cerf.
– Un cerf ?
Il ne savait plus quoi dire. Il se souvenait de son attitude peu courageuse. Il se sentit ridicule.
– Bon, on va manger ce qu’on a. J’ai encore au moins trois euros dans ma poche, on achètera des trucs en arrivant à Marvejols.
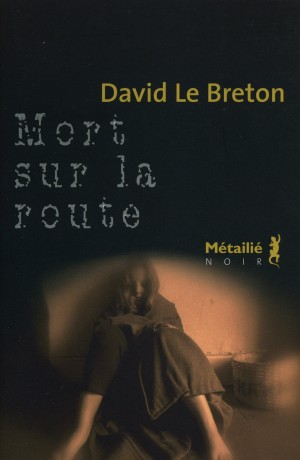







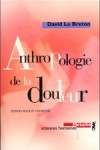





-100x150.jpg)
-100x150.jpg)



 (s)-100x150.jpg)



