» Il y a la forêt du flâneur, du fugitif, celle de l’indien, la forêt du chasseur, du garde-chasse ou du braconnier, celle des amoureux, des ornithologues, la forêt aussi des animaux ou de l’arbre, celle du jour et de la nuit. Mille forêts dans la même, mille vérités d’un même mystère qui se dérobe et ne se donne jamais qu’en fragments. » Tout comme il y a un paysage, un son, une saveur, un parfum, un contact, une caresse, pour déplier le sentiment de la présence et aviver une conscience de soi. David Le Breton explore les sens, tous nos sens, comme pensée du monde. Cette fois l’anthropologue se laisse immerger dans le monde afin d’être dedans et non devant. Il nous montre que l’individu ne prend conscience de soi qu’à travers le sentir, qu’il éprouve son existence par des résonances sensorielles et perceptives. Ainsi tout homme chemine dans un univers sensoriel lié à ce que sa culture et son histoire personnelle ont fait de son éducation, chaque société dessinant une » organisation sensorielle » qui lui est propre.
Percevoir les couleurs est un apprentissage autant que d’entendre ou de voir. Toucher, palper, sentir dans l’étreinte ou la souffrance, c’est faire affleurer la peau et la pensée dans la concrétude des choses, c’est aussi se sentir, goûter et parfois même être dégoûté. L’auteur se fait explorateur des sens et n’omet rien de nos attirances et de nos rejets. Proposant que l’on réfléchisse désormais au » Je sens donc je suis « , il rappelle que la condition humaine avant d’être spirituelle est bel et bien corporelle.
-
« L'intimité avec le monde n'appartient qu'au corps. C'est tout le sens de cette anthropologie des sens : le monde, il faut le goûter, déguster, manger, avant qu'il ne nous avale. »Jean-Baptiste MarongiuLIBERATION
Introduction
Anthropologie des sens
Pour l’homme, il n’y a pas d’autres moyens que d’éprouver le monde, d’être traversé et changé en permanence par lui. Le monde est l’émanation d’un corps qui le pénètre. Un va-et-vient s’instaure entre sensation des choses et sensation de soi. Avant la pensée, il y a les sens. Dire avec Descartes « Je pense donc je suis, c’est omettre l’immersion sensorielle de l’homme au sein du monde. « Je sens donc je suis, est une autre manière de poser que la condition humaine n’est pas toute spirituelle, mais d’abord corporelle. L’anthropologie des sens implique de se laisser immerger dans le monde, d’être dedans, non devant, et sans se départir d’une sensualité venant alimenter l’écriture et l’analyse. Le corps est foisonnement du sensible. Il est inclus dans le mouvement des choses et se mêle à elles de tous ses sens. Entre la chair de l’homme et la chair du monde, nulle rupture, mais une continuité sensorielle toujours présente. L’individu ne prend conscience de soi qu’à travers le sentir, il éprouve son existence par les résonances sensorielles et perceptives qui ne cessent de le traverser.
L’entame brève de la sensation brise la routine du sentiment de soi. Les sens sont une matière à faire du sens, sur le fond inépuisable d’un monde qui ne cesse de s’écouler, ils font des concrétions qui le rendent intelligible. On s’arrête sur une sensation qui fait plus sens que les autres et ouvre les arcanes du souvenir ou du présent, mais une infinité de stimulations nous traversent à tout instant et glissent dans l’indifférence. Un son, une saveur, un visage, un paysage, un parfum, un contact corporel déplient le sentiment de la présence et avivent une conscience de soi un peu en sommeil au long du jour, à moins d’être sans cesse attentif aux données de l’environnement. Le monde où nous nous déployons existe à travers la chair qui va à sa rencontre.
La perception n’est pas coïncidence avec les choses, mais interprétation. Tout homme chemine dans un univers sensoriel lié à ce que son histoire personnelle a fait de son éducation. Parcourant la même forêt, des individus différents ne sont pas sensibles aux mêmes données. Il y a la forêt du chercheur de champignons, du flâneur, du fugitif, celle de l’Indien, la forêt du chasseur, du garde-chasse ou du braconnier, celle des amoureux, des égarés, des ornithologues, la forêt aussi des animaux ou de l’arbre, celle du jour et de la nuit. Mille forêts dans la même, mille vérités d’un même mystère qui se dérobe et ne se donne jamais qu’en fragments. Il n’y a pas de vérité de la forêt, mais une multitude de perceptions à son propos selon les angles d’approche, les attentes, les appartenances sociales et culturelles.
L’anthropologue est l’explorateur de ces différentes couches de réalité qui s’enchevêtrent. Lui aussi finalement propose son interprétation de la forêt, mais il s’efforce d’élargir son regard, ses sens, pour comprendre ce feuilletage de réels. A la différence des autres, il n’en méconnaît pas le mi-dire. Mais son travail consiste
en l’arpentage de ces différentes sédimentations. Il sait, en se souvenant d’André Breton, que le monde est une « forêt d’indices où se dissimule un réel dont la quête l’alimente. Le chercheur est l’homme du labyrinthe en quête d’un improbable centre. L’expérience sensible tient d’abord aux significations avec lesquelles le monde est vécu, car ce dernier ne se donne pas sous d’autres auspices. Dès lors que les hommes considèrent les choses comme réelles, elles sont réelles dans leurs conséquences, disait W. Thomas.
Nos perceptions sensorielles, enchevêtrées à des significations, dessinent les limites fluctuantes de l’environnement où nous vivons, elles en disent l’étendue et la saveur. Le monde de l’homme est un monde de la chair, une construction née de sa sensorialité passée au crible de sa condition sociale et culturelle, de son histoire personnelle, de son attention à son milieu. Érigé entre ciel et terre, souche identitaire, le corps est le filtre par lequel l’homme s’approprie la substance du monde et la fait sienne par l’intermédiaire des systèmes symboliques qu’il partage avec les membres de sa communauté (Le Breton, 1990, 2004). Le corps est la condition humaine du monde, ce lieu où le flux incessant des choses s’arrête en significations précises ou en ambiances, se métamorphose en images, en sons, en odeurs,
en textures, en couleurs, en paysages, etc. L’homme participe au lien social non seulement par sa sagacité et ses paroles, ses entreprises, mais aussi par une série de gestes, de mimiques qui concourent à la communication, par l’immersion au sein des innombrables rituels qui scandent l’écoulement du quotidien. Toutes les actions qui forment la trame de l’existence, même les plus imperceptibles, engagent l’interface du corps. Le corps n’est pas un artefact logeant un homme devant mener son existence en dépit de cet obstacle. A l’inverse, toujours en relation d’étreinte avec le monde, il en trace le chemin et rend hospitalier son accueil. « Ainsi, ce que nous découvrons en dépassant le préjugé du monde objectif, ce n’est pas un monde intérieur ténébreux (Merleau-Ponty, 1945, 71). C’est un monde de significations et de valeurs, un monde de connivence et de communication entre les hommes en présence et leur milieu.
Chaque société dessine ainsi une « organisation sensorielle propre (Ong, 1971, 11). Face à l’infinité des sensations possibles à tout instant, une société définit des manières particulières d’établir des sélections en posant entre elle et le monde le tamisage de significations, de valeurs, procurant à chacun les orientations pour exister dans le monde et communiquer avec son entourage. Ce qui ne signifie pas que les différences ne démarquent pas les individus entre eux, même à l’intérieur d’un groupe social de même statut. Les significations qui s’attachent aux perceptions sont empreintes de subjectivité: trouver un café sucré ou l’eau de la baignade plutôt froide, par exemple, suscite parfois un débat qui montre que les sensibilités des uns et des autres ne sont pas exactement homologables sans nuances, même si la culture est partagée par les acteurs.
L’anthropologie des sens repose sur l’idée que les perceptions sensorielles ne relèvent pas seulement d’une physiologie mais d’abord d’une orientation culturelle laissant une marge à la sensibilité individuelle. Les perceptions sensorielles forment un prisme de significations sur le monde, elles sont modelées par l’éducation et mises en jeu selon l’histoire personnelle. Dans une même communauté, elles varient d’un individu à l’autre, mais elles s’accordent à peu près sur l’essentiel. Au-delà des significations personnelles insérées dans une appartenance sociale se dégagent des significations plus larges, des logiques d’humanité (des anthropologiques) qui réunissent des hommes de sociétés différentes dans leur sensibilité au monde. L’anthropologie des sens est l’une des innombrables voies de l’anthropologie, elle évoque les relations que les hommes des multiples sociétés humaines entretiennent avec le fait de voir, de sentir, de toucher, d’entendre ou de goûter1. Même si la carte n’est pas le territoire où vivent les hommes, elle renseigne sur eux, rappelle les lignes de force et dresse un miroir déformé qui incite le lecteur à mieux voir ce qui l’éloigne et le rapproche de l’autre, et ainsi de détour en détour lui enseigne à mieux se connaître.
Le monde n’est pas le décor où se déroulent ses actions, mais leur milieu d’évidence, nous sommes immergés dans un environnement qui n’est rien d’autre que ce que nous percevons. Les perceptions sensorielles sont d’abord la projection de significations sur le monde. Elles sont toujours une pesée, une opération délimitant des frontières, une pensée en acte sur le flux sensoriel ininterrompu qui baigne l’homme. Les sens ne sont pas « fenêtres sur le monde, « miroirs offerts à l’enregistrement des choses en toute indifférence aux cultures ou aux sensibilités, ce sont des filtres qui ne retiennent dans leur tamis que ce que l’individu a appris à y mettre ou ce qu’il cherche justement à identifier en mobilisant ses ressources. Les choses n’existent pas en soi, elles sont toujours investies d’un regard, d’une valeur qui les rend dignes d’être perçues. La configuration et la limite de déploiement des sens appartiennent au tracé de la symbolique sociale.
Éprouver le monde, ce n’est pas être avec lui dans une relation erronée ou juste, c’est le percevoir avec son style propre au sein d’une expérience culturelle. « La chose ne peut jamais être séparée de quelqu’un qui la perçoit, elle ne peut jamais être effectivement en soi parce que ses articulations sont celles mêmes de notre existence et qu’elle se pose au bout d’un regard ou au terme d’une exploration sensorielle qui l’investit d’humanité. Dans cette mesure, toute perception est une communication ou une communion, la reprise ou l’achèvement par nous d’une intention étrangère ou, inversement, l’accomplissement au-dehors de nos puissances perceptives et comme un accouplement de notre corps avec les choses (Merleau-Ponty, 1945, 370). Les activités perceptives, à chaque instant, décodent le monde environnant et le transforment en un tissu familier, cohérent, même s’il étonne parfois par des touches plus inattendues. L’homme voit, entend, sent, goûte, touche, éprouve la température ambiante, perçoit la rumeur intérieure de son corps, et ce faisant il fait du monde une mesure de son expérience, il le rend communicable aux autres, immergés comme lui au sein du même système de références sociales et culturelles.
L’usage courant de la notion de vision du monde pour désigner un système de représentation (encore une métaphore visuelle) ou un système symbolique propre à une société traduit l’hégémonie de la vue dans nos sociétés occidentales, sa valorisation, qui fait qu’il n’y a de monde que d’être vu. « Essentiellement, écrit W. Ong, quand l’homme technologique moderne pense à l’univers physique, il pense à quelque chose susceptible d’être visualisé, ou en termes de mesures et de chartes visuelles. L’univers est pour nous quelque chose dont on peut essentiellement dresser une image (Ong, 1969, 636). La vue exerce un ascendant sur les autres sens dans nos sociétés, elle est la première référence. Mais d’autres sociétés, plutôt que de « vision du monde, parleraient de « gustation, de « tactilité, « d’audition ou « d’olfaction du monde pour rendre compte de leur manière de penser ou de sentir leur relation aux autres et à l’environnement. Une culture détermine un champ de possibilité du visible et de l’invisible, du tactile et de l’intouchable, de l’olfactif et de l’inodore, de la saveur et de la fadeur, du pur et du souillé, etc. Elle dessine un univers sensoriel particulier, les mondes sensibles ne se recoupent pas car ils sont aussi des mondes de significations et de valeurs. Chaque société élabore ainsi un « modèle sensoriel (Classen, 1997) particularisé, bien entendu, par les appartenances de classe, de groupe, de génération, de sexe, et surtout l’histoire personnelle de chaque individu, sa sensibilité particulière. Venir au monde, c’est acquérir un style de vision, de toucher, d’écoute, de goût, d’olfaction, propre à sa communauté d’appartenance. Les hommes habitent des univers sensoriels différents.
La tradition chrétienne retient également la doctrine des sens spirituels formulée par Origène (Rahner, 1932), reprise par Grégoire de Nysse, évoquée par Augustin et développée par Bonaventure. Les sens spirituels sont associés à l’âme, ils s’inscrivent dans la métaphysique ouverte par une foi profonde amenant à percevoir avec des organes spirituels l’impression de la présence de Dieu dont la sensorialité profane ne saurait rendre compte. Les sens spirituels n’habitent pas en permanence le fidèle, ils interviennent parfois à travers des intuitions fulgurantes donnant accès à une réalité surnaturelle marquée par la présence de Dieu. Ils forment un sentir de l’âme propre à pénétrer des univers sans commune mesure avec la dimension corporelle
des autres sens. « Une vue pour contempler les objets supracorporels, comme c’est manifestement le cas pour les chérubins ou pour les séraphins; une ouïe capable de distinguer des voix qui ne retentissent pas dans l’air; un goût pour savourer le pain vivant descendu du ciel afin de donner la vie au monde (Jo. 6-33); de même un odorat, qui perçoit les réalités qui ont porté Paul à se dire une bonne odeur du Christ (2 Cor. 2-15); un toucher que possédait Jean lorsqu’il nous dit qu’il a palpé de ses mains le Verbe divin. Salomon savait déjà « qu’il y a en nous deux sortes de sens: l’un mortel, corruptible, humain; l’autre immortel, spirituel, divin (Rahner, 1932, 115).
De nombreux travaux, notamment outre-Atlantique, ont tenté d’approcher de manière précise et systématique cette profusion sensorielle afin de voir comment les sociétés lui donnent un sens particulier: Howes (1991, 2003, 2005), Classen (1993a, 1993b, 1998, 2005), Classen, Howes, Synnott (1994), Ong (1997), Stoller (1989, 1997), ou des historiens comme Corbin (1982, 1988, 1991, 1994), Dias (2004), Gutton (2000), Illich (2004), etc. La liste des recherches, ou de celles consacrées à un aspect particulier du rapport sensible au monde serait interminable. D. Howes en indique une direction: « L’anthropologie des sens cherche avant tout à déterminer comment la structuration de l’expérience sensorielle varie d’une culture à l’autre selon la signification et l’importance relative attachées à chacun des sens. Elle cherche aussi à retracer l’influence de ces variations sur les formes d’organisation sociale, les conceptions du moi et du cosmos, sur la régulation des émotions, et sur d’autres domaines d’expression corporelle (Howes, 1991, 4).
L’anthropologue déconstruit l’évidence sociale de ses propres sens et s’ouvre à d’autres cultures sensorielles, à d’autres manières de sentir le monde. L’expérience de l’ethnologue ou du voyageur est souvent celle du dépaysement de ses sens, il est confronté à des saveurs inattendues, à des odeurs, des musiques, des rythmes, des sons, des contacts, à des usages du regard qui bousculent ses anciennes routines et lui apprennent à sentir autrement sa relation au monde et aux autres. Les valeurs attribuées aux sens ne sont pas celles de sa société. « L’Afrique a d’abord assailli mes sens, dit P. Stoller qui évoque la nécessité de ce décentrement sensoriel pour accéder à la réalité vivante des manières de vivre songhay: « Le goût, l’odorat, l’écoute et la vue sont entrés dans un cadre nigérien. Maintenant je laisse les vues, les sons, les odeurs et les goûts du Niger me pénétrer. Cette loi fondamentale d’une épistémologie humble m’a appris que pour les Songhay, le goût, l’odorat et l’écoute sont souvent bien plus importants que la vue, le sens privilégié de l’Ouest (Stoller, 1989, 5).
L’expérience anthropologique est une manière de se déprendre des familiarités perceptives pour ressaisir d’autres modalités d’approche, sentir la multitude des mondes qui s’arc-boutent dans le monde. Alors, elle est un détour pour apprendre à voir, elle donne forme à « l’invu (Marion, 1992, 51) qui attendait une mise à jour. Elle invente sur un mode inédit le goûter, l’entendre, le toucher, le sentir. Elle casse les routines de pensée sur le monde, elle appelle au dépouillement des schèmes anciens d’intelligibilité afin d’ouvrir à un élargissement du regard. Elle est une invitation au grand large des sens et du sens, car sentir ne va jamais sans mise en jeu de significations. Elle est un rappel au plein vent du monde et de ce que toute socialisation est restriction de la sensorialité possible. L’anthropologie fait voler en éclats l’ordinaire des choses. « Celui qui choisit de savoir seulement aura gagné, bien sûr, l’unité de la synthèse et l’évidence de la simple raison; mais il perdra le réel de l’objet, dans la clôture symbolique du discours qui réinvente l’objet à sa propre image, ou plutôt à sa propre représentation. Celui, au contraire, qui désire voir ou plutôt regarder perdra l’unité d’un monde clos pour se retrouver dans l’ouverture inconfortable d’un univers désormais flottant, livré à tous les vents du sens (Didi-Huberman, 1990, 172).
J’ai esquissé ce travail il y a quinze ans, dans Anthropologie du corps et modernité (1990), en suggérant l’importance d’une anthropologie des sens et en analysant particulièrement la prégnance occidentale de la vue. J’ai porté ce livre tout ce temps, y travaillant sans relâche mais de manière tranquille, avec le sentiment d’avoir devant moi un océan à franchir. J’ai accumulé les matériaux, les enquêtes, les observations, les lectures, les voyages, en écrivant à chaque fois des lignes ou des pages. Une année parfois, dans les interstices du travail que je menais pour un autre ouvrage, j’essayai d’explorer de manière systématique un sens, puis un autre. Le temps passait, les pages s’ajoutaient les unes aux autres. Je publiais parfois un article spécifique autour des modalités culturelles de l’un ou l’autre sens.
Écrire autour d’une anthropologie des sens soulève en effet la question de l’écriture, quelle intrigue suivre d’un bout à l’autre? Comment trier parmi l’infinité des données pour donner chair à une telle intention sans perdre le lecteur dans la profusion et l’accumulation? J’ai parfois travaillé des semaines ou des mois sur des aspects sociaux des perceptions sensorielles que je n’ai finalement pas retenus dans l’ouvrage par manque de cohérence avec l’ensemble. J’ai souvent eu l’impression que l’essentiel du travail était d’élaguer, de devoir douloureusement supprimer maints chemins pour maintenir un cap, une cohérence d’écriture et de pensée. C’est pourquoi, quand j’y pense, il me semble avoir mis quinze ans à écrire cet ouvrage et à en surmonter un à un les repentirs pour m’autoriser finalement à le remettre à Anne-Marie Métailié qui l’attendait depuis le début des années 90. Je lui dois à nouveau une reconnaissance profonde de concevoir son métier comme un accompagnement du travail des auteurs à travers notamment la confiance qu’elle leur prodigue. Sans elle, je ne me serais peut-être pas lancé dans un projet aussi ambitieux. A nouveau, ma dette est aussi considérable envers Hnina qui a lu et relu les différents chapitres de l’ouvrage.











-100x150.jpg)
-100x150.jpg)



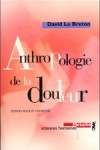



 (s)-100x150.jpg)



