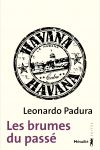Voici le quatrième et dernier volet des enquêtes du Cubain Mario Conde :
L’inspecteur Mario Conde, écœuré par la mise à la retraite de son chef, le Vieux, à la suite d’une enquête interne, décide de quitter la police pour se consacrer à l’écriture. Le nouveau commissaire exige qu’il mène une dernière enquête avant de partir. Mario Conde va essayer de comprendre pourquoi le premier de la classe, devenu cadre politique, puis exilé à Miami, a été assassiné et mutilé de façon barbare.
L’inspecteur Conde, obsédé par le cyclone qu’il suit sur les cartes météorologiques, mène sa dernière enquête, mais surtout s’interroge sur ce qu’est devenue sa génération, celle de l’auteur, ce que sont devenus ses idéaux.
Padura brosse un tableau magistral d’une Havane chaotique, séduisante, pleine de secrets, de trésors cachés et d’amours souvent malheureuses.
Ce roman a été couronné par le prix Hammett 1998 décerné par l’Association Internationale des Auteurs de romans policiers.
– Viens ici… ! hurla-t-il enfin en direction d’un ciel qui lui sembla langoureux et paisible, peint encore des couleurs de la trompeuse palette bleue du mois d’octobre: il hurla les bras en croix, la poitrine nue, expulsant sa réclamation désespérée de toute la force de ses poumons, pour que sa voix porte et aussi pour vérifier que sa voix existait encore, après trois jours sans un seul mot. Sa gorge, écorchée par les cigarettes et l’excès d’alcool, sentit enfin le soulagement de la renaissance, et son esprit savoura ce minuscule acte libertaire, capable de provoquer une effervescence intérieure qui manqua de lui faire pousser un second cri.
Depuis son toit, Mario Conde avait scruté le firmament nettoyé de vent et de nuages, comme la vigie d’un navire égaré, avec l’espoir malsain que du haut de son élévation il pourrait enfin voir, dans le dernier pli de l’horizon, cette agressive croix de Saint-André dont il avait suivi plusieurs jours durant le trajet sur les cartes météorologiques, tandis qu’elle se rapprochait du destin qui lui était assigné: la ville, le quartier et ce toit même d’où il l’appelait.
Au commencement, cela n’avait été qu’une entaille lointaine, une chose sans nom tout en bas de l’échelle des dépressions tropicales, qui s’éloignait des côtes africaines en entraînant des nuages chauds dans sa danse macabre; deux jours plus tard, elle accédait à la catégorie inquiétante de perturbation cyclonique, et était déjà une flèche empoisonnée au milieu de l’Atlantique, la proue dirigée vers la mer des Caraïbes, s’étant gagné par la force le droit à un nom de baptême : Félix; et voilà que la nuit dernière, gonflé jusqu’à s’être transformé en ouragan, Félix était apparu comme un tourbillon grotesquement incliné au-dessus de l’archipel de la Guadeloupe, fouetté par cette dévastatrice étreinte éolienne de deux cents kilomètres à l’heure, qui avançait prête à déraciner arbres et maisons, à bouleverser le cours historique des rivières et les altitudes millénaires des montagnes, à tuer des animaux et des personnes, comme une malédiction descendue d’un ciel, pourtant toujours langoureux et calme, comme une femme se préparant à l’adultère.
Mais Mario Conde savait qu’aucun de ces accidents et artifices n’altéreraient son destin et sa mission : depuis qu’il l’avait vu naître sur les cartes, il avait ressenti une étrange affinité avec ce monstrueux rejeton d’ouragan: ce salopard va venir ici, se dit-il tandis qu’il le voyait avancer et croître, parce que quelque chose dans l’atmosphère extérieure ou dans sa propre dépression intérieure – chargée de sinus, de nimbus, de stratus et de cumulus zébrés d’éclairs, mais incapables pourtant de se transformer en ouragan – l’avait averti des intentions et des besoins véritables de cette masse de pluies et de vents en folie que le destin comique avait créée dans le but évident de traverser précisément cette ville pour y effectuer une purification attendue et nécessaire.
Mais cet après-midi, écœuré à force de veille passive, le Conde opta pour l’appel verbal. Sans chemise, le pantalon à peine boutonné, porteur d’une charge éthylique qui mettait en combustion ses moteurs les plus cachés, il passa par la fenêtre pour monter sur le toit et y trouver cet après-midi d’automne, agréablement chaud, qui malgré tous ses désirs ne montrait pas le moindre signe d’activité cyclonique. Sous ce ciel trompeur le Conde, oubliant en un instant ses intentions, se mit alors à observer la topographie du quartier, hérissé d’antennes, de cages à oiseaux, de séchoirs à linge et de réservoirs d’eau, reflets d’un quotidien simple et rustique, auquel lui n’avait pourtant pas accès. Au sommet de l’unique colline du quartier, il trouva comme toujours la couronne de tuiles rouges de ce faux château anglais que son grand-père, Rufino el Conde, avait contribué à construire, près d’un siècle auparavant. Cet enracinement de certaines oeuvres, au-delà de la vie de leurs créateurs, cette capacité à résister aux ouragans, aux tempêtes, aux cyclones, aux typhons, aux tornades et même
tourmentes, lui sembla la seule raison valable d’exister. Et resterait-il de lui si à cet instant même il se lançait dans airs comme la colombe qu’il avait une fois imaginée?
L’oubli infini, dut-il s’avouer, un vide rampant, semblable celui de tous ces gens anodins qui allaient et venaient sur le
serpent noir de l’avenue, chargés de colis et d’espoirs, ou les mains vides et l’esprit rempli d’incertitudes, étrangers peut-être
à la proximité d’ouragans terribles et nécessaires, ces gens indifférents y compris au néant de la mort, sans volonté de mémoire
expectatives de futur, qu’il alerta par le cri désespéré qu’il lança en direction de l’horizon le plus lointain:
– Viens ici, merde!
Comme s’il le ressentait dans sa chair il imagina la douleur possible du bouchon en train d’être pénétré par l’implacable spirale de métal. Il l’enfonça jusqu’à la garde, avec la précision d’un chirurgien, bien décidé à ne pas louper son coup: reteint son souffle, il tira délicatement vers le haut, et le bouchon sortit tel un poisson cramponné à sa perdition. L’effluve alcoolisée qui s’échappa de la bouteille monta jusqu’à lui, catégorique et provocatrice, et sans aucun souci de la mesure, il versa bonne dose de liquide dans un verre, pour l’engloutir d’un
un seul coup, avec la fougue d’un cosaque poursuivi par les hurlements de l’hiver.
C’est alors qu’il l’observa avec angoisse: c’était la dernière
bouteille d’une réserve rassemblée à la hâte, trois jours plus tôt, quand le lieutenant enquêteur Mario Conde avait quitté
le commissariat central, après avoir signé sa demande de démission et avait décidé de s’enfermer pour se tuer à coup de rhum, de cigarettes, de chagrins et de rancœur. Il s’était toujours dit que le jour où son désir de quitter la police viendrait, il
ressentirait un soulagement capable de le faire chanter, danser, et bien entendu boire sans tristesses ni remords, car il ne ferait
que réaliser une volonté d’émancipation trop longtemps repoussée. Parvenu à ces profondeurs de sa vie, il se disait qu’il
n’avait jamais très bien su pourquoi il avait dit oui et était devenu flic, et qu’ensuite il n’aurait pas non plus su dire
pourquoi au juste il retardait son évasion de ce monde auquel, en dépit de toutes les contaminations, il n’avait, pour être honnête, jamais vraiment appartenu.
Peut-être son propre argument selon lequel il était flic parce qu’il n’aimait pas que les fils de pute restent impunis lui avait tellement plu qu’il avait fini par y croire et par s’en convaincre. Peut-être le manque de capacité à prendre des décisions qui avait guidé toute son existence erratique, l’avait-il attaché
à une routine couronnée par la satisfaction de succès plus que douteux: attraper des assassins, des violeurs, des voleurs ou des escrocs qui de toutes façons ne savaient rien faire d’autre. Mais ce dont il était certain, c’était que le major Antonio Rangel, son chef depuis huit ans, avait été le principal responsable de l’ajournement quasi perpétuel de sa volonté de fuir. Les relations de fausse tension et de vrai respect qu’il avait établies avec le Vieux avaient eu l’effet d’une technique dilatoire terriblement efficace et il savait qu’il n’aurait jamais eu le courage nécessaire pour arriver au bureau du cinquième étage sa lettre de démission à la main. C’est pourquoi il avait reporté ses espoirs d’évasion sur le départ à la retraite du major, qui avait eu 58 ans et était susceptible de partir dans deux ans.
Mais ce vendredi, d’un seul coup, tous les garde-fous réels et fictifs étaient tombés. La nouvelle du remplacement du major Rangel avait couru les couloirs du commissariat avec l’intensité de la peste, et en l’entendant, le Conde avait senti la brûlure de la peur et de l’impuissance s’imprimer au fer rouge dans son dos et jusque dans son cerveau. L’inconcevable départ du Vieux ne constituerait pas le dernier chapitre de ces histoires de persécutions, d’interrogatoires et de punitions dont avaient été victimes les enquêteurs du commissariat de la part d’autres enquêteurs chargés de l’acte contre-nature d’espionner et d’enquêter sur la police. Les nombreux mois d’inquisition avaient servi à voir la chute de têtes qui semblaient intouchables, à mesure que la peur devenait un protagoniste de plus en plus important de cette tragédie à goût de farce, prête à aller jusqu’au bout des trois actes réglementaires jusqu’au dénouement, un dénouement imprévisible susceptible d’entraîner ce que tous avaient cru invulnérable et sacré.
Et sans y réfléchir à deux fois, Mario Conde avait opté pour la démission. Refusant d’entendre toutes les raisons fielleuses
qui disait-on, expliquaient le départ du Vieux, il avait écris sur un papier sa demande de démission pour raisons
personnelles, il avait patiemment attendu l’ascenseur qui devait mener au cinquième étage, et, après avoir signé sa lettre,
l’avait remise à la femme officier qu’il avait trouvée dans la salle d’attente de ce qui avait été – et ne serait jamais plus
le bureau de son ami, le major Antonio Rangel.
Mais au lieu de se sentir soulagé, le Conde s’était retrouvé
submergé de douleur. Non, bien sûr que non: ce chemin n’était pas celui de l’évasion victorieuse et autosuffisante qu’il
avait toujours imaginée, mais une dérobade de reptile que même Rangel ne lui pardonnerait jamais. Et c’est pour cela
qu’au lieu de chanter et de danser, il avait décidé de se contenter de boire et d’essayer d’oublier, et sur le chemin du retour
il avait dépensé toutes ses économies dans l’achat de sept bouteilles de rhum et de douze paquets de cigarettes.
– Alors, il y a une fête à la maison ? lui avait demandé avecun
sourîre confiant le Chinois qui travaillait comme employé du magasin, et Mario Conde l’avait regardé dans les yeux.
– Non, compatriote, une veillée funèbre, avait-il répondu
avant de sortir.
Tandis qu’il se déshabillait et buvait un verre de la première
bouteille dépucelée, le Conde avait découvert que la mort annoncée de Rufino, son poisson de combat, était bel et bien
advenue, et qu’il flottait au milieu d’une eau qui ressemblait a de l’encre, sombre et maladive, les nageoires déployées
comme une fleur fanée sur le point de perdre ses pétales.
– Merde, Rufino, qu’est-ce qui t’a pris de mourir
maintenant et de me laisser seul… j’allais justement changer ton eau, dit t-il dit au corps immobile, et il avait terminé son verre
avant de balancer liquide et cadavre à la voracité de la cuvette toilettes.
Le second verre à la main, et sans soupçonner qu’il
ne passerait que trois jours sans prononcer un mot, Mario Conde avait débranché
son téléphone et ramassé le journal plié en deux la porte, et était allé le placer à côté de la cuvette pour
que ce papier taché d’encre ait l’usage qu’il méritait. Et c’est alors qu’il l’avait aperçu, discret, dans un coin de la page deux:
une entaille, encore sans nom, dessinée à l’ouest du cap Vert, et qui, depuis la froide latitude de la carte, provoqua en lui le tremblement électrique d’un pressentiment: ce salopard va venir jusqu’ici, avait-il pensé immédiatement, et il avait commencé à le désirer de toutes ses forces, comme s’il avait été possible d’attirer mentalement ce monstre catastrophique et purificateur. Et il s’était servi un troisième verre de rhum, pour attendre en paix la venue du cyclone.
Il se réveilla avec la certitude que l’ouragan était arrivé. Le tonnerre était si proche qu’il ne put s’expliquer comment quelques heures plus tôt le ciel avait pu sembler si calme.
L’après midi d’automne s’était dépêché de se noyer dans l’obscurité, et, convaincu qu’il était d’entendre des coups de tonnerre, il remarqua quand même avec surprise l’absence de pluie et de vent, et c’est alors que derrière les derniers roulements, la voix parvint jusqu’à lui:
– Mario, c’est moi. Allez, ouvre, je sais que tu es là.
Une brèche de lucidité se fraya un chemin dans la gueule de bois qui comprimait son cerveau et un signal d’alarme illumina sa conscience. Sans dissimuler une nudité rétrécie par la peur, le Conde courut ouvrir la porte de la rue.
– Mais qu’est-ce que tu fais là, sauvage? demanda-t-il une fois la porte ouverte, avec un mauvais pressentiment dans la poitrine. Il est arrivé quelque chose à Josefina?
Un rire explosif rendit au Conde la conscience du caractère irréparable de ses actes et la voix du Flaco Carlos lui rappela l’étendue du désastre dans lequel il s’était fourré:
– Eh, vieille bête, mais elle est
minuscule.. et il éclata de nouveau de rire, relayé par Andrés et
El Conejo, qui passèrent la tête pour vérifier l’affirmation du Flaco.
– Et ta mère, elle l’a pas minuscule… fut tout ce qu’il parvint à dire, tandis qu’il battait en retraite, montrant
à l’adversaire la pâleur incongrue de ses fesses.
Le Conde dut avaler deux comprimés de Duralgine pour tenir en respect le mal de tête menaçant, qu’il préféra attribuer à la frayeur plutôt qu’au rhum : la présence imprévue du Flaco Carlos dans son fauteuil roulant, lui avait fait craindre que quelque chose soit arrivé à Josefina. Cela faisait très longtemps
que que son meilleur ami ne venait pas chez lui et il avait pensé que seul un malheur pouvait être à l’origine de cette visite. L’image malsaine qu’il avait eue cet après midi, quand il s’était imaginé plongeant dans le vide sans le secours d’une paire d’ailes, lui sembla définitivement hors d’atteinte: s’en aller et laisser ses amis? Laisser Carlos tout seul dans son fauteuil roulant, et tuer de tristesse la vieille José? L’eau qui baigna son visage évacua les dernières boues du sommeil et du doute. Non, il n’en était pas capable, en tout cas pas maintenant.
– J’ai craint le pire, dit-il enfin quand il revint au salon une cigarette à la bouche et qu’il vit que Carlos, El Conejo et Andrés s’étaient déjà partagé les dernières dépouilles de son ultime bouteille de rhum.
– Et nous, qu’est-ce que tu crois qu’on s’est dit? attaqua le Flaco avant de reboire un peu de rhum. Merde, trois jours sans savoir où
tu avais bien pu passer, le téléphone en dérangement, sans prévenir.., pour une connerie, c’est une belle connerie, espèce de sauvage…
– Bon, ça va, ça, va, je ne suis plus un gamin, essaya de se défendre le policier.
Comme toujours, Andrés tenta de jouer les conciliateurs.
– Tout va bien, messieurs, et regardant le Conde : C’est que Josefina et Carlos se font du souci pour toi, Mario. C’est pour ça que je l’ai amené jusqu’ici, il ne voulait pas que je vienne seul.
Le Conde regarda son meilleur et plus vieil ami transformé en masse amorphe, qui débordait des accoudoirs du fauteuil où il engraissait comme un animal promis au sacrifice. Il ne restait rien de la figure décharnée de celui qui avait été le Flaco Carlos, Carlos le Maigre, son destin avait été inversé par la faute d’une saloperie de balle qui l’avait laissé invalide à jamais. Mais il y avait aussi là, toujours, intacte et invincible, la bonté de cet homme, preuve vivante aux yeux du Conde de l’injustice du monde. Pourquoi avait-il fallu qu’une histoire pareille arrive à un type comme Carlos? Pourquoi quelqu’un comme lui avait-il dû aller perdre le meilleur de sa vie dans une guerre lointaine et obscure ? Si des choses pareilles arrivent, alors Dieu ne peut pas exister, se dit-il, et l’âme en peine du policier se sentit émue à se fendre quand le Flaco lui dit:
– Il te suffisait d’appeler.
– D’accord, j’aurais dû appeler. Pour te dire que j’ai démissionné de la police.
– Encore heureux, mon fils, je me faisais vraiment du souci, soupira Josefina en l’embrassant sur le front. Mais regarde la tête que
tu as. Et cette odeur. Combien de rhum tu as bu? Et tu es maigre à faire peur…
– Et je ne te dis pas ce qu’on a découvert, intervint Carlos en marquant entre ses doigts la très réduite virilité du Conde telle qu’il l’avait aperçue, et il se remit à rire.
– Conde, Conde, intervint El Conejo avec inquiétude: toi qui es à moitié écrivain, ôte-moi un doute sémantique: quelle est la différence entre peu, l’adverbe, et peux, de « je peux ».
Le Conde regarda son interrogateur, qui pouvait à peine dissimuler ses dents hors du commun derrière sa lèvre supérieure. Comme toujours, il fut incapable de savoir si la grimace cachait un sourire ou simplement des dents de lapin.
-Ben, je ne sais pas… Le « x »
à la fin…
– Non, la taille! dit El Conejo qui libéra sa dentition et éclata d’un rire aussi long que retentissant, qui incitait les autres à le rejoindre.
Josefina se lança à la rescousse du Conde et lui prit les mains
– Ne t’occupe pas de lui, mon petit Conde. Figure-toi que comme je me suis dit que ces trois là qui prétendent être tes amis te ramèneraient peut-être ici, et comme je me suis aussi dit que
tu aurais faim, d’ailleurs ça se voit que tu as faim, je me suis mise à imaginer et à imaginer ce que je pourrais bien faire à manger pour ces garçons, et,
tu sais, je ne trouvais rien de spécial… Et tout d’un coup, le déclic, ce n’était pas compliqué: du riz avec du poulet au jus. Qu’est-ce que
tu en dis?
– Combien de poulets, José? s’enquit le Conde.
– Trois et demi.
-Avec des piments?
– Oui, histoire de décorer. Et cuisinés à la bière.
– Donc, trois poulets et demi…
Et tu crois que ça va suffire? continua le Conde tout en poussant le fauteuil du Flaco en
direction de la salle à manger, avec l’habileté acquise par des années de pratique.
Le jugement final des convives fut unanime : ce riz manquait de petits pois, dirent-ils, même s’il a bon goût, ajoutèrent-ils, après avoir avalé trois grandes assiettes de ce riz transfiguré par les graisses et les saveurs du poulet.
Pour digérer avec du rhum, ils s’enfermèrent dans la chambre du Flaco tandis que Josefina somnolait devant le téléviseur.
– Mets une cassette, Mario, exigea le Flaco, et le Conde eut un sourire.
– Comme d’habitude? demanda-t-il par pur plaisir rhétorique, et il reçut en retour le sourire et la réponse de son ami.
– Comme d’habitude…
– Bon, voyons voir, qu’est ce que
tu aimerais écouter? dit l’un.
– Les Beatles, enchaîna l’autre.
– Chicago?
– Formule 5?
– Los Pasos?
– Credence?
– Oui, Credence, dirent-ils tous deux en
chœur, avec la perfection d’une séquence répétée mille fois et représentée mille autres, tout au long d’innombrables années de complicité. Mais ne me dis pas que Tom Foggerty chante comme un nègre, je t’ai déjà dit qu’il chantait comme un dieu, non? et les deux approuvèrent, reconnurent qu’ils étaient radicalement d’accord, car tous deux savaient parfaitement que oui: ce salaud chantait comme un dieu, et il commença à le démontrer quand le Conde appuya sur » Play » et que Foggerty, avec The Credence Clearwater Revival, attaqua son incomparable version de Proud Mary…
Combien de fois avaient-ils déjà vécu cette même scène?
Assis par terre, le rhum à côté de lui et la cigarette allumée dans le cendrier, le Conde céda à l’exigence de ses amis et leur raconta les derniers événements du commissariat et sa décision irrévocable de quitter la police.
– Ça y est, je n’ai plus rien à voir avec ces fils de pute… De toutes
façons, ils sont de plus en plus nombreux. Des bataillons de fils de pute…
– Des régiments… des armées, renchérit Andrés en élargissant la puissance logistique et quantitative de ces envahisseurs, plus résistants et prolifiques que les cafards.
– Tu es fou, Conde, dit finalement Carlos.
– Et si tu quittes la police, qu’est-ce que
tu vas faire? demanda El Conejo, individu viscéralement historique, qui avait toujours besoin de raisons, de causes et de conséquences, même pour les événements les plus insignifiants.
– Ça, c’est ce qui me préoccupe le moins. Ce que je veux, c’est m’en aller…
– Écoute, sauvage, intervint Carlos en plaçant le verre de rhum entre ses jambes, fais ce que
tu voudras, quoi que tu fasses, je serai d’accord, vu que je suis ton ami, non? Mais si
tu t’en vas, va-t’en avec l’envie de partir, sans te noyer dans l’alcool. Plante-toi au milieu du commissariat et crie » Je m’en vais parce que j’en ai plein les couilles « , mais ne te défile pas, comme si tu devais quelque chose à quelqu’un,
tu ne dois rien à personne, n’est-ce pas ?…
– Moi, je suis content pour toi, Conde, dit alors Andrés tout en contemplant ses mains avec lesquelles, trois fois par semaine, il ouvrait des abdomens et des cages thoraciques malades, avec la mission de réparer ce qui était réparable et de couper et jeter ce qui était malade et ce qui ne servait
plus. Je suis content que l’un d’entre nous envoie tout valdinguer et se décide enfin à voir venir ce qui doit venir.
– Un cyclone, murmura le Conde. après avoir bu un coup, mais son ami continua, comme s’il ne l’avait pas entendu.
– Tu sais bien que nous sommes une génération de moutons, et que c’est notre péché et notre délit. Nous avons d’abord été aux ordres des parents, pour être de bons étudiants et des gens bien. Nous avons été aux ordres à l’école, pour être les meilleurs, et ensuite aux ordres pour travailler parce que nous étions tous bons et qu’ils pouvaient nous envoyer travailler là où ils voulaient. Mais personne n’a jamais eu l’idée de nous demander ce que nous voulions faire: ils nous ont envoyés étudier à l’école où nous devions étudier, faire les études que nous devions faire, travailler dans le secteur où il fallait que nous travaillions et ils ont continué à décider, sans être foutus de nous demander une seule fois, bordel, si c’était bien ça que
nous voulions faire… Pour nous, tout est écrit d’avance, non? De la maternelle à la tombe, ils ont tout choisi, sans même nous demander de quoi nous souhaitions mourir. Voilà pourquoi nous sommes la merde que nous sommes, nous qui n’avons même pas de rêves et ne sommes bons qu’à faire ce qu’on nous dit de faire…
– Oh, Andrés, il ne faut quand même pas exagérer, tenta de tempérer le Flaco Carlos, tout en se resservant du rhum.
– Pas exagérer quoi, Carlos? Tu n’as pas été à la guerre en Angola parce qu’ils t’y ont envoyé? Ta vie n’a pas été foutue en l’air et
tu ne t’es pas retrouvé coincé dans ce fauteuil de merde parce que tu as été un bon garçon obéissant? Est-ce que
tu t es une seule fois dit que tu avais la possibilité de dire que tu n y allais pas ? Ils nous ont raconté qu’historiquement, nous devions obéir et toi,
tu n’as même pas pensé à refuser, Carlos, parce qu’ils nous ont toujours appris à dire oui, oui, oui… Et celui-ci, dit-il en montrant El Conejo, qui avait réussi le miracle de dissimuler ses dents et pour une fois paraissait réellement sérieux devant l’imminence d’une nouvelle bordée
mortifère, celui-ci, à part jouer avec les événements historiques et changer de femme tous les six mois, qu’est-ce qu’il a fait de sa vie? Où sont les foutus livres d’histoire qu’il devait écrire? Où est-ce qu’il a perdu tout ce qu’il avait toujours dit qu’il voulait être et qu’il n’a jamais été dans sa vie? Ne me raconte pas de salades, Carlos, et laisse-moi au moins être convaincu que ma vie est un désastre.
Le Flaco Carlos, qui n’était plus maigre depuis longtemps, regarda Andrés. L’amitié entre tous les quatre avait plus de vingt ans d’ancienneté, et ne réservait plus beaucoup de secrets. Mais dans les derniers temps, quelque chose était survenu dans le cerveau d’Andrés. Cet homme qu’ils avaient d’abord admiré parce qu’il était le meilleur joueur de base-ball du collège, porté aux nues par ses camarades pour avoir très virilement perdu sa virginité avec une femme si belle, si folle, et si attirante qu’ils auraient tous perdu y compris la vie pour elle, ce même Andrés qui allait devenir ensuite le médecin efficace que tous allaient voir, le seul qui avait fait un mariage enviable, avec même deux enfants, et avait eu le privilège d’avoir sa propre maison et sa
voiture particulière, était en train de se révéler comme un être rempli de frustrations et de
rancœurs, capable d’empoisonner son entourage avec son amertume. Parce qu’Andrés n’était pas heureux, ni satisfait de sa vie, et faisait en sorte que tous ses amis soient au courant: quelque chose, dans ses projets les plus intimes, s’était brisé et son chemin dans la vie – comme celui de tous les autres – avait pris des détours indésirables mais déjà tracés, sans qu’il ait le sentiment d’avoir, lui, son mot à dire.
– Bon, d’accord, disons que
tu as raison, se résigna à admettre Carlos. Il but une longue gorgée et ajouta: Mais on ne peut pas vivre avec des pensées pareilles.
– Et pourquoi, vieille bête? intervint le Conde en exhalant la fumée de sa cigarette, la tête encore pleine de ses impulsions alcooliques et suicidaires de l’après-midi.
– Parce qu’il faut alors tenir pour acquis que tout n’est que de la merde.
– Et ça ne l’est pas?
– Tu sais bien que non, Conde, affirma Carlos en regardant au plafond du fond de son fauteuil roulant. Pas tout, n’est-ce pas?
Il tomba sur le lit la tête emplie de vapeurs d’eau-de-vie et des lamentations générationnelles d’Andrés. Une fois en position horizontale, il entreprit de se déshabiller et de jeter ses habits par terre un par un. Il pressentait déjà le mal de tête qui accompagnerait l’aube, juste châtiment à ses excès, mais il remarqua que son cerveau jouissait en cet instant d’une étrange activité, était capable de mettre en marche des idées, des souvenirs, des obsessions et même de donner des ordres à son corps. Ce qui lui permit de se lever, dans un effort physique suprême pour aller dans la salle de bains chercher la Duralgine capable de faire avorter sa céphalée récurrente. Il calcula que deux comprimés suffiraient et il les avala avec de l’eau. Puis il marcha jusqu’aux toilettes et laissa tomber un faible jet couleur d’ambre qui coula sur les bords déjà tachés de la cuvette, ce qui lui fit s’intéresser aux proportions de son membre : il s’était toujours douté qu’il était trop court et il en avait maintenant la certitude – et la honte de ce » peu » -, après avoir offert sa
nudité à ses amis cet après-midi. Mais il haussa mentalement les épaules, cela n’avait pas d’importance puisque de toutes façons ce bout de tripe maintenant moribond s’était toujours montré un compagnon efficace dans les combats érotiques binaires ou unitaires, se redressant toujours rapidement quand le devoir l’appelait à son poste. T’occupe pas de ces fils de pute, lui dit-il en le regardant droit dans les yeux,
tu es peu mais tu peux, n’est-ce pas ? Et il lui offrit une dernière secousse.
La conscience que le lendemain il ne devait pas aller travailler, le surprit agréablement, et les poumons gonflés de liberté et de fumée de cigarette, il décida qu’il ne devait plus perdre son temps dans le lit solitaire. A cet instant même, ta vie va changer, Mario Conde; et après s’être fait la leçon, il décida de veiller utilement. Mettre à l’épreuve son indépendance était l’un des privilèges de sa nouvelle
situation. il se dirigea rapidement vers la cuisine pour mettre la cafetière à
chauffer, disposé à boire l’infusion matinale capable d’abuser son organisme et de lui rendre la vitalité nécessaire pour ce qu’il avait envie de faire: se mettre à écrire. Mais putain, sur quoi tu vas écrire? Sur ce dont Andrés avait parlé: il allait écrire une histoire de la frustration et de l’imposture, du désenchantement et de l’inutilité, de la douleur causée par la découverte que tous les chemins se valent, avec ou sans culpabilité. Telle était sa grande expérience générationnelle, si solide et bien nourrie qu’elle continuait à croître avec les années, et il conclut que cela vaudrait la peine de la mettre noir sur blanc, comme seul antidote contre l’oubli le plus pathétique et comme voie possible pour parvenir, une fois de plus jusqu’au noyau diffus de cette erreur sans appel: quand, comment, pourquoi, où, tout cela avait-il commencé à se casser la gueule? Quelle part de la faute (s’il y avait faute) revenait à chacun d’entre eux? Quelle part pour lui-même? Il but son café lentement, assis devant la feuille blanche que mordait le rouleau de l’Underwood, et il comprit qu’il allait être difficile de transformer ces certitudes et ces expériences, qui se contorsionnaient comme des vers de terre, en l’histoire dépouillée et émouvante qu’il avait besoin de raconter. Une histoire paisible comme celle de l’homme qui raconte à un enfant les aventures de l’espadon avant de se faire sauter la cervelle, car il n’a rien
de mieux à faire dans sa vie. Il regarda le papier, immaculé, et il comprit que ses désirs ne suffisaient pas à relever l’éternel défi du vingt-et-un-vingt-neuf-sept, où pouvait tenir la chronique de toute une vie gâchée. Il lui manquait l’illumination, comme celle de Josefina, capable de provoquer le miracle poétique de tirer quelque chose de neuf du mélange osé d’ingrédients oubliés et perdus. Et c’est pour cela que ses pensées revinrent au cyclone, visible seulement sur la carte du journal:
il avait besoin d’une chose pareille, ravageuse, dévastatrice, purificatrice et justicière, pour que quelqu’un comme lui puisse reconquérir la possibilité d’être lui-même, moi-même,
toi même, Mario Conde, et pour que renaisse la tâche toujours remise à plus tard d’engendrer un peu de beauté ou de douleur ou de sincérité sur ce papier muet et vide qui le défiait, sur lequel il finit par écrire, comme pris d’une éjaculation impossible à contenir: « Il tomba les bras en croix, comme si on l’avait poussé, et avant la douleur il sentit la puanteur millénaire du poisson pourri qui jaillissait de cette terre grise et étrangère. »
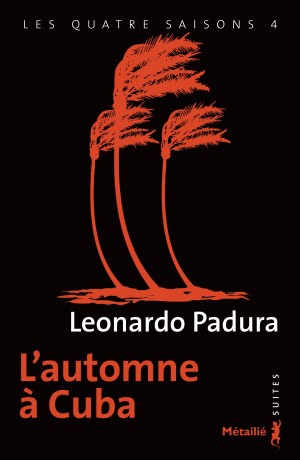






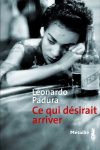

-100x150.jpg)