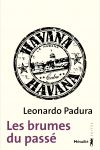Fernando revient passer un mois à La Havane, après 18 ans d’exil, pour enfin trouver le mystérieux manuscrit autobiographique du grand poète José Maria Heredia, auquel il a consacré sa thèse. Il souhaite aussi tirer au clair les circonstances qui l’ont contraint à l’exil. Qui l’a trahi ? A la mélancolie du retour de l’exilé et au suspens de sa recherche, se superpose le journal de Heredia, alors que Cuba luttait pour son indépendance, ainsi que les réflexions du fils du poète, franc-maçon, vers 1920. Peu à peu émergent des parallélismes surprenants dans la vie des trois hommes, comme si, à travers les siècles, l’histoire de Cuba marquait d’un sceau fatal les destins individuels. Dénonciations, exil, intrigues politiques, trahisons semblent inévitables à tout créateur talentueux, quel que soit le moment historique qu’il lui est donné de vivre. Leonardo Padura confirme ici, au-delà du roman noir, son talent d’écrivain. Il nous emmène à la fois dans un voyage aux origines de la conscience nationale cubaine à travers la vie de son premier grand poète romantique, et au cœur des questions que la situation actuelle impose à tous les habitants de l’île.
-
Derrière l'écran séduisant du roman noir et du polar, bien des écrivains ont pu dénoncer l'absence de liberté de leur pays sans tomber sous le coup de la censure. Ainsi Manuel Vazquez Montalban créant le personnage du détective Pepe Carvalho dans l'Espagne de Franco ; ainsi, à sa manière, le Cubain Leonardo Padura, qui fit ses premiers pas en littérature avec une tétralogie policière, Les Quatre Saisons. Plus que l'intrigue, c'est l'exploration d'une société par l'écriture et la langue qui intéresse ces auteurs-là. Ils utilisent le genre policier sans s'y enfermer et peuvent passer du noir au blanc, du polar à la fiction plus classique, sans rupture et sans peine. Pour eux, la littérature est surtout une question de style et donc de morale, d'esthétique et donc d'éthique. A preuve, le dernier et magnifique roman de Padura : Le Palmier et l'Etoile. Fernando, le personnage central du livre, est un intellectuel cubain qui a quitté La Havane il y a dix-huit ans. Universitaire, il a vu son monde s'écrouler lorsque la police l'a accusé, sur dénonciation croit-il, de complaisance à l'égard des ennemis du régime. Sans doute aurait-il pu rester sur l'île, être réhabilité, mais il est parti loin de Cuba et loin de ses copains de jeunesse, dont l'un pourrait être son délateur... A Madrid, où il réside désormais, Fernando poursuit son travail sur un poète cubain de la fin du XIXe siècle, José Maria Heredia (1803-1839), comme lui exilé. Il se lance à la recherche d'un manuscrit secret de ce dernier, en son temps compromettant pour son entourage, ce qui le conduit à retourner à Cuba. Il y retrouve ses copains d'antan et la femme qu'il n'a jamais cessé d'aimer, désormais veuve. La bande se reforme malgré la distance qui s'est creusée entre eux. Ensemble, ils partent à la recherche du manuscrit perdu? D'un exil, celui de Heredia, l'autre, celui de Fernando. Comment peut-on rester cubain ? Comment peut-on oublier Cuba ? Comment peut-on être la voix d'un pays (c'est le cas de Heredia, devenu figure nationale des décennies plus tard) après en avoir été exclu sa vie durant ? Toutes ces questions lancinantes, terribles, sous-tendent ce roman construit en abyme autour du thème de l'absence. Absence du fameux manuscrit de Heredia. Absence de tous ceux qui, au fil des siècles et sous des prétextes politiques divers (à chaque siècle ses exclus, partisans de l'indépendance du temps de l'Espagne souveraine, combattants de la liberté toutes époques confondues), sont renvoyés de l'île et contraints de ne la voir que de loin comme un mirage ou comme un fantasme. Heredia est retourné à Cuba le temps d'embrasser les siens avant de repartir au loin, au Mexique, et d'y mourir à peine trentenaire... Fernando, lui, devra aussi quitter Cuba après ces fausses vacances. Les temps ont changé, mais le mal du pays reste le même. Fernando cherche à comprendre le destin du poète pour se comprendre lui-même. Car c'est dans le passé, dans les racines, dans la douleur toujours recommencée de l'histoire des peuples et de celle des hommes qu'il faut puiser sa propre force. Celui qui ne sait pas d'où il vient ne saura jamais où il va, nous suggère ici d'une écriture ample, émouvante et sensuelle Leonardo Padura.Michèle GazierTELERAMA
-
« Les réponses auront l'amertume d'une mangue verte et le sourire d'un fou. [...] Dans cet infernal cycle historique, une double malédiction se répète : celle de la trahison et de l'exil. »Philippe LançonLIBERATION
I. La mer et les retours
– Sers-moi un café double, mon frère. Il s’était si souvent répété cette phrase pendant dix-huit ans, que les mots s’étaient usés, dans sa mémoire comme sur ses lèvres, au point de se vider de leur sens comme un mot d’ordre prononcé dans un langage incompréhensible. Car malgré l’oubli qu’il avait essayé de s’imposer comme la meilleure alternative possible, Fernando Terry avait trop souvent été victime des révoltes imprévisibles de sa conscience et avec une insistance incontrôlable, il avait ressassé ce qu’il aurait voulu éprouver à l’instant précis où, après avoir bu un café double au bar du cabaret Las Vegas, il allumerait une cigarette pour traverser la rue Infanta et descendre la rue 25, disposé à affronter son passé pour le meilleur et pour le pire. De la mélancolie à la haine, de la joie à l’indifférence, de la rancœur au soulagement, au cours de ses voyages imaginaires, Fernando avait joué avec toutes les cartes de la nostalgie, sans deviner qu’il avait peut-être gardé, tapie dans l’obscurité de sa manche, cette tristesse agressive, incrustée dans son âme, avec une interrogation: fallait-il vraiment que tu reviennes? Au début de son exil, durant les mois d’incertitude vécus sous une tente étouffante dans les jardins de l’Orange Bowl à Miami, sans savoir encore s’il obtiendrait le droit de séjour aux États-Unis, Fernando avait commencé à penser à un retour, bref mais nécessaire, qui l’aiderait à panser les blessures encore ouvertes dues à une trahison dévastatrice et, peut-être même, à guérir la sensation vertigineuse de se retrouver flottant hors du temps dans un autre espace. Puis, avec les années et la persistance de la barrière des lois et des dispositions qui compliquaient tout retour, il avait tenté de croire que l’oubli était possible et que cela pouvait être le meilleur des remèdes. Il avait alors commencé à ressentir un soulagement bénéfique car le désir ardent de revenir s’était peu à peu dilué au point de se transformer en une angoisse souterraine qui remontait traîtreusement à la surface, certaines nuits indomptables quand, à Madrid, dans la solitude de sa mansarde, son cerveau s’obstinait à évoquer un instant de ses trente années vécues dans l’île. Mais depuis que Fernando avait reçu la lettre d’Álvaro avec la plus excitante des nouvelles, celle qu’il n’espérait plus recevoir, le besoin de revenir avait cessé d’être un cauchemar furtif et il s’était senti poussé à ouvrir de nouveau la malle des souvenirs les plus dangereux. Alors, pour la première fois depuis son départ de Cuba, il avait repris la lecture des vieux papiers de sa thèse de doctorat, prématurément abandonnée, sur la poésie et l’éthique de José Maria Heredia tandis que son esprit s’obstinait à imaginer chacun des pas qui le conduiraient chez Álvaro afin d’affronter ces escaliers toujours obscurs et fatigants pour être happé d’un seul coup par le tourbillon de son passé. Durant ses parcours imaginaires il altérait généralement l’ordre, le rythme, la finalité de ses actions et de ses pensées, mais il partait toujours du Las Vegas, où, accoudé au bar avec les ivrognes, les travailleurs de la radio voisine, quelque conducteur de bus pressé et les vagabonds de rigueur, il boirait le café léger et douceâtre toujours préparé à la vieille cafétéria dont il découvrait, avec une douleur infinie, qu’elle n’existait plus que dans sa mémoire persistante et dans une certaine littérature de la nuit havanaise: la cafétéria Las Vegas et son invincible comptoir en acajou poli avaient disparu, partis en fumée comme tant d’autres choses de sa vie. Fernando, comme si on l’avait poussé, s’enfuit devant cet échec déconcertant et, au pied de l’immeuble délabré où vivait son ami, en voyant les boîtes débordant d’ordures, les murs blessés par le salpêtre et les chiens tristes et galeux, il comprit que la guerre entre sa mémoire et la réalité venait tout juste de commencer. Il préféra alors continuer vers le Malecón avant de monter chez Álvaro où l’attendaient peut-être des absences et des tristesses encore plus déchirantes. Il remarqua presque avec joie qu’à cette heure de l’après-midi, dans la chaleur du soleil d’été, la longue digue qui séparait les Havanais de la mer demeurait déserte, même si au loin il vit quelques pêcheurs pleins de conviction qui lançaient leurs lignes à l’eau, tandis qu’un élégant voilier de plaisance sortait de la baie pour gagner la pleine mer. Les dix-huit années passées à se battre avec les détails de ce moment pour finalement se retrouver envahi par la sensation désagréable de s’être de nouveau égaré, lui firent douter du sens éventuel de son retour et il dut se raccrocher à la lettre d’Álvaro et à la nouvelle qui, en lettres majuscules, lui avait fait affronter l’épreuve et vaincre toutes ses réticences en demandant un mois de congé pour revenir à Cuba. FERNANDO, FERNANDO, FERNANDO: ÇA Y EST, IL Y A UNE BONNE PISTE. JE CROIS QUE NOUS POUVONS SAVOIR OÙ SONT LES PAPIERS PERDUS DE HEREDIA. Son ami lui racontait comment leur ancien professeur, le docteur Mendoza, qui à la retraite était devenu bibliothécaire de la Grande loge, avait récupéré plusieurs caisses de documents maçonniques égarées dans une cave des Archives nationales et parmi les papiers il en avait trouvé un capable de lui couper le souffle: il s’agissait du compte rendu de l’assemblée de la loge de Matanzas, « Fils de Cuba », réunie en l’honneur de José de Jesús Heredia, benjamin et dernier exécuteur testamentaire du poète José María Heredia, dans lequel il était stipulé que le vieux franc-maçon avait remis au Vénérable Maître une enveloppe scellée contenant un précieux document écrit par son père; ledit document devait demeurer, dès lors et jusqu’en 1939, sous la protection de la loge, temple héritier de celui qui avait initié le poète indépendantiste à la franc-maçonnerie en 1822… De quel précieux document s’agissait-il? lui demandait Álvaro et Fernando en avait conclu que cela ne pouvait être que le présumé roman disparu de Heredia qu’il avait essayé de trouver pendant des années, sans le moindre succès. Deux semaines plus tard, reniant ses décisions antérieures, il s’était présenté au consulat de Cuba, décidé à entamer les démarches pour obtenir un visa qui l’autoriserait à revenir temporairement dans sa patrie d’origine. Perdu dans ses élucubrations, Fernando remarqua seulement la proximité du bateau de plaisance lorsque la brise lui apporta la musique des tambours et des maracas que l’on jouait à bord. il observa le bateau et découvrit, accoudé au bastingage, un homme apparemment indifférent aux bruyantes réjouissances des touristes. Soudain, le voyageur leva les yeux et son regard se fixa sur Fernando, comme si la présence d’une personne assise sur le mur, à la merci de la solitude réverbérante du midi havanais, lui semblait inadmissible. Soutenant le regard de l’homme, Fernando suivit les évolutions du voilier jusqu’au moment où la plus petite des vagues nées dans son sillage vint mourir sur les rochers de la côte. Cet inconnu, qui l’observait en le scrutant avec une telle insistance, troubla Fernando et lui fit ressentir, comme si elle pouvait traverser le temps pour se coller à lui, la douleur qui dut submerger José Maria Heredia en ce matin lointain et sûrement froid du 16 janvier 1837, à bord du brigantin qui le ramenait vers l’exil après un séjour déchirant sur l’île, quand il regarda les vagues s’éloigner, cherchant justement ces rochers, dernière image d’une terre cubaine que le poète ne devait jamais revoir. Et moi, fallait-il aussi que je revienne? se demanda-t-il une fois de plus pendant qu’il traversait le Malecón, allumait une cigarette qui lui laissa un goût d’herbe sèche, revenait par la rue 25 et s’engageait dans les escaliers étroits conduisant chez Álvaro . Avec plus d’appréhension que de délicatesse, il frappa, comme à regret, à la vieille porte en bois et il sentit son cœur s’emballer en entendant le bruit des pas et le grincement de la porte. – Enfin, vieux frère, dit Álvaro qui, sans la moindre hésitation, lui tendit les bras. – Putain, Varo! Et Fernando serra contre lui l’odeur de sueur, de tabac et d’alcool qui enveloppait les os saillants de l’homme qu’il avait considéré comme l’un de ses meilleurs amis, des années auparavant. – C’est bon de te revoir… Mais c’est qu’il ne te manque rien! Regarde-moi ça, ru es presque devenu blanc! Álvaro sourit de sa propre plaisanterie et Fernando l’imita, malgré ce qu’il constatait et qui était bien pire que ce qu’il avait imaginé: les cinquante ans d’insomnie et de malbouffe d’Álvaro Almazán avaient macéré dans des alcools foudroyants et bon marché qui devaient avoir donné à son foie le même aspect que son visage: un masque violacé sillonné de rides perverses et de veines noueuses sur le point d’éclater. – Je t’attends depuis ce matin, commenta Álvaro et il l’entraîna par le bras. Allez, entre. L’appartement avait gardé le même aspect d’abandon, rongé par les croûtes invincibles du salpêtre, que Fernando avait connu plus de trente ans auparavant, à l’époque de leur amitié naissante, quand les parents d’Álvaro vivaient encore. La sensation de liberté liée à ce lieu, suscitée par le désordre perpétuel qui y régnait, expliquait peut-être que le groupe d’amis apprentis écrivains ait commencé à se réunir sur cette terrasse où se tiendraient finalement les fameuses tertulias – réunions littéraires – des Merles Moqueurs. – Je sais bien à quoi tu penses… Álvaro sourit et se laissa tomber dans un des fauteuils en fer de la terrasse. Fernando acquiesça et occupa l’autre fauteuil. – Ici rien n’a changé… – J’ai du rhum. – Ici rien ni personne ne change, précisa Fernando. – Plus que tu ne crois. Mais cela n’empêche pas certaines fidélités. Álvaro ne mit guère plus d’une minute à revenir avec deux verres pleins de glace et une bouteille sans étiquette, remplie d’un liquide trouble. Il servit des quantités exagérées et tendit un verre à Fernando. – A quoi on trinque? – Aux poètes disparus. A tous ceux qui ont trépassé comme nous, dit Álvaro en employant, comme il avait toujours aimé le faire, le verbe « trépasser ». Sans trinquer, il but la première gorgée. Regarde-moi… et ne regarde pas Enrique: ce n’est pas facile de rester vingt ans sous terre. Et le pauvre Victor, il doit être plus ou moins dans le même état… Et les autres, même s’ils vont et viennent et si on organise des fêtes en leur honneur, il y a longtemps qu’ils ont trépassé. Parfois je pensais à toi comme si tu étais mort. – Fais pas chier, Varo. – Attends un peu. Il but une longue gorgée avec avidité. J’ai ta lettre par là. ‘Ecris-moi seulement dans les trois cas suivants: si ma mère est en train de mourir, si tu es toi sur le point de mourir ou si tu trouves les papiers de Heredia. » – Tu trichais et tu m’envoyais tes livres. – Je ne les ai même pas dédicacés, pour suivre tes instructions… – Tu as bien fait de me les envoyer, admit Fernando et il but une gorgée de rhum qui lui laissa un goût de kérosène. Bon, j’ai une autorisation pour un séjour d’un mois, peut-être prolongeable… tu crois que ça suffira? – J’en sais foutrement rien… Mais, pour commencer, le mieux c’est toujours le début, non?… Écoute, aujourd’hui les Merles Moqueurs vont se retrouver tous ensemble pour la première fois en vingt-cinq ans. Et j’ai là deux bougies: une pour Enrique et l’autre pour Victor, les absents excusés… Fernando se leva et marcha jusqu’au bord de la terrasse. Bien que la mer ne fût qu’à moins de cent mètres, on ne pouvait voir un morceau de reflet bleu que depuis cet angle et en se penchant sur la balustrade. En des temps plus poétiques, cet inconvénient lui donnait envie de démolir tous ces immeubles laids et mal agencés. – Je t’ai dit que je ne voulais voir personne… Toi, El Negro Miguel Angel et personne d’autre… – Tu fais chier, Fernando, ru vas continuer longtemps avec ça? – C’est toi qui fais chier, Varo, dit-il en protestant et il se retourna. Quelqu’un qui devait très bien me connaître m’a dénoncé. Et même si j’ai décidé d’oublier tout ça, je préfère ne voir personne et laisser cette histoire où elle est. – Ben, laisse-la où elle est, mais ne renonce pas à ta vie, ils t’ont déjà assez baisé comme ça! – Trop, je crois. Allez, va, sers-moi encore un peu de rhum.
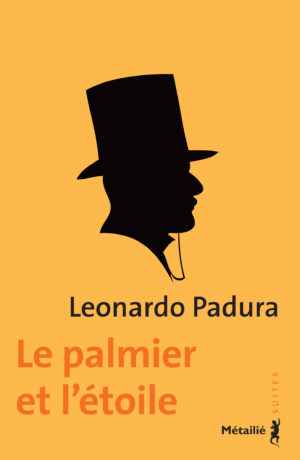






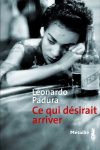



-100x150.jpg)