Huit ans après Marcher et vingt ans après Éloge de la marche, l’auteur revient sur le plaisir et la signification de la marche, et nous en révèle les vertus thérapeutiques face aux fatigues de l’âme dans un monde technologique.
La marche connaît un succès planétaire en décalage avec les pratiques de sédentarité ou de sport en salle, tapis de course… prédominant dans nos sociétés. Cette passion contemporaine mêle des significations multiples pour le même marcheur : volonté de retrouver le monde par corps, de rompre avec une vie trop routinière, de peupler les heures de découvertes, suspendre les tracas du jour, désir de renouvellement, d’aventure, de rencontre.
Une marche sollicite toujours au moins trois dimensions du temps : on la rêve d’abord, on l’accomplit, et ensuite on s’en souvient, on la raconte. Même terminée, elle se prolonge dans la mémoire et dans les récits que l’on en fait : elle vit en nous et est partagée avec les autres.
Dans ce livre – ludique, intelligent et stimulant –, l’auteur revient sur le plaisir et la signification de la marche, et nous en révèle les vertus thérapeutiques face aux fatigues de l’âme dans un monde de plus en plus technologique.
-
David Le Breton était l’invité d’Ali Rebeihi et d’Agathe Lacaron le samedi 13 février sur France 2 dans la toute nouvelle émission « Bel & bien » pour parler de la marche. Voir le replay de l'émission ici (à partir de 00:09:45)Ali Rebeihi et Agathe LacaronFrance 2 - Bel et bien
-
Ecouter le podcast de l'émission iciZoé VarierFrance Inter - Une journée particulière
-
"Ce livre est un voyage précieux. Entre les mains, le monde à fouler. Une randonnée exhaustive, littéraire et philosophique. Déconnectée..." Lire la chronique iciBlog Quintessence livres
-
Lire la chronique iciBlog Des livres et Sharon
-
"Un livre magnifique, une ressource infinie, en écrivant et en le feuilletant à nouveau, j’en suis encore très émue. Gros coup de cœur…" Lire la chronique iciBlog La livrophage
-
"C’est en puisant dans la littéra ture décrivant des chemins par courus mais aussi dans ses propres expériences que David Le Breton, sociologue à l’université de Stras bourg, revient à l’un de ses su jets de prédilection : le plaisir de la marche, ses moments forts et toutes leurs nuances."François ErnenweinLa Croix
-
Ecouter le podcast ici (à partir de 2:25:30)Eve RogerEurope 1 - La Matinale du week-end
-
"Qu’il explore le caractère sacré de la marche avec les pèlerins du Camino ou invite, à la suite d’Henry Miller dans le Colosse de Maroussi, à se laisser pénétrer par la lumière grecque, cet essai buissonnier, sensible et joyeusement érudit, est un pur bonheur de lecture."Sophie JoubertL'Humanité
-
Ecouter le podcast de l'émission iciManuela SalviA voix haute - Radio Télévision Suisse
-
Ecouter la podcast de l'émission iciElodie FontChacun sa route - France Inter
-
Ecouter le podcast de l'émission iciCaroline LachowskyAutour de la question - RFI
-
Ecouter le podcast de l'émission iciClaire ServajanLe téléphone sonne - France Inter
-
"Simple et lumineux."Valérie ZerguineFemme Actuelle Senior
-
"De très belles pages poétiques sur la déambulation et un plaidoyer pour se remettre en mouvement. À lire absolument."Clémence RouxMarie France
-
David le Breton était l'invité d'Olivia Gesbert dans l'émission La Grande table d’été sur France Culture le 1er juillet 2020 aux côtés de Catherine Cusset et de Charlotte Garson. Ecouter le podcast de l'émission iciOlivia GesbertLa Grande table d’été - France Culture
-
David le Breton était « L’invité du Jour » de Laurent Bignolas mercredi 1er juillet dans Télématin sur France 2 pour Marcher la vie. Un art tranquille du bonheur. Voir le replay de l'émission ici (01:55:25)Laurent BignolasTélématin - France 2
-
Voir l'émission iciPascal ClaudeEt Dieu dans tout ça ?
-
"David Le Breton revient sur le plaisir et la signification delà marche et en révèle les vertus thérapeutiques face aux fatigues de l’âme dans un monde de plus en plus technologique.Martine FreneuilLe Quotidien du médecin
-
"Lève-toi et marche ! Dans ce petit livre guilleret et remarquablement écrit, le professeur Le Breton se livre à un éloge poétique de ce loisir à la mode. [...] Quand lire nous donne des fourmis dans les pieds et une envie folle de prendre le chemin..."Bernard d'EpenouxTélé Z
-
"Dans Marcher la vie - écrit en un langage limpide, expurgé de toute abstraction, fait de remarques, de réflexions, et de nombre de citations littéraires -, Le Breton n’oublie aucun bienfait de la marche, dont il fait à la fois une affaire d’espace mais aussi de temps, d’anticipation (on rêve), d’actualisation (on pratique) et de remémoration (on se souvient et on raconte)."Robert MaggioriLibération
-
"Les marcheurs cherchent leur place dans le monde et souvent ils la trouvent. Et la marche guérit. Elle est un remède à la mélancolie, aux tristesses consécutives à une séparation, et même à certaines maladies. On parle beaucoup de résilience. Je préfère le mot «résistance», plus combatif. Marcher, c’est résister."Astrid de LarminatLe Figaro Littéraire
-
"On retrouve totalement dans les propos de cet essai, les petits bonheurs liés à la marche." Lire la chronique iciBlog Baz'art
-
"Le lecteur chemine à l’aise, ravi de retrouver parfois, au détour d’une phrase, les sensations, les impressions, les réflexions fugaces qu’il a pu expérimenter lui-même." Lire la chronique iciSite Zibeline
-
"Marcher c'est renouer avec son corps, mais c'est aussi renouer avec la sensorialité du monde puisque dans le monde urbain, dans le monde de la ville qui est le nôtre, on n'a plus énormément de choses à sentir, à voir, à goûter, etc., mais quand vous marchez dans les Vosges ou ailleurs, vous êtes confrontés à un univers d'odeurs extraordinaire, à la contemplation du monde, vous êtes confrontés à la beauté du monde, vous retrouvez le silence."Gaël Legras28 minutes - ARTE
-
« Randonneur passionné, l'anthropologue David Le Breton vient de consacrer un troisième livre à la marche, nouvelle passion française. »Pauline SommeletPoint de vue
-
« Dans son nouvel ouvrage, Marcher la vie, l’anthropologue David Le Breton nous invite à nous mettre en route. Profitons de l’été pour pérégriner. »Vanessa ZocchetiMadame Figaro
-
« La marche est toujours une remise au monde, une manière de retrouver le sentiment d’être vivant, une manière de reprendre pied dans une vie qui nous échappe. Après le confinement où le corps était mis au repos voire immobilisé, les gens ont retrouvé la marche dans la nature avec émerveillement. »Veneranda PaladinoL'Alsace
-
« David Le Breton en est à son troisième ouvrage sur la marche. De la déambulation urbaine au pèlerinage en passant par les périples aventureux, le sociologue analyse les ressorts et vertus d’une activité qu’il prise. Et qu’il sera bon de reprendre dans un monde post confmement. »Julien DamonLes Echos
-
"On peut lire Marcher la vie comme un manuel d'anti collapsologie, un manifeste rousseauiste non pas pour le monde d'avant ou d'après, mais pour celui qui se vit au présent. Pour reprendre pied, avant de nouveau en regardant devant soi."Laurent LemireLivres Hebdo
Sommaire
Se mettre en marche 13 – La route imaginaire 23 – Rythme 26 – Homo caminans 34 – Tracer son chemin 40 – Désagréments 55 – Le Camino 67 – Des échappées belles 82 – Les paysages sont vivants 97 – Entre solitude et compagnie 117 – Reprendre pied pour des jeunes en rupture 127 – Marcher pour guérir 141 – Mélancolie du retour 156 – Bibliographie 159.
Se mettre en marche
“Je ne marche pas pour rajeunir ou éviter de vieillir, pour me maintenir en forme ou pour accomplir des exploits. Je marche comme je rêve, comme j’imagine, comme je pense par une sorte de mobilité de l’être et de besoin de légèreté.”
Georges Picard,
Le Vagabond approximatif
Comme Ulysse, il est nécessaire parfois d’accomplir le tour du monde et de se perdre en mille folies avant de rejoindre Ithaque. Même si l’issue était au flanc de la colline d’à côté ou sur les berges du fleuve à deux pas de sa maison, il fallait ce détour, parfois au bout du monde, pour en prendre conscience. Ce lieu est toujours innombrable car nous ne cessons de le chercher. Tout voyage participe de cette quête d’un lieu où exister se ferait en toute évidence dans une sorte de reconnaissance immédiate et de ravissement. Chacun cherche le lieu de sa renaissance au monde. Une sorte de magnétisme intérieur nous guide, une volonté de chance à saisir en toute confiance. Il n’est pas nécessaire d’aller bien loin. “Parfois, écrit Thoreau, c’est une trentaine de mètres que j’aimerais parcourir, comme si l’air qui souffle m’y attirait ; là, me dis-je, ma vie va venir à moi ; comme un chasseur, je marche pour la trouver. Quand j’aurai derrière moi le versant sans arbres de la colline aux airelles, alors vraiment mes pensées s’épanouiront. Y a-t-il une influence secrète, une vapeur que le sol exhale, une vertu dans les vents qui soufflent ou dans toutes les choses agréables qui s’offrent là ensemble dans mon esprit” (1981, 66). On éprouve justement dans certains endroits le sentiment qu’ils nous attendaient et n’avaient jamais cessé de nous hanter. Ce n’est pas une découverte mais un retour. Le temps se dérobe, toute l’histoire personnelle converge vers ce moment. La lumière n’est plus celle qui baigne la vie ordinaire, un autre monde au sein duquel nous sommes sur le point de rentrer se fait pressentir. Une autre dimension du réel s’ouvre, marquée par la sérénité, la beauté. Le silence qui y règne parfois est un fleuve aérien qui enveloppe le marcheur, l’emporte dans son courant, affûte ses sens et élargit un sentiment de résonance sans défaut avec les mouvements du monde. Certains lieux possèdent peut-être une conscience et ils cherchent à dire au passant leur plaisir de le voir arpenter leur domaine. Nous allons à leur recherche, inlassablement. Sans doute faut-il parfois assister les dieux, les aider à resplendir lors de notre passage. Il fallait être là à ce moment précis pour que le paysage atteigne sa perfection, avec le sentiment qu’il attendait notre présence et n’est là que pour nous seul à la manière d’un don qui n’attend rien en retour sinon ce sentiment de paix et d’alliance.
On ne se lasse ni de marcher ni de laisser sa plume courir sur la page, je ne pensais pas écrire un troisième livre sur la marche. Après Éloge de la marche (2000) et Marcher. Éloge des chemins et de la lenteur (2012), en voici maintenant un autre. J’ai peine à penser que le temps passe si vite. Mais mon goût de marcher n’a cessé de s’aviver au fil de ces années. Et, depuis une vingtaine d’années, la marche connaît un succès planétaire en décalage avec les valeurs les plus ancrées dans nos sociétés. Cette passion contemporaine mêle des significations multiples pour le même marcheur : volonté de retrouver le monde par corps, de rompre avec une vie trop routinière, de peupler les heures de découvertes, suspendre les tracas du jour, désir de renouvellement, d’aventure, de rencontre… La vie ordinaire est souvent faite d’une accumulation d’urgences qui ne laissent plus de temps à soi. Les agendas sont souvent saturés. Mais d’autres raisons font de la marche un recours, et même une résistance à l’encontre des tendances du monde contemporain qui dépossèdent chacun d’une part de sa souveraineté et de son plaisir d’être soi (Le Breton, 2012).
Autrefois on marchait pour arriver, par nécessité, à défaut d’avoir les moyens d’acheter une bicyclette, une mobylette ou une voiture. Aller à pied n’était pas un privilège mais une nécessité. Le chemin importait peu, seule comptait la destination. Encore aujourd’hui, pour maintes populations à travers le monde, se déplacer est le fait de pauvres ou de migrants qui n’ont guère le choix. Dans nos sociétés, depuis les années 80, la marche est un loisir de plus en plus prisé à travers le monde. Sur les chemins de grande randonnée comme celui de SaintJacques-de-Compostelle ou de la via Francigena en Italie, on croise des hommes ou des femmes du monde entier, de tous âges et de toutes catégories sociales. Aujourd’hui on marche pour voyager, découvrir du pays, savourer les heures sans autre souci que de mettre un pied devant l’autre, vivre une trame de surprises et d’acquiescements. Comme l’écrivait Leslie Stephen, grand randonneur anglais du XXe siècle et père de Virginia Woolf, “le vrai marcheur est celui pour qui la quête constitue un plaisir en soi, qui n’est en réalité pas assez suffisant pour se placer au-dessus d’une certaine satisfaction vis-à-vis de la prouesse physique nécessaire à ladite quête” (2017, 31).
L’humanité est désormais assise, elle sèche sur pied (Le Breton, 2018). Devant les écrans de portables, d’ordinateurs ou de télévisions, aux volants des voitures ou au bureau, la sédentarité est un souci majeur de santé publique. Dans les années 50 en France, on marchait en moyenne sept kilomètres par jour. Aujourd’hui, à peine trois cents mètres. Nombre de nos contemporains sont encombrés d’un corps dont ils n’ont guère l’usage, sinon pour exécuter quelques tâches dans leur appartement ou pour se rendre à leur voiture et en sortir. Le corps est rendu passif, objet à emmener avec soi d’une activité à une autre mais en le mobilisant au minimum grâce au recours à d’innombrables procédés technologiques relayant les activités physiques allant des escaliers mécaniques et des trottoirs roulants à la voiture, ou aux trottinettes, ou aux vélos électriques. On transporte son corps, il ne nous transporte plus. L’effort physique n’est plus qu’un loisir pour une immense majorité de contemporains, et paradoxalement il se fait souvent dans l’immobilité géographique et dans l’aseptisation d’une salle de remise en forme en marchant ou en courant sur un tapis, immergé virtuellement dans un simulacre de paysage, les yeux fixés sur une télévision ou son cellulaire, les écouteurs aux oreilles. Hors de question dans ces circonstances de plonger dans une intériorité qui effraie de plus en plus. L’effort lui-même est instrumentalisé comme un devoir de santé et de forme, il tourne dans le vide, il ne s’agit nullement de couper du bois, de bêcher son jardin ou de ramasser des fruits sous les arbres, ni même d’aller faire ses courses à pied. Dans ces salles éloignées du plein vent du monde, il ne s’accomplit pas toujours dans un environnement extérieur susceptible d’apporter quelques surprises, mais dans un monde technologique aseptisé et un emploi du temps sous contrôle.
En ce sens, l’engouement pour la marche prend le contrepied de cette tendance à l’immobilité et à la subordination aux techniques. Célébration du corps, des sens, de l’affectivité, mise en branle de toute la personne, présence active au monde, elle remet en contact avec soi et avec la sensation d’exister. D. Peacock écrit que lors de ses marches, généralement après le quatrième ou le cinquième jour, il “perd toute envie de caféine, d’alcool, de sucre, de graisse, de sel ; à la place, je réponds à mes besoins physiologiques les plus élémentaires avec une extrême parcimonie” (2008, 81). Certes, une marche régulière contribue à la santé, mais s’y astreindre pour cette seule raison serait une forme de puritanisme, un devoir à accomplir propice à l’ennui.
Le marcheur se met à nouveau debout, il reprend corps, il mobilise des ressources demeurées inconnues s’il était resté sédentaire et emprisonné dans les mêmes routines, il redécouvre son corps sous un autre jour, et nombre de maux liés au manque d’exercices physiques s’effacent au long des heures ou des jours. Cet effort n’est jamais vécu comme tel, la marche n’est pas un devoir, mais un jeu, un détour pour trouver l’insouciance qui fut celle de l’enfance avec parfois des comportements exubérants dans la solitude, souvent sans témoin, où l’on danse, où l’on chante, dans l’oubli radical des exigences de présentation de soi qui sont au cœur du lien social. Même les vêtements soulignent la détente, l’indifférence aux conventions : en short, en T-shirt, en chemise ou en maillot, un chapeau, une casquette, avec parfois des chaussures boueuses ou trempées, vestige d’un passage délicat. Mais à l’arrivée à la ferme auberge ou au gîte, nul n’a le souci des convenances. Après les difficultés des premières heures ou des premiers jours, le corps trouve ses plis de mouvements, son aisance et la jubilation de s’immerger à nouveau dans des sensations oubliées, le plaisir de la dépense physique quand elle ne vient que de soi. Dans les prisons, les détenus ont encore droit à une promenade même si elle consiste à aller d’un mur à un autre, mise en branle du corps pour aérer l’esprit. Nelson Mandela parcourait chaque jour plusieurs kilomètres dans l’étroitesse de sa cellule. Il marchait pour reprendre corps dans son existence à travers l’affirmation de son désir là où les gardiens lui imposaient de casser des cailloux. Dans Éloge de la marche, j’ai longuement évoqué ces échappées belles d’hommes ou de femmes privés de liberté mais qui ne cessent de marcher à la fois dans leur tête et dans leur cellule.
En outre, dans le monde de l’hyperconnexion les conversations deviennent rares. Quand elles existent, elles sont souvent rompues par des interlocuteurs toujours là physiquement mais qui disparaissent soudain après l’audition d’une sonnerie de leur portable ou dans le geste addictif de retirer ce dernier de leur poche dans la quête lancinante d’un message quelconque qui rend secondaire la présence bien réelle de leur vis-à-vis. La conversation s’efface au profit de la communication, et cette dernière implique la virtualité, la distance, la décorporation, l’absence physique ou morale (Le Breton, 2017). À l’inverse, la conversation sollicite une disponibilité, une attention à l’autre, la valeur du silence et du visage. La marche justement restitue l’épaisseur de la présence, elle est un instrument puissant de retrouvailles avec les proches pour ces moments de plus en plus mesurés où l’on est tout entier dans le souci de l’autre tout en partageant des moments privilégiés. Même le repas de famille, qui était un haut lieu de transmission, tend à disparaître au profit du grignotage individuel, chacun arrive à son heure et s’installe dans un fauteuil ou gagne sa chambre après être allé chercher les plats achetés tout prêts au supermarché avant de s’abandonner à son écran personnel. Dans nombre de famille, le repas devient peu à peu une assemblée de fantômes qui mangent d’une bouche distraite, peu attentive au goût des aliments, dans l’indifférence à la présence des autres, tous absorbés par leur cellulaire. Marcher avec des enfants est un moment précieux de longue disponibilité à leur égard, un temps de retrouvailles et de transmission dans le partage d’une expérience insolite pour eux, l’un des rares lieux d’une commune présence. Mais ces temps d’attention mutuelle valent pour les amants, les amis, les proches qui cheminent ensemble sans le parasitage du téléphone cellulaire. Cheminer ensemble est un éloge de la conversation, de la disponibilité à l’autre. Quant au marcheur solitaire, il est dans un seul lieu, ouvert aux événements, plongé dans sa rêverie, dans un dialogue intérieur sans fin.
La marche est aussi une rupture avec les exigences de rentabilité, d’efficacité, de rivalité. On chemine à quatre ou cinq kilomètres-heure, alors qu’en avion on traverse l’Atlantique en une dizaine d’heures. Une journée de marche correspond à peine à une demi-heure de voiture. Revendication de la lenteur, d’un rythme à soi que ne dicte aucune autorité extérieure et dans le refus des technologies qui font gagner du temps et perdre sa vie. De surcroît, la marche est une activité physique sans compétition, tout entière dans la jouissance de l’instant. Tissée d’humilité, de patience, de lenteur, de détours, elle reste dans les limites des ressources physiques, sans recherche de vaines prouesses, elle s’ajuste aux aspérités, aux courbes ou aux difficultés du terrain. Aucune course contre la montre. Aucun combat avec les éléments pour y imprimer son empreinte personnelle, mais une volonté apaisée de se perdre dans le paysage sans jamais le voir en adversaire à vaincre. La nature est une partenaire bienveillante qui accompagne ses efforts et le laisse trouver ses propres repères hors de cette capsule qui enferme le monde urbain en le rendant fonctionnel, prévisible mais dans l’occultation de l’élémentaire. Le soleil, la pluie, le vent n’apparaissent plus qu’à travers ce dispositif social et architectural qui leur ôte tout mystère. Les marcheurs ralentissent le monde pour le reprendre à bras le corps. Ils glissent dans une autre dimension du temps où plus rien ne presse, où il est loisible de s’arrêter pour goûter un paysage ou se reposer.
Dans nos sociétés matérialistes, la marche est une plongée en soi de quelques heures ou de quelques semaines, un décrochage des soucis du quotidien, elle réconcilie la vie contemplative et le mouvement physique, la pensée et l’effort, l’intériorité et le souci constant du terrain, l’attention à l’environnement et aux autres. L’homme contemporain tend à rejeter le religieux mais il vit souvent des moments de transcendance profane, l’irruption d’un sacré intime. Le pèlerinage, ou la marche de manière générale, sont propices à ces émotions qui procurent le sentiment d’être passionnément vivant. Dans un monde utilitariste, où tout doit servir sous peine de périr, elle en appelle à la passion de l’inutile. Une marche ne sert à rien sinon à émerveiller les heures. Elle ne rapporte rien en termes financiers ou professionnels, mais elle est fertile en découverte de soi, en intensité des moments vécus. Elle renvoie à la pure générosité de vivre sans autre justification. Le plus souvent, nos actes quotidiens sont détachés de toute valeur hormis celle de leur utilité. Ils ne rencontrent aucun au-delà qui amènerait à les voir sous d’autres auspices. La contemplation d’un lever de soleil ou de la tombée du jour, la découverte de certains paysages, la vue d’une falaise, d’un rocher, d’un lac dont le miroitement se rapproche peu à peu, ou encore ce sentiment de liberté qui guide sa progression, donnent au marcheur le sentiment de retrouvailles avec le cosmos, l’immersion dans un monde à nouveau ouvert. De même que l’espace se charge pour lui d’une sacralité diffuse, le temps de la marche est également à part, coupé des obligations, moment d’exception vécu avec intensité et inscrit parfois en lettres de feu dans la mémoire. Il donne à vivre une co-naissance avec un monde environnant qui vient au jour au fur et à mesure de l’avancée.
Dans un lien social marqué par les affrontements et la concurrence individuelle, où l’on est de moins en moins ensemble mais de plus en plus en rivalité, marcher renoue avec la civilité, la solidarité. Les sentiers dessinent une sorte de démocratie concrète qui réunit tous les milieux sociaux, tous les âges, dans les mêmes efforts. Le chef d’entreprise côtoie l’ouvrier, l’enseignant, le médecin ou l’employé. Certes, la majorité des marcheurs ont plus de quarante ou cinquante ans et relèvent davantage des classes moyennes ou privilégiées. Il faut disposer de temps et ne pas avoir un travail épuisant au fil du jour. Mais les sentiers sont les rares lieux où les différences sociales, culturelles ou générationnelles n’empêchent en rien les rencontres, les échanges, l’entraide.
Dans le monde aseptisé et jalonné d’innombrables prothèses, à commencer par la voiture, le sentiment d’exister s’efface le plus souvent. Une quête d’intensité d’être apparaît comme une réplique à l’immobilisation croissante du corps et de la relation physique au monde. Elle est particulièrement vive chez les jeunes générations à travers leur engagement dans maintes conduites à risque ou jeux dangereux, mais elle se traduit également par le succès croissant des activités physiques et sportives de pleine nature, les activités d’aventure, la passion du marathon ou des trails qui emportent nombre de nos contemporains (Le Breton, 2016). Les marcheurs ne sont pas en reste, ils sont également en quête de sensations, mais à leur mesure, dans l’éloignement de la mise en danger de soi ou de la performance. Partir sur les sentiers est une manière simple de réenchanter son existence. Marcher, c’est exister au sens fort comme l’étymologie le rappelle, ex-sistere : s’éloigner d’un lieu fixe, sortir hors de soi. Le recours aux sentiers, aux chemins est un pied de nez aux valeurs cardinales de nos sociétés postmodernes.
L’urbanisation ne cesse de s’accroître et les terres propices au vagabondage de diminuer. Nombre de sentiers ou de chemins disparaissent. Le processus vient de loin, en 1902 déjà, Leslie Stephen déplorait cette liquidation progressive de l’espace ouvert à la déambulation, mais il notait cependant : “Et pourtant, entre les lignes de chemin de fer, il y a encore des champs qui ne sont pas profanés par des publicités de pilules pour le foie” (2017, 54). Même s’il est vrai qu’ils se restreignent, les chemins de traverse demeurent encore pour vivre des échappées belles de quelques heures ou quelques mois.
La route imaginaire
“J’étais persuadé que ces canyons, ces buttes, ces mesas verdoyantes recélaient une sagesse et un équilibre corporel indispensables, dont on pouvait s’abreuver en arpentant la contrée l’esprit grand ouvert.”
Doug Peacock,
Une guerre dans la tête
Nous ne rêvons pas nos marches, nous sommes aussi rêvés par elles. Avant le départ, il y a l’imaginaire sans fin du voyage qui fait pousser des ailes, mais illumine déjà des mois avant le premier pas. Le plein vent du désir précède le plein vent des sentiers. Une anticipation heureuse des événements, des découvertes à venir, d’un temps sans contrainte. La marche existe déjà bien avant de partir, elle mobilise les pensées, oriente les lectures, la recherche de documentation, les échanges avec ceux qui en ont déjà l’expérience et la connaissance des lieux. Comme le souligne Gaston Bachelard, la préparation de la fête est partie intégrante de la fête. “Voyager plein d’espoir vaut mieux que d’arriver”, écrit Stevenson. Déjà l’imaginaire emporte le marcheur et le délivre des tracas en le projetant dans un temps libéré des tensions du quotidien.
Pour d’autres leur aspiration à partir est un ajout à leur goût de vivre, une recherche paisible d’intensité d’être, un renouvellement que le rêve du prochain départ rend déjà tangible. Certaines étapes du parcours titillent le marcheur bien avant qu’il ne les atteigne. Il les voit déjà dans son univers intérieur. Le jeune Laurie Lee marche une année entière en Espagne, en 1935, à la veille de la guerre civile, le long des sentiers de transhumance et des chemins muletiers de Vigo jusqu’en Andalousie. Il chemine sans fin dans son rêve : “Depuis ma plus tendre enfance, je m’étais imaginé en train de marcher un jour le long d’une route blanche de poussière qui, à travers de splendides orangeraies me conduirait jusqu’à une cité qui avait nom Séville” (Lee, 1994, 176). Ses songes d’enfant l’emmenaient loin de la grisaille de sa région natale dans l’ouest de l’Angleterre. Avant de partir dans le massif du Cézallier en Auvergne, le moine bénédictin François Cassingena-Trévedy se souvient de son bonheur à arpenter les cartes en imagination, à préfigurer les découvertes qui seraient sur son chemin. Les cartes de randonnées de l’IGN “concurrencent irrésistiblement toute autre lecture, et il arrivait parfois que le sommeil me surprît au beau milieu de mes investigations, de leurs détails, de mon questionnement de leurs secrets (…). La région du mont Chamaroux, signalée sur le papier par un grisé plus sensible, exerçait sur moi une fascination certaine, et je me sentais dévisagé par les deux taches bleues, presque circulaires, des lacs jumeaux de la Godivelle” (2016, 27-28). Mais le désir d’aller ailleurs à pied fait feu de tout bois. Pour Antoine de Baecque, sa traversée des Alpes commence bien en amont par la lecture d’un article : “Cela faisait une bonne quinzaine d’années que je désirais effectuer cette marche, depuis que j’avais lu, en date du jeudi 12 août 1993, un article de Libération intitulé ‘Rêveries du randonneur solitaire’, consacré à Roger Beaumont, qui s’était immédiatement métamorphosé pour moi en figure mythique. Il me fallait marcher sur ses pas” (2018, 29). Quant à moi, j’avais autour de 8 ans au Mans, et j’ai lu un jour un article sur l’Amazonie dans le journal Ouest-France qui m’a ébloui. Le journaliste y évoquait un monde où vivaient encore des populations amérindiennes que nos sociétés ignoraient encore. Le désir d’Amazonie m’a saisi, celui d’un lieu où disparaître enfin ou recommencer. Aujourd’hui encore je revois cet article. Même si à l’époque je ne pensais pas tant y marcher, mon rêve du Brésil est né ce jour-là. Comme le désir de se rendre à Compostelle naît du récit de quelqu’un qui en revient et évoque des moments d’éblouissements que l’on souhaite connaître à son tour. Souvent les longues marches sont précédées par le récit de passeurs dont les histoires pénètrent en profondeur en soi en créant un appel d’air, un désir de liberté, de découverte. Un documentaire, un film, un roman, une parole entendue quelque part éveille soudain un désir d’ailleurs longtemps enfoui mais qu’une image cristallise. Ensuite les événements de la vie, les rencontres amènent ou non à son accomplissement. Même s’il ne se réalise pas, il continue à nourrir les rêveries, et d’autres marches, en des lieux plus accessibles peut-être, sont autant d’approches successives à son propos.
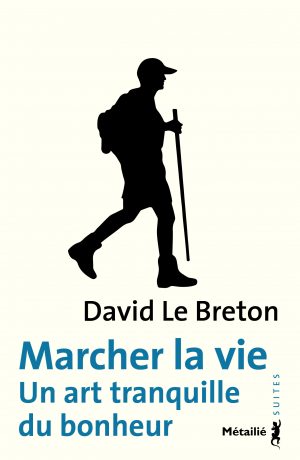








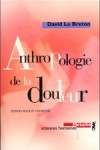





-100x150.jpg)
-100x150.jpg)



 (s)-100x150.jpg)



