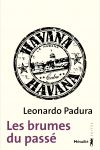2016. La Havane reçoit Barack Obama, les Rolling Stones et un défilé Chanel. L’effervescence dans l’île est à son comble. Les touristes arrivent en masse. Mario Conde, ancien flic devenu bouquiniste, toujours sceptique et ironique, pense que, comme tous les ouragans tropicaux qui traversent l’île, celui-ci aussi va s’en aller sans que rien n’ait changé.
La police débordée fait appel à lui pour mener une enquête sur le meurtre d’un haut fonctionnaire de la culture de la Révolution, censeur impitoyable. Tous les artistes dont il a brisé la vie sont des coupables potentiels et Conde a peur de se sentir plus proche des meurtriers que du mort…
Sur la machine à écrire de Mario Conde, un texte prend forme : en 1910, la comète de Halley menace la Terre et un autre ouragan tropical s’abat sur La Havane : une guerre entre des proxénètes français et cubains, avec à la tête de ces derniers Alberto Yarini, un fils de très bonne famille et tenancier de bordel prêt à devenir président de la toute nouvelle République de Cuba.
Le présent et le passé ont et auront toujours des liens insoupçonnés.
Pour sa dixième enquête de Mario Conde, Leonardo Padura écrit un grand roman plein d’humour et de mélancolie, un voyage éblouissant dans le temps et dans l’histoire.
-
"Avec un humour noir mordant, une tendresse amusée à l’égard de son personnage de vieux briscard revenu de tout et une intrigue politique finement orchestrée et très prenante qui fait alterner les époques, Padura mêle habilement roman policier et roman historique pour livrer un portrait mélancolique et passionnant de la société cubaine d’hier et d’aujourd’hui, tiraillée entre ses espoirs et ses désillusions, toujours traversée par ces ”ouragans tropicaux“, remous passagers et inconstants de l’Histoire."Alexandra VillonPage des libraires - Librairie La Madeleine
-
"L’avis est tranché, strictement personnel mais a priori définitif : la meilleure littérature criminelle est définitivement issue de l’Amérique centrale et en l’espèce de Cuba, avec la dixième enquête, déjà, de Mario Conde, l’ex-flic devenu bouquiniste -et écrivain à ses heures. L’île, depuis ses débuts, a bien changé, voire régressé, contrairement à l’ironie et la formidable écriture, entre érudition, gravité et humour, de son génie de géniteur Leonardo Padura. À la fois perle, petit-lait et caviar !"Olivier Van VaerenberghFocus Vif (Belgique)
-
"Comme souvent, Padura veut moins faire monter l’adrénaline que nous plonger dans un (double) univers dont il explore avec une déconcertante maestria toutes les dimensions (politique, intime, sociale...) devant nos yeux ébaubis."Minh Tran HuyMadame Figaro
-
« L’écrivain cubain nous offre un de ses meilleurs romans sur les méandres du pouvoir et les bas-fonds de l’île communiste. » « Un roman au souffle puissant. »Thierry ClermontLe Figaro littéraire
-
« Dans ce livre à énigmes passionnant et souvent très drôle, l’écrivain cubain mêle deux intrigues captivantes pour mieux nous parler de cette île à l’histoire si complexe et singulière. »Héloïse RoccaVersion Femina
-
"Récit polyphonique, irrigué par les sentiments, les émotions et les couleurs, c’est aussi une réflexion sur ce que signifie être honnête pour un policier et sur les espoirs soulevés par des changements vécus tels des ouragans."Isabelle WagnerRéforme
-
"Une belle plongée dans La Havane d’hier et d’aujourd’hui et, par-dessus tout, une nouvelle preuve du grand talent de Leonardo Padura."Denis JouanLe Phare de Ré
-
"Finesse des relations humaines, force - toujours - de l’amitié, regard attendri sur ce peuple joyeux soumis aux pires exactions, humour de situation, Ouragans tropicaux confirme, après le déchirant Poussière dans le vent (2021), que l’auteur d’Electre à La Havane, parvient à une certaine grâce dans ses romans."Christophe LaurentCorse matin
-
Ecouter le podcast de l'émission iciOlivier VerstraeteRCV 99 FM
-
Lire l'entretien avec Leonardo Padura iciSonia Dayan-HerzbrunSite En attendant Nadeau
-
"Un roman absolument magnifique entre fiction, Histoire et… ouragans."L'AlsaceJacques Lindecker
-
"Pour la dixième enquête de l’ironique Mario Condé, l’auteur de Poussière dans le vent nous entraîne au sommet de son art, à la croisée du roman noir et du roman historique, dans un tourbillon tout à la fois drôle et mélancolique, qui plonge au plus profond des entrailles de Cuba."Victoria GairinLe Point
-
"Un formidable plaisir de lecture, passionnant roman tout à la fois noir, historique, social et politique, foisonnant, et parfaitement conté avec cette saveur douce-amère qui fait le charme de l’auteur. […] Ouragans tropicaux est éblouissant par sa finesse et l’acuité de son esprit."Michel AbescatFrance Inter - Le Polar sonne toujours deux fois
-
"L’un des meilleurs livres de Leonardo Padura, l’une des meilleures enquêtes de Mario Conde." Ecouter le podcast de l'émission ici (à partir de 13'10)Julien BissonFrance Inter - Grand bien vous fasse
-
"Avec cette dixième aventure de son célèbre commissaire, Leonardo Padura signe un roman en abyme à l'écriture jubilatoire et subtilement ironique."Béatrice SarrotL'Amateur de cigare
-
"Sous un vernis de roman policier, Leonardo Padura montre dans « Ouragans tropicaux » un peuple cubain dont le régime communiste a rongé la santé mentale et sociale, et qui ne rêve plus que de fuir et s’exiler. Brillant." Lire l'article iciSite Ernest Mag
-
"Une double lecture bien rythmée qui donne une certaine épaisseur à la joie des retrouvailles avec le Conde."Boris Senff24 heures Lausanne
-
"Leonardo Padura signe ici l'un de ses romans les plus puissants, mais aussi l'un de ceux où l’enquête policière est la plus captivante."Sophie PujasAlibi
-
"Présent et passé, réalité et fiction s'entremêlent dans un récit somptueux qui narre avec humour et mélancolie les bouleversements de la société cubaine et les ravages que le temps impose à la ville et à ses protagonistes?" Lire l'article iciIsabelle LesniakLes Echos
-
"Ouragans tropicaux est un grand et double roman-feuilleton, dans le genre des Mystères de Paris, et, comme l’œuvre d’Eugène Sue, avec ses multiples rebondissements, c’est un état des lieux sociaux et un livre politique."Philippe LançonLibération
-
"Une plongée haletante dans les milieux artistiques - et crapuleux - de Cuba qui, pourtant, ne détourne pas Mario Conde de son vieux projet de roman. Ses chapitres, qui s’intercalent entre ceux de l’enquête, nous ramènent dans le Cuba des années 1910, où l’on croise la comète de Halley et l’ombre de Napoléon."Marianne MeunierLa Croix
-
"Leonardo Padura constitue un précieux sujet d’observation pour le critique-laborantin, tant il a su réaliser la synthèse si rare, mais indispensable à quiconque aspire à toucher à quelque chose de l’essence de l’art romanesque."Damien AubelTransfuge
-
"Ce balancement entre deux époques, deux régimes, deux enquêtes, entre un vieil et un jeune policier, loin de donner le tournis, fait resurgir les liens indélébiles agrafant le passé au présent, comme un insecte sur du papier tue-mouche. Leonardo Padura en fait la chronique avec toute l’humanité, la bienveillance et la lucidité possibles."Béatrice ArvetLa Semaine
la vida es un delirio !
¡ Ay, amor,
esta isla es un suicidio !
¡ Ay, amor !
Jorgito Kamankola
1
– Trop tard, conclut-il.
Il s’en souvenait. Il s’en souvenait encore. Il avait oublié beaucoup d’autres choses d’une vie qui était en train de devenir effroyablement longue, et il savait que certains oublis fonctionnent comme une stratégie de survie : il s’imposait de lâcher du lest pour demeurer à flot et ne pas rester échoué dans les rancœurs, le décompte des illusions tronquées, l’évocation urticante de promesses crues un jour et si souvent non tenues. Même un type tel que lui, un acharné du souvenir, un quasi hypermnésique, était bien forcé de laisser sa conscience balayer certaines choses, procéder à des nettoyages émotionnels et psychologiques pour des motifs d’hygiène, afin d’empêcher le poids des réminiscences de l’engloutir dans la vase des aversions et des frustrations. Et, surtout, pour ne pas avoir à se dire qu’une autre vie aurait été possible, et que la vie vécue avait été une erreur, mélange de fautes dont il était responsable et de choses imposées de l’extérieur.
Mais ce concours de circonstances là, presque une révélation mystique, bien sûr qu’il s’en souvenait, qu’il fallait qu’il s’en souvienne. Il était même capable de reconstituer la scène avec des couleurs si vives et une telle précision dans les détails, assaisonnée parfois de gouttes de colère ou d’éclaboussures de nostalgie, qu’il en venait parfois à soupçonner que, en réalité, la scène n’avait pas la densité de nuances avec laquelle il la reconstruisait aujourd’hui. Était-ce vraiment ainsi que cela s’était passé, avec ce scénario et ces protagonistes ?… Pourtant, s’il y avait une chose dont il était pleinement convaincu, c’était que l’essence de cette rencontre glorieuse était restée imperméable aux érosions prévisibles, préservée dans ce recoin éclairé de la mémoire qui abrite les repères initiatiques : les initiations à l’amour, à la littérature, à la peur et à la première grande déception. Et à Dieu, pour ceux qui en font l’expérience.
Motivito était une figure du quartier. Tous les garçons et, mieux encore, toutes les filles connaissaient son existence. Cela faisait longtemps que Mario Conde était incapable de répéter le véritable nom du jeune homme, et cet oubli ponctuel – c’est ainsi que le champion de la mémoire le voyait – ajoutait de l’authenticité à son évocation. Motivito était Motivito, point. L’intéressé avait toujours en perspective une fête où apporter la musique qu’il tenait en réserve et, pour évoquer ces réjouissances, célébrations, fiestas et autres bringues plus ou moins fréquentées, organisées (ou désorganisées) en général les samedis soir, le jeune homme les désignait sous le terme de “motivitos”. Aujourd’hui je vais à un motivito, demain j’ai un motivito, répétait-il, ce qui signifiait tout simplement un “motif” pour faire la fête. Et comme il possédait la meilleure musique, la plus récente, celle qui rendait tout le monde dingue, il était l’ingrédient le plus important de ces réunions festives.
Pour être à la hauteur de sa popularité et de son prestige, Motivito avait construit son look avec les tenues et les accessoires dictés par la modernité des années 1960 : il portait des sandales en cuir sans chaussettes, des pantalons ultra moulants, des chemises amples et colorées avec un col ouvert en pointe, un bracelet clouté, il utilisait de vieilles lunettes rondes sans monture avec des verres de couleur verte, et il se coiffait avec une raie au milieu, les cheveux collés sur le crâne grâce à un produit chimique à l’efficacité redoutable, car Motivito était un métis et ses cheveux ne devaient pas être particulièrement faciles à dompter. Motivito était ce qu’on appelait un parfait pepillo, un dandy.
Le jour de sa grande rencontre avec Motivito, Mario Conde avait dans les huit ou neuf ans, on devait donc être en 1964, la grande Année de l’Économie. C’était comique ! L’année précédente avait été baptisée l’Année de l’Organisation, et la suivante devait être l’Année de l’Agriculture, tandis que le pays était déjà venu à bout de l’Année de la Planification. Un demi-siècle plus tard, ironie du sort, sur l’île on parlait encore des désastres nationaux de l’Économie, de la Planification, de l’Organisation, tandis que l’Agriculture insulaire n’était toujours pas parvenue à ce qu’il y ait à nouveau assez de patates douces, d’avocats, de bananes et de goyaves sur les marchés cubains.
Ce soir-là, il devait faire froid car la porte de chez lui, qui était d’habitude grand ouverte, était fermée quand on y avait frappé en même temps qu’on sifflait. Il était allé lui-même ouvrir pour se retrouver nez à nez avec son cousin Juan Antonio, de quatre ans son aîné… accompagné de Motivito !
– Salut, mec, ça va ? avait commencé le cousin, et profitant de l’importance qui lui offrait l’occasion, il avait aussitôt ajouté : Et, au fait, votre tourne-disque, il marche encore ?
Tout à son ravissement, l’enfant Mario Conde avait hoché la tête. Chez lui, aussi loin qu’il s’en souvenait, il y avait un tourne-disque rca Victor, modèle compact, acheté par son père quelques années plus tôt au défunt magasin Sears de La Havane.
– L’aiguille du mien est fichue, a poursuivi le cousin, et Motivito a besoin d’essayer une plaque qu’on veut lui vendre.
Conde avait de nouveau hoché la tête. Tout en écoutant un Juan Antonio aussi désagréable que toujours, il avait les yeux fixés sur le mythique Motivito, le plus dandy des dandys du quartier, qui était là, près de lui, chez lui, en train de mâcher ce qui pouvait être un chewing-gum (merde, d’où avait-il bien pu le sortir ?) et… pour lui demander un service, à ce qu’il comprenait.
Toujours sans oser dire un mot, Conde avait fait entrer les visiteurs. Dans son souvenir de cette nuit initiatique, ses parents ne figuraient nulle part et, dans la scène suivante, il allait chercher la mallette du tourne-disque, passait la main dessus pour enlever la poussière, l’ouvrait, le branchait, vérifiait que le plateau tournait, et tout cela le faisait se sentir important, élu, même si Motivito ne lui avait pas adressé la parole, à peine un regard, même s’il pouvait parfaitement entendre le Roi des Dandys du quartier expliquer à son cousin Juanito que cette plaque on voulait la lui vendre pour vingt pesos, un paquet de fric, et qu’il fallait qu’elle soit impeccablement gravée pour justifier un prix pareil.
Ce soir-là, parmi d’autres vérités transcendantes et inoubliables, Mario Conde avait appris ce qu’était une plaque. Comme le marché du disque à Cuba battait de l’aile et que, bien entendu, on avait cessé d’importer des microsillons, l’inventivité nationale avait réussi l’un de ses plus mémorables succès technologiques : rendre inutilisables les sillons des vieux 33 et 78 tours et, par des méthodes mystérieuses, les recouvrir de plaques de vinyle sur lesquelles on gravait la musique d’autres disques venus de l’au-delà (le monde capitaliste, aliéné et corrompu) pour leur permettre d’écouter les interprètes à la mode. Les plaques (ainsi qu’on les appelait, et qui pouvaient aussi être collées sur un support en carton rigide) avaient également pour mission de répandre parmi la jeunesse la musique créée dans l’au-delà (ce même monde capitaliste, etc., etc.), les chansons pratiquement (et dans certains cas totalement) interdites sur les radios nationales parce qu’elles étaient vues comme une forme de pénétration idéologique (une contamination insidieuse promue depuis le fameux monde des funestes et cetera), car Quelqu’un les estimait nocives, très nocives, pour les consciences des hommes nouveaux en formation accélérée et assurée sur l’île, ces êtres modèles censés se consacrer opiniâtrement à trois tâches et un destin lumineux : Étude, Travail, Fusil… Venceremos !
Quand l’électrophone avait été prêt, Motivito avait eu l’insigne bonté de s’adresser au Mario Conde de huit ou neuf ans pétrifié sur place, pour continuer à nourrir un souvenir indélébile.
– Petit… ce que tu vas écouter… si on écoute quelque chose… pratiquement personne ne l’a écouté, ni sur l’île de Cuba ni sur les îlots adjacents… Cela nous arrive tout droit du Iounaï Kindom et… bon, tu as entendu parler des Beatles ?
Conde, toujours incapable de prononcer un mot, avait secoué la tête.
Motivito avait rigolé. Même le cousin Juan Antonio avait rigolé… Ha, ha, ha… L’ignorance de l’enfant les faisait rire.
– Y a rien de mieux au monde, fiston. Ces types c’est… c’est le top ! s’était exclamé Motivito après avoir lissé ses cheveux à deux mains, en posant enfin tendrement la précieuse plaque sur le plateau du tourne-disque, en actionnant le bouton qui faisait tourner le plastique noir et en baissant délicatement le bras pour placer l’aiguille sur le premier sillon… Attente. Un crash, un autre, un autre… et le miracle avait eu lieu :
It’s been a hard day’s night,
And I’ve been working like a dog…
Conde n’avait strictement rien compris aux paroles. Mais il avait immédiatement perçu que quelque chose le pénétrait, une osmose virale, irrémédiable, et il avait aussi été capable de voir comment son cousin ouvrait la bouche comme le trou du cul qu’il était (qu’il est toujours) et il avait pu observer Motivito, les yeux aussitôt humides d’émotion et d’extase esthétique.
C’est à cet instant précis, le soir de ce jour (the day’s night) que, sans deviner encore la portée de ce qui était en train de lui arriver, mais en sachant que quelque chose de grand était en train de lui arriver, Mario Conde avait traversé une frontière qui rendait impossible tout retour en arrière, à jamais : le côté enchanté du miroir où l’avait transporté Motivito avec sa plaque gagnante contenant plusieurs chansons de l’album A Hard Day’s Night, en l’an 1964, Année de l’Économie. Le territoire sacré des initiés. La terre qui avait été interdite par les décrets des illuminés, déterminés à forger des consciences supérieures, ces démiurges, ou leurs successeurs de service, qui en ce moment même se chargeaient d’annoncer, sans honte et en s’en réjouissant, avec tous les flonflons de rigueur, que les Rolling Stones seraient bientôt à La Havane pour y offrir un concert en cet étrange printemps cubain de 2016.
C’est pour cela que, plus de cinquante ans après avoir effectué ce voyage magique et mystérieux, alors que Mario Conde était déjà un vieux de merde, son cousin Juan Antonio un trou du cul de vioque, et que Motivito avait disparu de la mémoire de tout le monde (sauf de celle du gamin qui lui avait un jour prêté un tourne-disque et se demandait de temps en temps à quoi bordel avait bien pu ressembler la vie de Motivito), le Conde, ce souvenir dévoilé, proclama sa rébellion :
– Oui, Flaco, trop tard, répéta-t-il avant de vider le fond de son verre de rhum et de réclamer à son ami Carlos qu’il lui en serve un autre. Verse, verse ! Merde, tu le sais, toi, qu’on ne me laissait pas les écouter, ni eux ni les autres, quand je voulais les écouter, quand il fallait que je les écoute. Quand il n’y avait rien de plus important que les écouter. Et ce jour-là je n’aurais même pas écouté les Beatles si, chez moi, il n’y avait pas eu de tourne-disque et si mon cousin Juanito n’avait pas été camarade de classe de Motivito.
– Conde… tu sais combien de fois tu m’as raconté cette histoire de Motivito et de la plaque des Beatles ? Et le nombre de fois où tu l’as changée ? C’est pas Tomy Malacara qui avait apporté chez toi une plaque avec “Strawberry Fields”… ?
Conde fit d’abord non, puis oui de la tête. Oui, il était possible qu’il ait modifié quelque chose, parce que cette histoire lointaine avait connu des ajouts et des variantes au fil du temps. Et elle était devenue plus pleine et plus intense, plus urticante, quand dix ou quinze ans plus tôt, à une époque où beaucoup se comportaient comme s’ils n’avaient jamais connu d’interdictions et de censures, un sculpteur cubain connu, qui se consacrait entre autres tâches à créer des bronzes de personnages mémorables, avait coulé une statue de John Lennon qui avait été placée dans un parc de La Havane. Qui plus est en grande pompe : comme s’il ne s’était jamais rien passé avec Lennon, McCartney, Mick Jagger ou les Fogerty de Creedence (John ou Tom, peu importe, l’un d’eux était celui qui chantait comme un noir, ou comme Dieu).
Soudain (sans que personne ne bouge le moindre muscle du visage), l’un des Antéchrists des années débordant de promesses pour l’Économie, l’Agriculture et la Planification se retrouvait sanctifié en figure de la contre-culture, presque un bolchevique de la musique du xxe siècle, et Quelqu’un trouvait ça bien, et même très bien… Mais pas le Conde. Fidèle à ses rancunes, déterminé à ne pas s’autoriser un oubli pareil, il avait décidé depuis de ne jamais mettre les pieds dans le parc en question, car ce grand saint de bronze officialisé n’était pas le Lennon maudit des grandes découvertes effectuées à des époques de grande rigueur et même de planification et d’organisation de ce qu’avaient le droit d’écouter, ou pas, les jeunes comme lui.
– C’est vrai, vieux, je te l’ai racontée au moins deux mille fois… et oui, c’est vrai, il est possible que je la change ou que je confonde, mais c’est pas grave… Le pire, c’est que les Stones vont débarquer à Cuba, et tu sais quoi ? Vu où on en est, j’en ai rien à foutre, tout comme je me fiche de me barrer en Alaska… Ces rêves… et plein d’autres, ils me les ont foutus en l’air… Flaco, je suis désolé pour toi qui es à fond, mais moi je n’ai pas l’intention d’aller les voir. I can’t get no… Maintenant ils peuvent se les foutre au cul, avec les guitares en plus.
Quelque chose était en train d’arriver, quelque chose qui désirait arriver, et La Havane petit à petit arrêtait de ressembler à La Havane. Ou plutôt, rectifia le Conde, la ville commençait à se rapprocher de ce que pouvait avoir de mieux La Havane, cette cité envoûtante, aux parfums, lumières, ténèbres et pestilences extrêmes, l’endroit du monde où il était né et où il lui avait été donné d’habiter durant ses soixante et quelques années de résidence terrestre.
On percevait comme une aura bénéfique palpable dans l’air. Peut-être un état de joie, d’espoirs, une atmosphère de changements ou du moins de désirs de changements, un besoin de retrouver la possibilité de rêver, après tant de nuits d’insomnie. Après de longues années de pénuries croissantes et de pertes de perspectives, les expectatives se mettaient à nouveau en mouvement, des projets naissaient, et les gens, tout épuisés qu’ils étaient, avaient envie de croire.
Conde n’avait pas trop d’efforts à faire pour constater les changements à l’œuvre tout autour de lui. À bord d’une Oldsmobile 1951 au moteur, à la peinture et à l’intérieur refaits devenue taxi sur le trajet entre son quartier périphérique et le Vedado, il suffisait au libraire d’écouter ses compagnons de voyage évoquer tout un tas de souhaits et de projets élaborés avec soin.
Le plan du passager à tête de cheval avec des colliers de santería autour du cou lui sembla technologiquement osé, puisqu’il se proposait de couper le toit de sa Chevrolet 1956 pour la transformer en décapotable et la louer à des touristes “yankees”, ce sont ceux qui paient le mieux, assurait-il, et ils te refilent même d’énormes pourboires. Il trouva évidente la ténacité de la quadragénaire surmaquillée, qui commentait les bonnes affaires réalisées grâce à son dernier voyage au Panamá pour importer des piles triple a, des strings calienticos, ceux qui laissent les trois quarts du cul à l’air, et des cartons de faux ongles chinois avec de petits dessins, de ceux que portent toutes les filles aujourd’hui. Plus démoralisant, classique et réaliste, le projet du jeune ingénieur devenu barman dans un hôtel fréquenté par des étrangers qui était en train d’amasser un petit capital pour émigrer en Espagne, parce que même s’il est vrai qu’en ce moment c’est pas mal, ça se cassera la gueule d’ici peu, comme toujours, affirmait-il, tout en demandant au passage à la quadragénaire si elle portait elle-même l’un de ces calienticos, et la vicelarde lui répondait, ben oui, rouge et avec de la dentelle, en bonne fille de Chango, la divinité de la santería. Et plus utopique (jusqu’où est arrivée l’utopie) lui sembla l’aspiration du chauffeur, un noir avec des bras de docker qui, avec des billets de cinq, dix et vingt pesos pliés en longueur et glissés selon leur montant entre les doigts de la main gauche, conduisait avec seulement la droite cette machine à remonter le temps, plus à sa place dans une bd de Dick Tracy que dans l’année 2016 où ils vivaient. Et le type avouait qu’il travaillait douze heures par jour derrière ce volant, car l’Oldsmobile, en fait, appartenait à l’exploiteur capitaliste qu’était son beau-frère, mais lui aspirait à s’en acheter une plus ou moins pareille et alors, alors, à lui la belle vie ! Il chercherait un autre noir dans la merde comme lui pour travailler à sa place et lui rapporter cinq cents pesos par jour, pendant que lui, le noir chanceux, parvenu à l’échelon d’exploiteur capitaliste, resterait tranquillement chez lui à regarder les matchs de base-ball des Industriales et le Barça au foot, avec bien sûr une bière blonde dans une main et une vraie blonde en chair et en os dans l’autre, parce que comme vous le savez, les blondes adorent le chocolat bien épais et… Chimères, envies, espoirs…
Pourtant, dans les rues qu’ils parcouraient, où ondulaient déjà des drapeaux et se dressaient des panneaux annonçant l’imminent et historique Congrès du Parti (spécifier lequel est obsolète), et appelant déjà à la manifestation également historique du 1er Mai, jour des Travailleurs, Conde voyait pulluler des vieux aux sandales usées et aux regards mornes, à la recherche des misérables produits à la portée de leurs retraites, de plus en plus réduites par les coûts stratosphériques de la vie.
Des femmes aux embonpoints trompeurs, gavées de farine et de riz aux haricots noirs, moulées dans des lycras qui avaient du mal à contenir leurs masses flasques saturées de mauvais cholestérol, en quête acharnée du pain quotidien. Des jeunes aux tonsures bizarres, aux regards furibonds, aux mimiques exagérées de fans de reggaeton vivant de ce qu’ils trouvaient… Les innombrables habitants de la ville qui n’avaient pas trouvé leur place dans la queue des rêves. La part majoritaire dans laquelle il militait lui-même.
Depuis des années, le commerce de l’achat-vente de livres que Mario Conde avait pratiqué dès qu’il avait quitté son boulot d’enquêteur de police, presque trente ans plus tôt, s’était asséché, comme un arbre que l’on priverait de soleil et d’eau. La découverte, de plus en plus sporadique, d’une bibliothèque appétissante (la dernière alléchante avait été, presque un an plus tôt, celle du défunt écrivain x, vendue jusqu’à la dernière page par sa fille sans cœur, un lot qui comprenait des papiers qui avaient heurté la sensibilité de Conde) l’avait obligé à diversifier ses aires d’influence, et à présent il achetait de tout : fripes, matériel électrique hors d’usage, services de vaisselle incomplets, guitares sans chevilles… tout ce qu’il pouvait porter à son ami Barbarito Esmeril, qui était ensuite capable de revendre n’importe quoi, avec toujours un bénéfice. Ce travail de sangsue, qui l’épuisait physiquement et le dévastait moralement, suffisait à peine à lui maintenir la tête hors de l’eau, ce qui l’obligeait à accepter n’importe quel genre de mission, comme celle que, sans lui donner de détails, lui avait proposée son vieil ami Yoyi le Palomo, qui l’attendait dans les locaux de sa nouvelle affaire : un bar-restaurant destiné à une clientèle de touristes de passage, de nouveaux riches locaux et des immanquables, indispensables, serviables putains de la dernière promotion d’une industrie nationale qui avait été revitalisée par la crise fatale des années 1990.
Avec l’habileté commerciale et le pragmatisme que le Conde lui enviait, son ancien associé dans l’achat-vente de livres rares et bien cotés avait toujours su détecter les ouvertures du moment, et Yoyi était à présent propriétaire (en fait seulement co-) de cet endroit qui, d’après ce que savait Conde, était devenu un des lieux favoris de la clientèle argentée qui faisait aussi partie de la nouvelle démographie de la ville.
Depuis le trottoir d’en face, le Conde étudia les lieux : le néon, éteint à cette heure, annonçait clairement la couleur : la dulce vida. La vaste demeure, qui se trouvait dans un quartier autrefois aristocratique, témoignait de l’opulence dans laquelle avaient dû vivre ses anciens propriétaires, dans les années 1940, quand le bâtiment avait été construit. Un espace pour le jardin, un large portail, l’entrée pour les voitures, les hautes portes et les fenêtres avec des barreaux en fer forgé, les sols en marbre, les chapiteaux doriques qui détonnaient dans une structure plus proche de l’Art déco : l’éclectisme au service de l’exhibition du luxe.
Les propriétaires actuels de la grande maison étaient deux frères, médecins à la retraite, fils de combattants prolétaires qui avaient bénéficié, soixante ans plus tôt, de la confiscation de la demeure quand ses propriétaires d’origine avaient quitté l’île. Et aujourd’hui les deux médecins, récompensés par des pensions insuffisantes, survivaient grâce à la location de l’immeuble à Yoyi et son associé, l’Homme Invisible, fils de Quelqu’un avec du pouvoir et, par conséquent, obligé de rester dans de ridicules ténèbres entrepreneuriales : car, comme le Conde allait pouvoir très vite le constater, par sa présence presque quotidienne au bar de l’endroit, toujours collé à la pute de service et avec les consommations offertes, l’Homme Invisible était plus repérable qu’un éléphant peint en vert.
Les employés et les serveurs étaient déjà en train de préparer la salle pour le service du déjeuner, et l’un d’eux, à l’ombre du poster de La Dolce Vita où l’on voit Mastroianni mater la croupe splendide d’Anita Ekberg, lui indiqua où trouver le Man, qui était apparemment le nom qui leur servait à désigner le Palomo. Conde s’avança dans un hall au sol en damier qui ressemblait à une avenue et chercha le bureau situé juste en face de la cuisine, d’où s’échappaient déjà des effluves enveloppants de haricots noirs à point, des parfums de marinades pour le manioc et des arômes de fonds de sauce pour les viandes, toutes odeurs responsables de la rébellion immédiate des glandes et viscères du nouvel arrivant.
Derrière son laptop, Yoyi examinait quelque chose sur son écran.
– Entre, man, dit-il sans lever les yeux.
En silence, Conde étudia la pièce : elle ressemblait à un bureau typique où ne manquaient ni le calendrier ni le petit coffre-fort. Ses neurones, cependant, ne lui permirent pas d’en analyser beaucoup plus : le soulèvement gastrique continuait de le harceler. Yoyi referma alors son ordinateur portable et lui sourit :
– C’est quoi cette tête de con, man ?
– C’est la tête de quelqu’un qui a faim. Cette odeur me tue.
– T’as pas pris de petit-déj ?
– Un jus de chaussette allongé. Aujourd’hui, il ne me restait même pas un vieux bout de pain…
Yoyi sourit un peu plus et, en un geste habituel, bougea la main au poignet de laquelle il portait la montre avec un bracelet en or. Comme il commençait à se dégarnir, Yoyi, déjà quadragénaire, se rasait à présent le crâne, qui brillait comme une ampoule.
– On va régler ça, dit-il, avant de lancer : Participe Présent !
Conde haussa les sourcils. De la grammaire à cette heure-ci, alors qu’il était affamé ?
Un métis muni d’un tablier blanc immaculé passa la tête dans l’encadrement :
– Écoutant.
– Peux-tu, s’il te plaît, préparer un sandwich cubain double pour mon pote. Et un milk-shake de mamey, un vrai. Ensuite tu nous porteras une cafetière avec du bon café fraîchement moulu.
– Comprenant et y allant. – Au moment de sortir, il se retourna. – Monsieur mourant de faim, hein ? lança-t-il à Conde, qui n’eut pas besoin de demander la raison de son surnom.
– Mais tu vas les chercher où, Yoyi ? se sentit-il obligé de demander quand l’autre eut disparu dans la cuisine.
– Je n’ai pas à les chercher, ils sortent tout seuls de sous la terre… Tu n’as jamais entendu la chanson qui dit qu’à La Havane, ce ne sont pas les fous qui manquent ? Eh ben c’est vrai, man. Ici, presque tout le monde a un grain… Cent cinquante années de combat et soixante ans de blocus, ça fait un paquet d’années…
Conde hocha la tête. Lui-même se sentait à moitié dérangé.
– Et comment vont les affaires ?
Yoyi écarta les bras et le bréchet de sa poitrine de pigeon pointa en direction des yeux de son interlocuteur.
– Du tonnerre de Dieu, comme on dit en Galice… Avec la flopée de gringos qui débarquent à Cuba, je te dis pas comme ça marche, man. On est complets tous les soirs et il n’y a pas de meilleurs clients que les Américains.
– Oui, on m’a dit ça. Ils laissent même des pourboires…
– Oui, oui, ils paient sans discuter et après ils laissent dix, quinze et quelquefois vingt pour cent de pourboire… Tu crois qu’ils ont reçu une directive du Parti ? – Yoyi sourit, content de sa plaisanterie. – Pour nous pénétrer idéologiquement ? Oui, c’est sûrement un plan de la cia et c’est Obama qui a fait passer la directive.
– Le black, il arrive quand ?
– Je ne sais pas, dans quelques jours… Tu imagines ce que ça va être, man ? Obama, les Rolling Stones, Chanel, les mecs de Fast and Furious… Une tripotée de gringos avec du fric et avec l’envie de le claquer. Même Rihanna et les sœurs Kardashian sont dans le coin…
– C’est qui, celles-là ?
Le crâne rasé de Yoyi brilla un peu plus.
– Comment ça ? Mais, mais… tu ne sais pas qui sont Rihanna et les Kardashian ? – Conde secoua la tête, en toute sincérité. – Je peux pas y croire, Rihanna elle est super canon et ces folles des Kardashian qui pensent qu’à se montrer à poil…
Conde secoua à nouveau la tête.
– Mais le sujet commence à m’intéresser. Et c’est quoi ton problème, alors ?
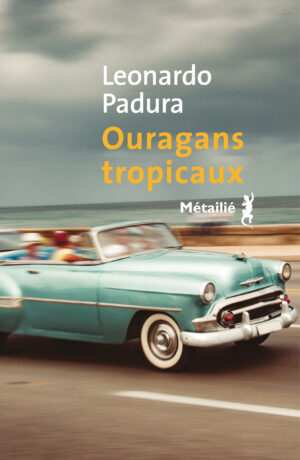






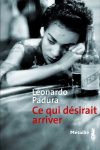

-100x150.jpg)