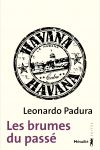Finaliste du Prix Médicis 2021 (catégorie roman étranger)
Finaliste du Prix Femina 2021 (catégorie roman étranger)
Sélection rentrée littéraire France Inter – Le Point
Sélection rentrée littéraire France Culture – L’Obs
Ils ont vingt ans. Elle arrive de New York, il vient de Cuba, ils s’aiment. Il lui montre une photo de groupe prise en 1990 dans le jardin de sa mère. Intriguée, elle va chercher à en savoir plus sur ces jeunes gens.
Ils étaient huit amis soudés depuis la fin du lycée. Les transformations du monde et leurs conséquences sur la vie à Cuba vont les affecter. Des grandes espérances jusqu’aux pénuries de la « Période spéciale » des années 90, après la chute du bloc soviétique, et à la dispersion dans l’exil à travers le monde. Certains vont disparaître, certains vont rester, certains vont partir.
Des personnages magnifiques, subtils et attachants, soumis au suspense permanent qu’est la vie à Cuba et aux péripéties universelles des amitiés, des amours et des trahisons.
Depuis son île, Leonardo Padura nous donne à voir le monde entier dans un roman universel. Son inventivité, sa maîtrise de l’intrigue et son sens aigu du suspense nous tiennent en haleine jusqu’au dernier chapitre.
Ce très grand roman sur l’exil et la perte, qui place son auteur au rang des plus grands écrivains actuels, est aussi une affirmation de la force de l’amitié, de l’instinct de survie et des loyautés profondes.
-
"Ma première impression : vouloir l’oublier pour le relire encore et encore. Une perle, entre Cuba dans les années 1990, les États Unis d’aujourd’hui, avec un peu de Madrid, Toulouse et Barcelone. J’aurais tellement aimé ne jamais quitter les personnages !! Alors prévoyez le 19 août pour l’acheter parce que ça, c’est un bijou à ne pas manquer !!"Ophélie Drezet
-
Padura nous parle de l'exil, de l'amitié avec une écriture captivante en partant de destins individuels pour nous révéler la grande histoire des humains.
Et peut-être est-ce un livre testament - pour lui qui n'a jamais quitté son île et qui utilise ses personnages pour nous faire comprendre pourquoi il est toujours demeuré là, malgré tout.
Un splendide, puissant, profond et subtil acte de littérature !!!
-
"Le Padura est un très grand livre, une fresque grandiose très difficile à lâcher, fabuleux !"Sébastien Lavy
-
Adela Fitzberg est une étudiante américaine. Elle aime Marcos, cubain. Un coup de foudre. Loreta Fitzberg, sa mère, est une vétérinaire d’origine cubaine. Elle doit piquer Ringo, un Cleveland Bay de 26 ans. Un coup de grâce. Mais ce n’est ni l’amour, ni la mort qui vont insuffler une tournure surprenante à leur destin respectif. Donnant voix à chacun des membres du Clan, huit amis de toujours, Padura embrasse l’histoire de Cuba depuis 1990. "Poussière dans le vent", le roman des exilés ? Certes, mais pas que… Avec son sens du détail, il nous livre le roman des spoliés et des illusionnés, des amoureux et des amis, des mères et d’une fille. Magistral !
-
"Voilà un roman magistral, addictif, traitant de l’exil, de la perte, de la peur du déclassement, de la filiation, de l’amitié et du désir vital de liberté. Le rythme et la construction de l’histoire sont d’une efficacité redoutable et le style unique de Padura fait des merveilles. C’est dense, intense, porté par des personnages incarnés et attachants. C’est un immense coup de cœur."Guillaume Chevalier
-
C’est le grand roman que l'on attendait de Padura sur ce thème de l'exil et de ceux qui ont quitté l’île dans les années 90. On retrouve dans « Poussière dans le vent » ce qui rend si attachant l'univers romanesque de ce grand écrivain cubain : le sens indéfectible de l'amitié, la famille (surtout celle qu'on se choisit), l'amour, les trahisons...Nicolas
-
"Cuba, huit amis très proches ont formé pendant des années un véritable "clan". Plus de vingt ans plus tard, beaucoup ont quitté Cuba, certains sont morts, d'autres disparus. Leurs enfants se croisent, se rencontrent... et certains se posent des questions sur la vie qu'ont menée leurs parents. Un roman passionnant et émouvant, une immersion passionnante dans le Cuba des trente dernières années. Ce grand roman sur l'exil traite à la fois d'amour et d'amitié ou de quête de liberté, dans un pays sous embargo où l'on manque de tout. Nous y découvrons la culture, l'âme cubaine, avec des personnages particulièrement attachants. Coup de coeur !"Frédérique
-
Chronique du roman ICICULTURE-TOPS
-
Entretien avec Leonardo Padura ICICahier des Livres
-
« Un des plus grands auteurs contemporains. » « Leonardo Padura livre une vaste et captivante peinture des mœurs et des humeurs de ses compatriotes. »Virginie Bloch-LainéElle
-
« Son portrait de groupe décline mille nuances de la perte et de recherche d’un nouvel Eden, qu’il soit du côté de l’art ou de la spiritualité. Car nostalgie et désenchantement, chez Padura, ne riment jamais avec désespoir. Dans ses pages, la sensualité, comme l’amour des nourritures terrestres, tient une place délectable. "Faire souffrir les personnages tout le temps, c’est bon pour Dostoïevski, pas pour un écrivain cubain !" Avant d’être perdu, tous les paradis ont eu le goût du bonheur. Et à Cuba peut-être plus qu’ailleurs. » - Découvrez l'article ICISophie PujasLe Point
-
" Poussière dans le vent de Leonardo Padura fait partie des 100 livres de l’année "Lire Magazine Littéraire
-
« Un récit d’une folle richesse. »Samuel LoutatyTélé Z
-
« Voilà le genre de livre qui vous accompagne longtemps. »Adrien GombeaudLes Echos
-
« Entomologiste hors pair, Leonardo Padura dissèque l’effondrement de son île, qui entre dans "un tunnel noir", autant que les désillusions qui s’emparent peu à peu des membres du clan. »Laurence PéanLa Croix
-
« Avec ce treizième roman Leonardo Padura donne le meilleur de lui-même. Un roman social et intime d’une grande ampleur. » Voir la chronique ICIChristian DesmeulesLe Devoir
-
"Un beau conte d’amours et d’amitiés, et un document précieux sur Cuba et la diaspora cubaine."Fred RobertZibeline
-
"Avec maestria, l’auteur dépeint un pays complexe et fragile, met en scène des personnages attachants, liés par une amitié fidèle et bafouée, et livre enfin une réflexion subtile sur l’exil. Sans oublier une dose maîtrisée de suspense qui rend ce roman addictif."Sylvie BulloTélé Loisirs Jeux
-
"Leonardo Padura investit avec intensité chaque protagoniste de son récit […] Il nous lie à ces destins comme s’ils étaient ceux de très proches connaissances."Pierre MauryLe Soir
-
"Poussière dans le vent est à la fois le roman de l'ailleurs et du quotidien de l'île, une fresque historique, où la nostalgie se noie dans le rhum. Un nouveau monument tendre et sans concession à son pays par l'auteur de L’Homme qui aimait les chiens."Yves ViollierLa Vie
-
"Un roman noir et joyeux à la fois, un roman choral classique mais inventif aussi par le style de cet écrivain qui est déjà inscrit au Panthéon des plus grands auteurs en langue espagnole."Marc FernandezAlibi
-
"Amours impossibles ou miraculeux, trahisons, mensonges..., Leonardo Padura joue avec maestria de toute la gamme des sentiments. Un magnifique roman-monde, nostalgique et profond, beau comme les plus grands mélodrames."Béatrice SarrotL'Amateur de cigare
-
"Une fresque subtile, et subtilement amenée, addictive, psychologique, sociologique, politique, qui n’oublie pas non plus de flirter du côté du roman noir et des petites intrigues sordides aux conséquences irrémédiables dans lesquelles se débattaient le fameux héros de nombre de ses précédents ouvrages, l’ex-flic devenu bouquiniste, Mario Conde."Daniel MurazLe Courrier picard
-
"Ceux qui connaissent l’écrivain le savait grand - L'Homme qui aimait les chiens; la série Mario Conde -. Mais ignoraient qu’il était immense."Fabrice NicolinoCharlie Hebdo
-
"Impressionnant de maîtrise et d’ampleur, Poussière dans le vent est une grande polyphonie sur Cuba."Damien AubelTransfuge
-
"Ce dernier roman exclusivement cubain est une passionnante réflexion quasi universelle sur le déchirement de l’exil et la perte de repères géographiques et politiques. Il se lit d’une traite et fera parler de lui au moment des prix littéraires."Marie-Aimée BonnefoyLa Charente libre
-
"Des pages hantées mais si vivantes, si vibrantes, qu’elles donnent l’impression, en les tournant, d’effleurer l’universel."Laëtitia FavroLe Journal du dimanche
-
"Avec Poussière dans le vent, l’écrivain cubain signe un roman somme magistral." Lire l'article iciAlain LéauthierMarianne
-
"Une vaste fresque ambitieuse, foisonnante de personnages."Thierry ClermontLe Figaro Littéraire
-
"Leonardo Padura signe un de ses plus grands romans, une saga dont la construction nous tient en haleine, où la complexité des hommes croise le fer avec le chaos du monde. Un roman d’une lucidité féroce et tendre qui conjugue idéal révolutionnaire, désenchantement, amour et amitié."Marie-José SirachL'Humanité
-
"Leonardo Padura signe avec Poussière dans le vent l’un de ses meilleurs romans, un récit bouleversant, plein d’humanité sur l’exil et la diaspora cubaine." Lire l'article iciElena PazQue tal Paris?
-
Ecouter le podcast de la chronique iciMarie-Ange Pinelli - Laetitia de la librairie l'IntranquilleFrance Bleu Besançon - Le coup de cœur des libraires
-
"Ce roman choral, dense et foisonnant, nous happe, car Padura sait entretenir le suspense."Claire Petiteau (Librairie Entre les lignes à Chantilly)Le Courrier picard
-
"Leonardo Padura plonge le lecteur dans un tourbillon de souvenirs et d’émotions. Un roman lyrique, nostalgique et captivant, sur l’exil et l’amitié."Fabien JouatelOuest France
-
"Le plus puissant, le plus remuant et le plus tendre des livres de Leonardo Padura."Christophe LaurentCorse Matin
-
"Le premier charme des romans de Leonardo Padura reste sa capacité à rendre compte d’une époque, son atmosphère et ici la façon dont on compose avec ses aléas et douleurs." Lire la chronique iciSite La viduité
-
"Poussière dans le vent est peut-être l’un des livres les plus personnels de Padura, dans lequel sa vision du Cuba post-révolutionnaire s’exprime le plus clairement." Lire la chronique iciSite En attendant Nadeau
-
"Poussière dans le vent vous prend aux tripes et ne vous lâche plus, pendant plus de 600 pages, et vous le refermez en pleurant parce que c’est fini. [...] Franchement, s’il y a un roman à ne pas manquer en ce début d’automne, c’est bien celui-là. Et si vous n’avez pas la gorge serrée en le refermant, je ne peux plus rien pour vous." Lire la chronique iciSite Actu du noir
-
"On plonge dans le récit de 600 pages, on s’en délecte, on s’y noie, on revient à la surface, on revient en arrière avant de faire un bond pour avancer dans l’histoire. Poussière dans le vent est un très grand livre d’un très grand écrivain." Lire la chronique iciBlog Surbooké
-
"Si vous ne connaissez pas l’auteur cubain Leonardo Padura, hâtez-vous de le découvrir avec Poussière dans le vent, son dernier roman, une merveille, un éblouissement, oserions-nous dire un chef d’œuvre ?" Lire la chronique iciSite Le Suricate
-
"Dans ce roman virtuose qui concentre tous ses talents – le génie narratif du romancier, l’efficacité du journaliste, l’œil du scénariste et l’art du suspense propre à l’auteur de polars – Padura propose une réponse simple. Celle qui lui inspire son titre et qui suggère qu’à la fin, les idées, comme les hommes qui les conçoivent, disparaissent pour redevenir poussière. "Poussière dans le vent" ."Florence NoivilleLe Monde des Livres
-
"Une fresque ample et bouleversante.Yves GabayLa Dépêche du midi
-
"Dans ce roman éblouissant, plein de sensualité et d’humour, de drames et d’histoire politique, les femmes, maîtresses de l’intrigue, envoûtantes et dignes, sont d’inoubliables héroïnes."Gilles HeuréTélérama
-
Ecouter le podcast iciGuillaume ErnerFrance Culture - L'invité des Matins
-
"Complexe, nuancé, romancé, chaloupé, "caliente" forcément, voici LE roman étranger de la rentrée littéraire."L'Alsace
-
"Un texte aussi brillant qu’universel, tout empli d’amitié, de loyauté et d’instinct de survie…" Lire l'article iciSerge BressanSite We culte
-
"Poussière dans le vent convainc donc autant par la subtilité de sa description du monde contemporain que par son aptitude à mener une intrigue." Lire la chronique iciSite Toute la culture
-
"Leonardo Padura a peut-être écrit là son livre le plus personnel. C'est en tout cas l'un des plus réussi sinon le plus réussi […] Il y a une vie folle dans ce roman. De la tristesse. De la rage. Des grands sourires. Des peines énormes." Lire la chronique iciBlog The killer inside me
-
"Leonardo Padura propose un texte aussi brillant qu’universel, tout empli d’amitié, de loyauté et d’instinct de survie."Serge BressanLe Quotidien du Luxembourg
-
"Avec maestria, l’auteur dépeint un pays complexe et fragile, met en scène des personnages attachants, liés par une amitié fidèle et bafouée, et livre une réflexion subtile sur l’exil, sans oublier une dose maîtrisée de suspense, qui rend ce roman addictif."Sylvie BulloTélé 2 semaines
-
"Voici un roman magistral, addictif, traitant de l’exil, de la perte, de la peur du déclassement, de la filiation, de l’amitié et du désir vital de liberté. Le rythme et la construction de l’histoire sont d’une efficacité redoutable et le style unique de Padura fait des merveilles. C’est dense, intense, porté par des personnages incarnés et attachants. C’est un immense coup de cœur."Guillaume ChevalierPAGE des libraires (Librairie Mot à mot)
-
"Qu’il s’agisse d’architecturer une intrigue policière, de prendre le pouls d’un pays, ou de brosser le portrait d’une génération - et d’une diaspora - en épousant les points de vue de multiples personnages, Leonardo Padura fait montre du même souffle et de la même puissance d’évocation. Et signe un superbe roman sur l’amitié et la trahison."Minh Tran HuyMadame Figaro
-
"Un roman addictif."Télé Loisirs
-
Lire l'article et écouter le podcast à propos de la sélection de rentrée littéraire 2021 iciFrance Culture / L'Obs
-
Lire l'article sur la sélection de la rentrée littéraire 2021 iciFrance Inter / Le Point
-
"En sondant les gammes traumatiques de l'exil : l'abandon, la fuite, la culpabilité, la peur ou la nostalgie, il s'agit de résoudre l'énigme de la malédiction qui condamne chaque déraciné à “porter sa maison culturelle sur le dos”, cette coquille d'escargot de l'errance éternelle. Bientôt, derrière le dédale des intimités singulières se redéfinit la condition de tous les étrangers, des réfugiés et des apatrides, devenus des fantômes ou des invisibles [ceux qui n'existent plus dans la mémoire de personne, et n'ont personne dans leur mémoire à eux]. Une démonstration de la valeur essentielle de l'amour et de l'amitié, ces fils d'Ariane qui nous unissent aux autres et qui nous construisent au-delà du temps qui passe, des déterminismes et des prédestinations, dans la permanence de cette force originelle qu'est l'aimant des souvenirs."Lucie ServinLe Cahier des livres
-
"Un roman émouvant et addictif." Lire la chronique iciSite Benzine Magazine
-
"Un roman magnifique !" Ecouter le podcast iciPhilippe LeconteSud Matin - Mon libraire en connaît un rayon
-
"En quoi consiste vraiment l'identité d'une diaspora ? Est-elle vouée à se disperser avec le temps, comme la « poussière dans le vent » qui inspire son titre au roman ? Maître du suspense, Leonardo Padura s'empare des codes du roman choral pour évoquer les destins d'une bande d'amis exilés à travers le monde pendant la « Période spéciale », une terrible crise économique qui frappa Cuba après l’effondrement de l'URSS. Amour ou haine, les sentiments les reliant à leur terre d’origine demeurent vivaces, et leurs enfants les ont reçus en héritage."Lire Magazine Littéraire
-
"Un impressionnant roman d’amour et d’exil qui concentre tous les talents de l’auteur : sens du romanesque, curiosité documentée du journaliste qu’il a été, art du suspense de l’auteur de polar qu’il est."Véronique RossignolLivres Hebdo
-
"Un livre pour qui s’intéresse à Cuba et à l’exil !" Lire la chronique iciBlog Chez Mark et Marcel
Adela Fitzberg entendit la sonnerie de trompettes réservée aux appels familiaux et lut sur l’écran de son iPhone le mot Madre. Sans réfléchir, car elle savait d’expérience qu’il valait mieux s’en abstenir, la jeune femme fit glisser son doigt sur l’icône verte clignotante.
– Loreta ? demanda-t-elle, comme si quelqu’un d’autre que sa mère avait pu l’appeler.
Trois heures plus tôt, à l’heure du petit-déjeuner, tandis qu’elle avalait avec le manque d’entrain matinal qui la caractérisait un yaourt faussement grec, mais peut-être vraiment light, accompagné de céréales et de fruits, et qu’elle humait le parfum revigorant du café que Marcos préparait chaque matin, la jeune femme avait ressenti la tentation de consulter son téléphone.
Cédant à cet élan inhabituel, elle avait passé en revue le journal des appels pour constater que Madre n’avait pas essayé de la joindre une seule fois depuis seize mois : durant tout ce temps, à en croire la mémoire du téléphone, c’était toujours elle qui, luttant contre ses appréhensions, avait appelé Loreta, en moyenne deux fois par mois. Peut-être parce qu’elle avait effectué un peu plus tôt cette recherche inhabituelle, Adela ne fut pas si surprise ; c’était comme de la transmission de pensée. À moins que ce fût seulement un caprice du hasard. Alors, sans s’autoriser à réfléchir, elle avait sauté dans le vide. Si elle survivait à la chute, elle verrait bien ce qu’il y avait au fond.
– Hé, Cosi, comment tu vas, toi ?
La voix grave, une voix de fumeuse et de buveuse – pourtant sa mère jurait ses grands dieux qu’elle n’avait jamais fumé, et sa fille ne l’avait jamais vue boire autre chose de plus fort qu’un bloody mary ou deux verres de vin rouge –, cette façon tellement cubaine d’ajouter des toi un peu partout dont elle n’avait pas réussi à se défaire en espagnol, et cette manie de l’appeler Cosi depuis qu’elle était bébé – elle ne l’appelait Adela que lorsqu’elle était fâchée contre elle, voire Adela Fitzberg, en soulignant bien le prénom et le nom de famille, quand elle était vraiment très fâchée –, lui confirmèrent l’évidence. Et très vite s’ajouterait son intime conviction que le coup de fil de Loreta, après tous ces mois, allait foutre sa journée en l’air. C’était donc à cela que servait sa mère ?
– Ça va bien… Au boulot… je viens d’arriver… Oui, je vais bien…
Elle n’osa pas lui demander comment elle allait, elle, et encore moins s’il y avait un problème. Surtout ne pas lui dire qu’elle était encore une fois arrivée en retard à cause de la circulation infernale sur l’expressway, dont Loreta disait qu’il contribuait à empoisonner le monde et les poumons de sa fille.
– Tant mieux pour toi… Moi, par contre, ça ne va pas du tout…
– C’est pour ça que tu m’appelles ? Tu es malade ? Il t’est arrivé quelque chose ? Quelle heure il est, là-bas ?
– Il est… six heures dix-huit… Il fait encore noir… très noir, et un peu froid… Et non, je ne suis pas malade. Pas physiquement… Je t’appelle parce que je suis ta mère et que je t’aime, Cosi. Et parce que je t’aime, j’ai besoin de te parler. Toi, tu crois que c’est possible ?
– Bien sûr, bien sûr… Tu n’es pas “physiquement malade” ? Mais alors qu’est-ce que tu as, Loreta ?
Adela ferma les yeux et entendit un long soupir : un classique chez sa tragédienne de mère. Par une sorte de vengeance inconsciente, quand sa mère la surnommait Cosi, elle, depuis toute petite, l’appelait par son prénom, Loreta, et ne lui disait Madre, Mère, que quand elle avait des envies de meurtre.
– Et avec ton copain, ça va ?
Cette fois, ce fut au tour d’Adela de soupirer.
– On ne s’était pas dit que tu ne voulais rien savoir de mon copain ? Tu ne m’appelles quand même pas pour ça… hein ?
Encore un soupir, plus long, plus profond. Authentique ? La dernière fois que Loreta l’avait appelée, sa mère lui avait juré qu’elle ne s’intéresserait plus jamais à la vie intime de sa fille, et lui avait une fois de plus balancé que si elle prenait plaisir à patauger dans la merde, grand bien lui fasse : en plus de sentir la merde, elle finirait par en bouffer aussi. Et Adela savait que sa mère était du genre à tenir ses promesses.
– Il faut sacrifier Ringo, finit par dire la voix insomniaque.
– De quoi tu parles, Mère ?
Comme une avalanche soudaine, l’image du bel alezan, avec une étoile de poils blancs sur le front à laquelle il devait son nom de Ringo Starr, avait surgi dans le cerveau de la jeune femme, déplaçant celle de son interlocutrice. Depuis que Loreta s’était installée à The Sea Breeze Farm, un élevage de chevaux des environs de Tacoma, son premier et plus grand amour avait été ce superbe Cleveland Bay. L’étalon, déjà adulte, avec ses yeux toujours pâles et larmoyants, comme ceux d’une personne tristement lucide, l’avait rapidement choisie, elle, comme âme sœur.
Depuis – dix, douze ans ? – qu’elle vivait dans ce ranch au nord-ouest du pays, Loreta avait insisté pour prendre personnellement soin de l’étalon, et elle s’en était occupée comme elle ne l’avait jamais fait avec rien ni personne dans sa vie. Sur l’échine généreuse de ce spécimen de la race des chevaux de trait de la couronne britannique, profitant de son pas énergique et d’une docilité inhabituelle chez un animal entier et à sang chaud, Adela s’était promenée à travers les champs et les bois de ce coin du monde où sa mère s’était confinée.
– Ne me fais pas répéter ces mots, Cosi.
– Mais qu’est-ce qu’il a ? La dernière fois qu’on s’est parlé, tu ne m’as pas dit… – La jeune femme s’interrompit, regrettant d’avoir cru que sa mère l’appelait pour lui parler de ses éternels soucis, ou pour se moquer de ses relations sentimentales et de sa décision d’aller s’installer avec son copain à Hialeah… Hialeah, non mais j’y crois pas ! Elle allait finir par y arriver, à foutre en l’air sa journée ; d’ailleurs, vu ce qu’elle venait de dire, c’était déjà le cas.
– Des coliques… ça fait des jours qu’on fait tout ce qu’on peut, Rick et moi… On a demandé conseil… Le meilleur vétérinaire d’ici l’a pris en charge. Le diagnostic définitif est tombé il y a deux jours. On lui a fait une ponction abdominale… et c’est grave. Il est trop vieux pour une opération, sauf qu’il est tellement fort, on ne voulait pas… Je le savais, mais le vétérinaire nous a confirmé qu’il n’y a pas d’autre issue possible.
– Mon Dieu… Est-ce qu’il souffre ?
– Oui… depuis plusieurs jours… il est sous calmants.
Adela sentit sa gorge se serrer.
– Il n’y a rien à faire ?
– Non. Pas de miracles.
– Quel âge a Ringo ?
– Exactement le même âge que toi… vingt-six ans… On ne dirait pas, mais c’est un vieillard…
Adela déglutit et réfléchit avant de répondre :
– Alors il faut l’aider, Loreta.
Nouveau soupir au bout du fil. Adela attendit.
– C’est bien ce que j’ai l’intention de faire… Mais je ne sais pas si je dois le faire moi ou demander à Rick de s’en charger. Ou au vétérinaire.
– Fais-le toi. Avec tendresse.
– Oui… C’est vraiment dur, tu le sais, toi ?
– Bien sûr que je le sais… Tu es comme sa mère, lança la jeune femme, sans y mettre de sous-entendus.
– C’est ça le pire… le pire… Toi, tu ne sais pas ce que c’est que d’être mère et de ne pas pouvoir… Les joies et les souffrances d’une mère, toi, tu n’en as pas idée.
– Tu as beaucoup souffert, n’est-ce pas ? De ne pas pouvoir quoi ? demanda Adela, malgré elle.
Malgré la solennité du moment, elle était une nouvelle fois tombée dans le piège, elle y tombait toujours, et elle se prépara pour la tirade maternelle. Mais la réponse de Loreta la prit de court.
– C’est tout ce que je voulais te dire. Savoir que toi, tu vas bien, te dire que je t’aime fort fort, et… Cosi, je n’arrive plus à parler. Je crois que je vais…
– I’m so sorry…
C’est seulement à cet instant qu’Adela prit conscience que ses dernières questions étaient à côté de la plaque et que la douleur de sa mère devait être immense : elle lui avait parlé tout le temps en espagnol, avec ce toi révélateur de sa cubanité ; et, renversant la logique de l’année et demie écoulée, c’était sa mère qui l’avait appelée et qui, pour couronner le tout, avait raccroché. Elle devait être anéantie par la décision qu’il lui fallait prendre, au point d’être incapable de relever le défi verbal qui s’annonçait.
Adela resta quelques instants les yeux fixés sur l’iPhone et, malgré elle, imagina le moment où Loreta manipulerait la terrifiante seringue métallique et piquerait le pelage brillant du cou de Ringo pour le plonger dans un sommeil éternel. Les doux yeux perspicaces de l’animal né avec une étoile au front la contemplèrent depuis son souvenir. Elle laissa tomber le téléphone dans le tiroir en haut de son bureau, qu’elle referma brusquement, et se leva. Elle sortit dans le couloir menant à l’entrée des locaux abritant les Special Collections de l’université où elle avait décoché un poste de spécialiste en bibliographie cubaine et, en passant devant le bureau de Yohandra, l’archiviste, elle lui dit qu’elle avait besoin de prendre l’air et de boire un café.
– Il y a un problème ?
– Oui… enfin non, ce n’est rien, murmura Adela, qui n’avait pas la moindre envie d’expliquer le tourbillon de sentiments déclenché par le coup de fil de sa mère et la vision des yeux du cheval. T’aurais pas une clope ?
Yohandra haussa les sourcils, sortit une cigarette du paquet qui se trouvait dans son sac et la lui tendit en même temps qu’un briquet.
– Ouah, c’est si grave que ça ?
Adela murmura un merci, tenta de sourire et hocha à peine la tête quand sa collègue, montrant l’écran de son ordinateur, lui commenta que la visite du président Obama à Cuba semblait se confirmer, décidément super ce type… Adela sortit dans le jardin arboré qui entourait la bibliothèque et fut saisie par la chaleur humide de Miami déjà forte en cette matinée d’avril. Au nord, le ciel nuageux annonçait un orage probable dans l’après-midi, à Hialeah et peut-être aussi plus au sud, au-dessus de Miami, ce qui transformerait son trajet retour par le Palmetto Expressway en torture physique et psychologique susceptible de la faire craquer.
Elle suivit le sillage d’une bonne odeur de café cubain fraîchement préparé et traversa le campus jusqu’à la cafétéria située au rez-de-chaussée du bâtiment de la fac de lettres, où elle demanda un café peu sucré. Le gobelet de plastique à la main, elle retourna dans le jardin et chercha le banc le plus à l’ombre et le plus reculé pour boire son breuvage et fumer en cachette la première cigarette qu’elle allumait depuis un nombre incalculable de mois. Un vice de merde pour un jour de merde, se dit-elle, refusant de s’avouer vulnérable tout en appréciant le shoot de nicotine. Adela Fitzberg eut à cet instant précis la conviction que son énervement n’était pas dû au sacrifice imminent du vieux Ringo. Ou pas seulement. En plus de lui gâcher la journée avec une mauvaise nouvelle, pourquoi Loreta l’avait-elle appelée ?
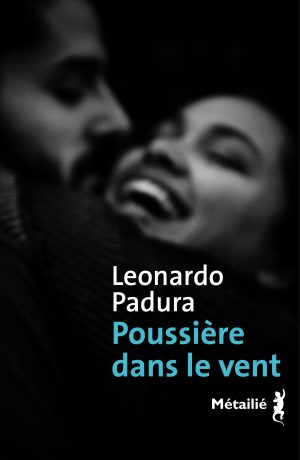






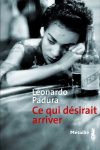

-100x150.jpg)