L'industrie du design corporel s'épanouit. Le corps est devenu la prothèse d'un moi éternellement en quête d'une incarnation pour signifier sa présence au monde, pour adhérer à soi. Tatouage et piercing sortis de la marginalité sont devenus les accessoires de la mise en scène de soi.
Partant du constat que le "corps marqué" a, depuis l'Antiquité et dans les sociétés traditionnelles, été l'expression d'un parcours, d'un message et surtout d'une identité, David Le Breton montre comment l'église s'est fortement opposée à cette pratique, mais aussi comment après les marins et les soldats, la justice s'en est emparée comme d'une "marque infamante". Il étudie la façon dont le tatouage intervient comme le language de révolte jusqu'à aujourd'hui où le piercing est bel et bien une identité à fleur de peau qui concerne la jeunesse.
David Le Breton s'appuie sur une recherche de terrain pour analyser successivement : les marques corporelles dans le sociétés occidentales, le passage de la dissidence à l'affirmation de soi, la recherhe d'une identité, les rites de passages, la naissance d'une culture.
Il s'intéresse à la différence entre souffrance, douleur et plaisir sexuel qui restent liés à l'acte même du piercing. Il note enfin ce paradoxe selon lequel, si ce système de marquage régresse fortement dans les sociétés traditionnelles, il se développe de façon rapide et inventive dans le monde occidental nanti, et il s'interroge sur notre désir individualiste de vouloir modifier notre corps
Extrêment documenté, son livre fait le tour de la question, tant historique qu'anthropologique et philosophique, sur une mode nouvelle et en pleine expansion.
-
Entretien entre Thierry Jonquet et David Le Breton A l'occasion de la sortie d'" Ad vitam aeternam " et de" Signes d'identité ", le romancier et le sociologue s'interrogent sur le statut du corps dans notre société. Tatouage, piercing, chirurgie... : on le bricole sans limites, comme une "prothèse du moi". D'un côté, Thierry Jonquet, pilier du roman noir français, dévoreur de presse et de faits divers, hanté par la mort, les exclus et la chair à psychiatre. De l'autre, David Le Breton, professeur de sociologie à l'université Marc-Bloch de Strasbourg, spécialiste de l'anthropologie du corps et des conduites à risque des jeunes. Corps tatoués, piercés, bricolés, cadavres manipulés, dépecés, mis en spectacle : leurs œuvres respectives pointent une société contemporaine en souffrance avec son corps, Thierry Jonquet affiche, parmi ses influences, celle de David Le Breton, et l'anthropologue a lu avec passion les livres du romancier. Ils ne s'étaient jamais rencontrés : Télérama les a réunis. Télérama : Quelle est l'origine de cette passion commune pour la relation de l'homme à son corps? Thierry Jonquet: Pour moi, l'époque où je travaillais à l'hôpital comme ergothérapeute. J'en garde des images proprement incroyables de vieillards délabrés, d'infirmes déglingués, d'amputés congénitaux qu'on aurait dit droit sortis de Freaks, le film de Tod Browning. Je me souviens en particulier d'un gamin dont le tronc à peu près normal se finissait de manière informe, comme un sac de chair, et de ma première rencontre avec lui, quand un aide-soignant l'a sorti de l'espèce de coquetier qu'on lui avait fabriqué pour qu'il puisse tenir en position verticale. L'histoire commence quelque part par là... David Le Breton : La mienne est celle d'un adolescent mal dans sa peau aux prises avec l'énigme de l'incarnation : quel est le lien entre moi et mon visage, mes mains, mon corps ? L'anthropologie, le détour par d'autres sociétés humaines m'ont permis de comprendre que nous sommes les incarnations d'une culture, que nos gestuelles, nos habitudes vestimentaires, la manière dont nous parons notre corps renvoient à des visions du monde, à des manières d'être ensemble. Depuis une quinzaine d'années, j'essaie ainsi de comprendre quelle est la part de l'autre en nous, la part de la culture. Parallèlement, comme Thierry Jonquet, j'ai moi aussi fréquenté l'hôpital, où j'ai enseigné dans diverses écoles d'infirmiers. Je suis troublé de constater à quel point la qualité de notre rapport au monde passe par notre corps: notre apparence commande le regard des autres, peut induire une extrême violence ou à l'inverse une grande adhésion. Ce qui me rapproche de Jonquet, c'est la volonté de comprendre le corps abîmé, le corps en souffrance. Thierry Jonquet: Mais je n'y vois, moi, qu'une matière romanesque. J'essaie de construire des histoires qui accrochent le lecteur, je n'avance pas de discours, tout juste quelques questions. David Le Breton : N'empêche que des ouvrages comme les vôtres sont bel et bien des sortes d'analyseurs sociologiques. Il y a dans vos intrigues, dans la mise en scène de vos personnages des éléments qui permettent de mieux comprendre le statut du corps dans notre société. Au risque de vous surprendre, je ne vois pas de différence majeure entre nous. Le roman est une manière de poursuivre la réflexion avec d'autres moyens que ceux des sciences humaines. Les différences, ce sont les mises en forme, les morales d'écriture, l'enquête, le terrain, la nécessité pour un universitaire d'étayer son propos par la citation d'une série d'auteurs alors que le romancier peut aller droit à son sujet sans avoir de compte à rendre, sinon sur la qualité de son intrigue. Télérama : Quelles ont été les sources de votre dernier roman, Thierry Jonquet ? Comme vos précédents livres, Ad vitam aeternam est directement inspiré de la réalité sociale... Thierry Jonquet : Bien sûr, mais je réagis émotionnellement, j'essaie de ne pas trop rationaliser. Le roman, sinon, serait tué dans l'œuf. A l'origine, il y a la lecture de L'Adieu au corps, cet essai où David Le Breton analyse le mépris contemporain pour le corps: cette manière de le considérer comme imparfait et par conséquent comme un terrain d'expériences sans limites pour l'embellir ou l'améliorer. ça commence avec le piercing, qui peut prendre des formes radicales, jusqu'à certains délires de la médecine, qui finit par ne voir en nous qu'une sorte de meccano dont les pièces pourraient être changées à l'infini ... Mais le déclic, c'est un reportage que j'ai vu, peu de temps après, sur l'artiste allemand Gunther von Hagens, un ancien médecin anatomiste devenu >" sculpteur " de cadavres (qu'il conserve grâce à un procédé de son invention, la " plastination ", et met en scène en fonction de ses caprices). Quand j'ai vu que des millions de gens se pressaient à ses expositions, je me suis dit que j'avais la matière d'un roman. Il me semble que nous sommes au début d'un processus et qu'il va y avoir des dégâts ! David Le Breton : Les valeurs anciennes attachées au corps ont en effet volé en éclats ces vingt dernières années. Celui-ci est aujourd'hui perçu comme un brouillon que l'on peut remodeler ou rectifier à volonté. On bricole son identité en bricolant son corps, avec l'idée qu'il n'est que la prothèse du moi. La chirurgie esthétique et la vogue qu'elle connaît est tout à fait révélatrice à cet égard. On ne se contente plus désormais du visage que l'on a. La mode du culturisme va dans le même sens. Quant au développement actuel du tatouage ou du piercing, il exprime, entre autres, la souffrance des jeunes générations face à un monde de moins en moins lisible. J'analyse ainsi les marques corporelles comme une manière de " prendre ses marques " avec la société. Thierry Jonquet : Le corps est un monde en miniature. On agit sur son corps plutôt que d'agir sur le monde. David Le Breton : Exactement. En agissant sur son corps, on reprend le contrôle d'un monde qui nous échappe. Pour moi, le tatouage, le piercing, les scarifications sont aussi une manière d'éviter, de dépasser les incisions corporelles brutales que s'infligent les jeunes dans les moments de grande souffrance. Les filles, en particulier, se coupent, font couler le sang, dans une perspective d'apaisement, de dilution d'une tension insupportable, pour échapper à un sentiment d'impuissance. Les marques corporelles constituent de ce point de vue une pratique pacifiée parce qu'elles recourent à un spécialiste, une sorte de compagnon de route qui va permettre de les réaliser de façon plus apprivoisée que dans la solitude totale. Thierry Jonquet: Ce qui me frappe tout de même dans ces pratiques, en particulier les plus extrêmes, c'est la rapidité de leur diffusion, la souffrance qu'elles impliquent et le fait qu'elles soient le plus souvent données en spectacle. Il y a une vingtaine d' années, les artistes du body art, Gina Pane par exemple, dont une des performances consistait à escalader pieds nus les barreaux d'une échelle hérissée de picots, apparaissaient comme des marginaux. Et s'ils avaient constitué une sorte d'avant-garde ? Je lisais récemment dans VSD un reportage sur une jeune fille tatouée et piercée des pieds à la tête, qui expliquait tranquillement, sans émouvoir le moins du monde son interlocuteur journaliste, qu'elle allait bientôt se faire suspendre à des crochets parce que c'est le top de la démarche. Quant aux séances de branding, ces marques obtenues par application au fer rouge ou au laser, qui se déroulent en public, de quoi s'agit-il sinon de séances de torture ? David Le Breton : Torture, je ne sais pas, dans la mesure où le protagoniste est consentant. Il y a pour moi, une différence essentielle entre la douleur et la souffrance. A partir du moment où l'on choisit délibérément l'épreuve qu'on s'inflige, on n'est plus dans la souffrance. On reste dans la douleur, mais on la regarde en quelque sorte dans les yeux. C'est cela que nous disent les sportifs de l'extrême, les artistes du body art ou les jeunes qui pratiquent le branding : tu regardes la douleur, mais tu restes au-delà. La souffrance apparaît quand on perd son rapport à la douleur, c'est-à-dire quand elle est infligée par un autre, comme dans la torture ou la maladie. Thierry Jonquet: Reste tout de même le problème des spectateurs, dont les motivations me paraissent troubles. Que cherchent-ils, ceux qui se pressent par milliers aux expositions de Gunther von Hagens ? S'ils font la queue des heures durant ce n'est pas pour voir des figurines ou des cires anatomiques. Ils savent bien qu'ils vont avoir affaire à d'authentiques cadavres. Télérama : Que voulez-vous dire ? Qu'un certain nombre d'interdits majeurs sont en train de s'effriter? Thierry Jonquet : Oui, je crois. Quand le cadavre devient un spectacle, il y a une rupture dans notre civilisation. Une perte du respect du corps, et par conséquent de la vie. David Le Breton : Pour moi, c'est le respect de l'homme lui-même qui est en cause, parce que la condition humaine est une condition corporelle. Nous sommes notre corps. Quand on apprête des cadavres, quand on les découpe ou les écorche pour les mettre en scène, on est dans une désacralisation radicale non seulement du corps et de la mort, mais aussi de l'homme, qui devient une sorte de relique dérisoire et grotesque. Vous parliez de rupture, je crois que nous sommes aujourd'hui confrontés à de multiples ruptures anthropologiques. La première, qui remonte à la Renaissance et au début de l'anatomie, a consisté à ouvrir le corps de l'homme sans se poser de questions éthiques, c'est-à-dire avec pour seul souci celui de faire progresser la connaissance de la médecine. La seconde rupture vient avec les greffes, cet échangisme des organes qui conduit l'homme à se regarder autrement : la vision du corps devient essentiellement instrumentale. Thierry Jonquet : Le refus contemporain du vieillissement me paraît également constituer une rupture, toutes ces promesses de la médecine, les hormones miracles qui devraient multiplier les centenaires poussent à la négation des limites humaines. C'est l'accélération vertigineuse du progrès technique qui pose finalement problème. Voyez encore l'exemple du clonage. Les sociétés ne sont pas prêtes, elles n'évoluent pas aussi vite que les techniques. David Le Breton : La question est alors celle de la transmission. Que transmettre aux nouvelles générations d'un monde qui change si vite ? Sans doute faut-il refuser ce culte de la vitesse, cette valorisation contemporaine du changement pour le changement, qui consiste à ériger en valeur fondamentale le principe même du monde libéral, l'obsolescence de la marchandise. La valeur fondamentale, pour moi, c'est au contraire la flânerie : prendre son temps, faire la sieste, lire, marcher, converser les yeux dans les yeux avec ses amis... Thierry Jonquet : J'aime l'idée de finir sur cet éloge de la flânerie. C'est complètement subversif !propos recueillis par Michèle Gazier et Michel AbescatTELERAMA
-
« L’anthropologue ne cesse de s’interroger sur le statut du corps dans notre société ; une société qui incite de plus en plus à se mettre hors de soi pour devenir soi-même. »
Colette Barroux-ChabanolL’ECOLE DES PARENTS -
« Dans [Signes d’identité], c’est aux marquages corporels que le chercheur s’attache, partant du constat que si le « corps marqué » ou tatoué a toujours été, depuis l’Antiquité et dans les sociétés traditionnelles, l’expression d’une identité (positive ou négative selon que les « marques » fussent glorieuses ou infamantes). »
Vincent LabaumeTOUT PREVOIR -
« En s’appuyant sur des témoignages précieux de tatoués et de tatoueurs, le sociologue David Le Breton montre avec brio comment les tatouages ou les piercings deviennent "les pages déchirées d’un agenda, une sorte de journal, tenu à même la peau." »
Luce MichelROLLING STONE -
« Ce livre s'impose incontestablement, en France, comme le plus fouillé, à ce jour, sur le phénomène.»
Alexandra Laignel-LavastineLE MONDE
Introduction
Le corps inachevé
Dans nos sociétés le corps tend à devenir une matière première à modeler selon l'ambiance du moment. Il est désormais pour nombre de contemporains un accessoire de la présence, un lieu de mise en scène de soi. La volonté de transformer son corps est devenue un lieu commun. La version moderne du dualisme diffus de la vie quotidienne oppose l'homme à son propre corps, et non plus comme autrefois l'âme ou l'esprit au corps. Le corps n'est plus l'incarnation irréductible de soi mais une construction personnelle, un objet transitoire et manipulable susceptible de maintes métamorphoses selon les désirs de l'individu. S'il incarnait autrefois le destin de la personne, il est aujourd'hui une proposition toujours à affiner et à reprendre. Entre l'homme et son corps, il y a un jeu, au double sens du terme. De manière artisanale des millions d'individus se font les bricoleurs inventifs et inlassables de leur corps. L'apparence alimente désormais une industrie sans fin.
Le corps est soumis à un design parfois radical ne laissant rien en friche (body building, régimes alimentaires, cosmétiques, prises de produits comme la DHEA, gymnastiques de toutes sortes, marques corporelles, chirurgie esthétique, transsexualisme, body art, etc.). Posé comme représentant de soi, il devient affirmation personnelle, mise en évidence d'une esthétique et d'une morale de la présence. Il n'est plus question de se contenter du corps que l'on a, mais d'en modifier les assises pour le compléter ou le rendre conforme à l'idée que l'on s'en fait. Sans le supplément introduit par l'individu dans son style de vie ou ses actions délibérées de métamorphoses physiques, le corps serait une forme décevante, insuffisante à accueillir ses aspirations. Il faut y ajouter sa marque propre pour en prendre possession.
Le recours aujourd'hui courant au tatouage (signe visible inscrit à même la peau grâce à l'injection d'une matière colorée dans le derme) et au piercing (percement de la peau pour y poser un bijou, un anneau, une petite barre, etc.) est une forme significative de ce changement de relation au corps. S'y ajoutent d'autres modifications corporelles: le stretching (élargissement du piercing pour y mettre une pièce plus volumineuse), les scarifications (cicatrices ouvragées pour dessiner un signe en creux ou en relief sur la peau avec un éventuel ajout d'encre), le cutting (inscription de figures géométriques ou de dessins à l'encre sur la peau sous forme de cicatrices ouvragées grâce au scalpel ou à d'autres instruments tranchants), le branding (cicatrice en relief dessinée sur la peau par l'application au fer rouge ou au laser d'un motif), le burning (impression sur la peau d'une brûlure délibérée, rehaussée d'encre ou de pigment), le peeling (enlever des surfaces de peau) ou les implants sous cutanés (incrustation de formes en relief sous la peau).
En quelques années, ces nouveaux usages ont renversé les anciennes valeurs négatives qui leur étaient associées. Désormais ce sont des démarches sur soi qui cristallisent une large part des engouements des jeunes générations. Le corps est investi comme lieu de plaisir dont il faut affirmer qu'il est à soi en le sursignifiant, en le signant, en le prenant en main. Simultanément la marque corporelle est une prise de distance avec un monde qui échappe en grande part. Il s'agit de remplacer des limites de sens qui se dérobent par une limite sur soi, une butée identitaire qui permet de se reconnaître et de se revendiquer comme soi. La tâche poursuivie est bien d'être re-marqué, au sens littéral et figuré, de renchérir sur soi, d'afficher le signe de sa différence.
Dans L'Adieu au corps (1999), j'ai longuement analysé ces entreprises de modifications de soi dans le contexte d'une prise de congé symbolique d'un corps perçu comme un brouillon, une relique, une matière inachevée à terminer par un travail sur soi. Ce sentiment d'insuffisance du corps culminait dans la volonté de s'affranchir de ses limites, voire même de s'en débarrasser. Même s'il partait de pratiques de vie quotidienne, notre point d'ancrage essentiel était plutôt constitué par la technoscience et la cyberculture. Dans cet ouvrage, je vais porter un regard plus attentif, plus sensible, sur les significations et les valeurs que revêtent ces marques corporelles pour les jeunes générations.
Les modifications corporelles ne sont plus, comme autrefois le tatouage, une manière populaire d'affirmer une singularité radicale, elles touchent en profondeur les jeunes générations dans leur ensemble, toutes conditions sociales confondues, elles sollicitent autant les hommes que les femmes. Loin d'être un effet de mode, elles changent l'ambiance sociale, incarnent de nouvelles formes de séduction, elles s'érigent en phénomène culturel. Si le tatouage ou le piercing pouvaient encore être associés à une dissidence sociale dans les années 70 ou 80, ce n'est plus le cas aujourd'hui.
Le stéréotype du tatoué comme homme, jeune, costaud, issu de milieu populaire (ouvrier, marin, routier, militaire, truand, etc.), affichant une virilité agressive, s'est estompé lors de ces dix dernières années. En une durée également brève, le piercing s'est également imposé comme un accessoire esthétique autant pour les hommes que pour les femmes. D'autres formes de modifications corporelles apparaissent comme le fait de brûler, de scarifier, de couper la peau pour y inscrire des figures insolites. Ou encore d'insérer dans la chair des implants pour en modifier l'apparence. Ces dernières pratiques en sont à leur début, elles participent du renouvellement de la parure corporelle, mais elles suscitent des vocations croissantes. D'autres vont émerger dans les années à venir.
Dans le second chapitre il m'a paru nécessaire de retracer brièvement l'histoire occidentale du tatouage, du moins depuis sa redécouverte par l'expédition de Cook dans les mers du Sud (le piercing étant lui d'une apparition récente, même s'il était connu comme une forme de parure "exotique" depuis au moins aussi longtemps que le tatouage) (Bruma, 2002), essentiellement pour expliquer les préjugés qui ont longtemps eu cours à son sujet. Pendant plus d'un siècle le tatouage est synonyme de marginalité, de dissidence, de délinquance, et son histoire en effet surtout liée aux interstices de la société civile. Cette réputation sulfureuse alimente les fréquentes oppositions parentales à l'encontre de la volonté de leurs enfants de se tatouer ou de se piercer. Cet écart de générations montre combien les aînés restent influencés par les anciennes images négatives associées aux modifications corporelles, alors que pour les jeunes elles sont à l'inverse une manière de s'intégrer à leur classe d'âge, d'embellir leur corps bien plutôt que de le stigmatiser.
Le signe tégumentaire est désormais une manière d'écrire dans la chair des moments clés de l'existence. Le corps se fait simultanément archive de soi et décoration. La surface cutanée accueille les traces d'une relation amoureuse, d'un anniversaire (les vingt ans, les vingt-cinq ans, les trente ans, etc.), la naissance d'un enfant, la réussite d'un projet, etc. Le signe est mémoire d'un événement, du franchissement personnel d'un passage dans l'existence dont l'individu ne veut pas perdre le souvenir. Sous une forme ostentatoire ou discrète, il participe d'une esthétique de la vie quotidienne, sollicitant un jeu avec le secret selon son emplacement et le degré de familiarité avec l'autre. Souvent en effet sa signification reste énigmatique, et le lieu plus ou moins accessible au regard dans la vie courante. Parfois prothèse identitaire, surface protectrice contre l'incertitude du monde, il est aussi accroissement de la jouissance d'exister et démonstration d'un style de présence. La marque tégumentaire ou le bijou du piercing sont un mode diffus d'affiliation à une communauté flottante nourrissant une complicité relative avec ceux qui les portent également. Mais nous le verrons, la "tribu" est largement un mythe, une référence combattue même par beaucoup. Le bricolage des signes identitaires amène certains à vivre une expérience décrite comme "spirituelle", détachée de toute référence religieuse mais puissante dans ses conséquences personnelles. Ils se sentent métamorphosés en sortant de la boutique ou après avoir inscrit les signes eux-mêmes sur leur corps. Ils vivent à leur manière un rite personnel de passage. En changeant la forme de leur corps, ils entendent changer leur existence, et parfois y réussissent en effet car leur regard sur eux-mêmes s'est radicalement modifié.
D'autant que la marque corporelle est souvent une prise d'autonomie, une manière symbolique de prendre possession de soi. Le corps légué par les parents est à modifier. Le jeune entend affirmer sa différence et être reconnu malgré tout. Il souhaite faire peau neuve. Et nombre de jeunes disent leur crainte de la réaction de leurs parents. Ils attendent avec anxiété un jugement à leur propos dont ils pressentent la négativité. Les marques corporelles impliquent également une volonté d'attirer le regard, même si le jeu demeure possible selon les lieux d'inscription, qu'elles soient en permanence sous le regard des autres ou seulement de ceux dont on recherche la complicité. Elles demeurent sous l'initiative de l'individu et incarnent alors un espace de sacralité dans la représentation de soi. A défaut d'exercer un contrôle sur son existence, le corps est un objet à portée de main sur lequel la volonté personnelle est presque sans entraves. La profondeur de la peau est hospitalière à toutes les significations. La marque cutanée traduit la nécessité de compléter par une initiative propre un corps insuffisant en lui-même à incarner un sentiment d'existence propice.
Si le tatouage des sociétés traditionnelles répète des formes ancestrales inscrites dans une filiation, les marques contemporaines, à l'inverse, ont d'abord une visée d'individualisation et d'esthétisation; elles sont en effet parfois des formes symboliques de remises au monde mais sous une forme strictement personnelle, en recourant même à des motifs n'appartenant qu'à soi. Le signe cutané est une manière d'apaiser la turbulence du passage d'un statut à un autre, de donner une prise symbolique sur l'événement, et de ritualiser ainsi le changement. La marque traditionnelle est volonté de dissoudre sa différence personnelle, dans nos sociétés contemporaines elle affiche à l'inverse l'individualité, c'est-à-dire la différence du corps propre, coupé des autres et du monde, mais lieu de sa liberté au sein d'une société où il n'est que formellement rattaché. C'est ce cheminement inédit des marques corporelles dans nos sociétés occidentales qui m'intéresse dans cet ouvrage.
L'anthropologie culturelle des marques corporelles est riche (Maertens, 1978; Brain, 1979; Borel, 1992; Ebin, 1979). Dans un esprit proche, d'autres ouvrages ont donné un large panorama des usages sociaux dans le domaine de la décoration rituelle et/ou esthétique du corps humain (Thévoz, 1984, Virel, 1979). Je n'ai pas souhaité m'y attarder davantage, même s'il m'arrive, ici et là, de les évoquer par analogie, tout en pointant les différences. L'angle d'approche de ce livre est bien la fascination actuelle de nos sociétés pour ces marques corporelles. Anthropologie du contemporain et anthropologie de la jeunesse se côtoient donc dans ces pages attachées à saisir au plus près les significations de ces démarches de modifications corporelles qui emportent avec passion une part grandissante des jeunes générations.
J'ai souhaité dans cet ouvrage donner la parole aux individus concernés, scandant ainsi certaines parties du texte de témoignages. Ma documentation était considérable. Outre l'observation personnelle, les rencontres informelles, elle consistait en plus de quatre cents entretiens avec des personnes tatouées, piercées ou scarifiées (dont les prénoms ont parfois été changés). Ces entretiens proviennent d'une enquête de deux années menée à la faculté des sciences sociales de l'université Marc Bloch de Strasbourg. Je remercie vivement de leur collaboration à ce propos Nicoletta Diasio et Laurence Pfeffer-Kintz, et les nombreux étudiants qui se sont également intéressés à ce travail qui les concernait souvent de très près. Je souhaite également dire toute ma reconnaissance à Crass, patron de Tribal Touch à Strasbourg, qui m'a longuement parlé de son métier et qui est venu plusieurs fois à la faculté pour des rencontres passionnées avec les étudiants de sociologie. Je remercie aussi Esté qui m'a parlé de son itinéraire personnel et de la manière dont elle voyait son métier. Je dois aussi beaucoup à Lukas Zpira, saisi dans une démarche radicale de modification de soi, patron de Body Art à Avignon, dont j'ai beaucoup apprécié le contact et qui m'a parlé de son engagement non seulement de métier mais aussi de vie pour les marques corporelles. Je remercie aussi vivement Armand Touati, directeur de la revue Cultures en mouvement, qui a publié plusieurs de mes articles au sujet du tatouage ou du piercing et qui a accepté le principe d'un numéro consacré aux modifications corporelles, paru en été 2001. Je n'aurais sans doute jamais écrit sur ce thème si je n'avais senti depuis des années l'importance que revêtent ces marques pour les jeunes générations, la manière dont elles sont parfois un recours pour effacer une souffrance personnelle. C'est paradoxalement mon travail sur les jeux symboliques avec la mort, et notamment les conduites à risque des jeunes qui m'ont amené à cette réflexion. A plusieurs reprises j'ai cru sentir chez des jeunes en difficulté l'importance existentielle de leurs marques dans la construction difficile de soi. En ce sens Signes d'identité est une sorte de long chapitre supplémentaire à Passions du risque (1991) mais sur le versant de la prévention, de la reprise en main pacifiée de soi. Mais bien entendu les modifications corporelles sont aussi jubilation de jouer avec son corps, de se décorer à sa guise, de s'inventer des identités changeantes.
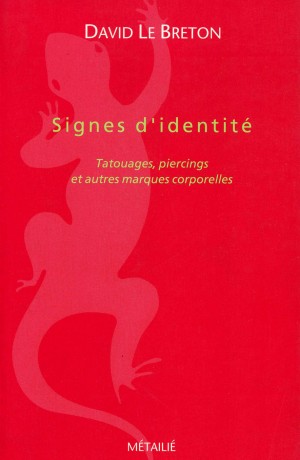









-100x150.jpg)
-100x150.jpg)



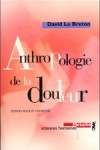




 (s)-100x150.jpg)



