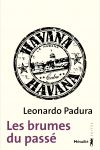En 1989, pendant les jours étranges où commencent à souffler les vents de carême qui annoncent l’infernal printemps cubain, l’inspecteur Mario Conde rencontre une éblouissante saxophoniste, amateur de jazz.
On retrouve le cadavre d’une jeune professeur de chimie qui enseignait dans le lycée dont l’inspecteur et ses amis gardent une si grande nostalgie. Mais cette jeune femme irréprochable, bien notée professionnellement et politiquement, était en possession de marijuana.
Au cours de son enquête, Mario Conde pénètre dans un monde en pleine décomposition, où règnent l’arrivisme, le trafic d’influence, les fraudes, la drogue. Il perd une partie de ses illusions mais vit une histoire d’amour et de musique dont il ne peut imaginer le dénouement.
Ce deuxième épisode des aventures de Mario Conde marque un tournant significatif dans la maîtrise du style et des intrigues de cet auteur aujourd’hui traduit et reconnu internationalement.
« Le choix du genre policier permet d’entrer dans les recoins les plus obscurs de la société… et l’atmosphère d’angoisse du roman est largement aussi efficace qu’une diatribe ouverte » – Raphaëlle Rérolle, Le Monde
-
Ceux qui ont lu Passé Parfait, L'automne à Cuba ou Electre à La Havane savent déjà que ce quatrième opus des Quatre Saisons de Leonardo Padura est une réussite. L'auteur cubain n'est pas du genre à changer une recette qui marche. Donc, dans ce Vents de Carême, on retrouve tous les ingrédients qui font de ses livres de grands moments de bonheur.L'ALSACE
-
Les plus belles pages de "Vents de Carême" n'ont de policière que l'allure. Elles touchent à l'essentiel. C'est-à-dire à l'inhumanité de la condition humaine quand l'envie et la médiocrité règlent la marche du temps. Padura a le chic pour poser les bonnes questions en faisant mine d'ignorer les réponses. On aimerait lui serrer la main.Gérard GuéganSUD OUEST DIMANCHE
-
"Vents de Carême" appartient à une tétralogie,"Les Quatre Saisons", dont chaque volume peut se lire séparément mais qui ont tous pour héros le singulier Mario Conde, flic à l'instinct et solitaire, avec, pour toute famille, son ami Flaco, paralysé à la suite d'une blessure reçue lors de la guerre en Angola, et la mère de celui-ci, inénarrable cuisinière. Confronté aux embûches du temps, Conde s'installe dans les ombres moites d'une Cuba fiévreuse et délétère comme une vigie fantomatique. Si les trois autres romans sont superbes, ce "Vents de carême", douloureux et émouvant, comme la vie lorsqu'elle tourne en rond et s'enfuit entre les doigts telle une poignée de sable, est tout simplement magique. Dans un style d'une somptueuse puissance, le Cubain Leonardo Padura envoûte irrévocablement son lecteur.Christian GonzalezMADAME FIGARO
-
Dans Mort d'un chinois à la Havane, l'inspecteur retrouvait un cadavre au doigt tranché, la poitrine lacérée à coups de rasoir. Nous sommes dans la métaphore, le polar métaphysique : le cadavre sur lequel, de livre en livre, on finit toujours par tomber, c'est celui du pays même. Les personnages, affirme Leonardo Padura, bien que nés de son imagination, "sont assez proches de la réalité" : elle est très connue des Cubains qui n'ont pas choisi l'exil mais qui cherchent une issue au sein de leur désastre quotidien.Gérard de CortanzeLE FIGARO LITTERAIRE
-
« L'ombre de Manuel Vazquez Montalban plane [...] entre sourires, sensualité et désespoir. [...] Et la nostalgie suinte à travers les pores d'une écriture qui peut tout dire ? l'amour, la mort, la haine, le sexe, la solitude, sans jamais perdre de cette grâce qui est la vertu des grands écrivains. »Michèle GazierTELERAMA
Printemps 1989
C’était le mercredi des Cendres et, avec la ponctualité de l’éternel, un vent aride et suffocant, comme envoyé directement du désert pour remémorer le sacrifice nécessaire du Messie, s’engouffra dans le quartier, soulevant les détritus et les angoisses. Le sable des carrières et les vieilles haines se mêlèrent aux rancœurs, aux peurs et aux déchets débordant des poubelles, les dernières feuilles mortes de l’hiver s’envolèrent avec les émanations fétides de la tannerie et les oiseaux du printemps disparurent, comme s’ils avaient pressenti un tremblement de terre. L’après-midi se flétrit sous des nuées de poussière et respirer devint un exercice conscient et douloureux.
Debout sous le porche de sa maison, Mario Conde observait les effets de cet ouragan apocalyptique : rues désertes, portes fermées, arbres abattus, le quartier paraissait dévasté par une guerre efficace et cruelle. Alors il sentit croître en lui, avivée par les bourrasques, une vague prévisible de soif et de mélancolie, et imagina que derrière les portes barricadées déferlaient des ouragans de passions aussi dévastateurs que le vent de la rue. Il percevait l’absence de toute perspective pour la nuit qui approchait et l’aridité de sa gorge comme l’œuvre d’un pouvoir supérieur capable de modeler son destin entre une soif infinie et une solitude invincible. Face au vent, fouetté par la poussière qui lui rongeait la peau, il admit sans remords marxistes qu’il devait y avoir quelque chose de maudit dans ce souffle d’Armageddon qui se déchaînait chaque printemps pour rappeler aux mortels la montée du fils d’un homme vers le plus dramatique des holocaustes, là-bas à Jérusalem.
Il inspira jusqu’à sentir ses poumons saturés de terre et de suie, et lorsqu’il estima avoir payé sa part de souffrance à son vigilant masochisme, il revint se mettre à l’abri du porche et ôta sa chemise. La sensation de sécheresse dans sa gorge était plus intense et l’évidence de sa solitude l’avait envahi, devenant plus difficile à localiser en quelque recoin précis de son corps. Elle s’écoulait librement, comme parcourant son sang. « Toi et tes putains de souvenirs ! lui disait son ami le Flaco Carlos, Carlos le Maigre, mais il était inévitable que
le carême et la solitude réveillent des souvenirs. Le vent soulevait les sables noirs et les scories de sa mémoire, les feuilles sèches de ses amours mortes et les relents amers de ses fautes avec une insistance plus perverse qu’une soif de quarante jours dans le désert. Que le vent aille se faire foutre, se dit-il en pensant qu’il ferait mieux de ne pas se triturer les méninges avec sa mélancolie puisqu’il en connaissait l’antidote : une bouteille de rhum et une femme – bien pute de préférence – étaient le traitement instantané et parfait pour cette dépression envahissante.
Le rhum, ça peut s’arranger, pensa-t-il, même dans les limites de la loi. La difficulté était de combiner le rhum avec cette femme qu’il avait rencontrée trois jours plus tôt et qui provoquait chez lui cette gueule de bois d’espoirs et de frustrations. C’était le dimanche précédent, après avoir déjeuné chez le Flaco, qui n’était plus du tout maigre, et constaté que Josefina était de mèche avec El Diablo. Seul ce boucher au surnom infernal pouvait encourager le péché de gourmandise où les avait précipités la mère du Flaco : incroyable mais vrai, pot-au-feu à la madrilène, presque authentique, expliqua la femme quand elle les fit passer à la salle à manger où les attendaient les assiettes de bouillon et, circonspect et débordant de promesses, le plat de viandes, de légumes et de pois chiches.
– Ma mère était asturienne, mais elle faisait toujours le pot-au-feu à la madrilène. Question de goût, non ? Mais le problème c’est qu’en plus des pieds de porc salés, du morceau de poulet, du chorizo, du boudin, des patates, des légumes et des pois chiches, il faudrait aussi des haricots verts et un bel os de jarret de bœuf, et ça je n’ai pas pu en trouver. Mais c’est bon quand même, non ? demanda-t-elle, rhétorique et contente, devant l’étonnement sincère de son fils et du Conde, qui se jetèrent sur la nourriture et acquiescèrent à la première bouchée : oui, c’était bon, malgré ces absences subtiles que Josefina déplorait.
– Putain que c’est bon ! dit l’un.
– Eh ! laisses-en pour les copains, s’inquiéta l’autre.
– Merde alors, ce chorizo, il était à moi ! protesta le premier.
– Je vais éclater, avoua l’autre.
Après ce repas inimaginable, leurs paupières tombaient et leurs bras s’alourdissaient, formulant une organique et impérative requête d’un lit, mais le Flaco tint à s’asseoir devant le poste de télévision pour regarder, en guise de dessert, une double partie de base-ball. Le Habana faisait enfin une saison digne de ce nom et l’odeur de la victoire galvanisait le Flaco après chaque match de son équipe, même quand la partie n’était retransmise qu’à la radio. Il suivait le championnat avec une fidélité dont seul pouvait faire preuve un type comme lui : d’un optimisme inébranlable, alors que la dernière victoire remontait à la lointaine année 1976, à l’époque où les joueurs eux-mêmes paraissaient plus romantiques et plus heureux.
– Je suis crevé ! dit le Conde à la fin d’un bâillement qui le tira de sa torpeur. Surtout ne te fais pas d’illusions, espèce de sauvage, tu risques de tomber de haut : ces types finissent par foirer et perdent les meilleurs matchs, rappelle-toi l’an dernier.
– Je l’ai toujours dit, animal, j’adore te voir comme ça : enthousiaste, plein de joie… Et le montrant du doigt, il ajouta : tu es un putain d’oiseau de malheur, mais cette année, on va gagner !
– Comme tu voudras, mais ne viens pas me dire que je ne t’ai pas prévenu… En plus, je dois écrire un rapport pour boucler une affaire, et tous les jours je remets ça au lendemain. N’oublie pas que je suis un ouvrier…
– Nous emmerde pas, c’est dimanche aujourd’hui. Regarde, mon pote, regarde donc, aujourd’hui c’est Valle et El Duque qui lancent, c’est du tout cuit… Ne me dis pas que tu vas faire autre chose.
– J’aimerais bien, soupira le Conde qui détestait la placidité des après-midi dominicaux. Il avait toujours trouvé que la meilleure métaphore de son ami Miki Belles Minettes était de traiter quelqu’un de plus pédé qu’un dimanche après-midi languissant et morne. Oui, j’aimerais bien, répéta-t-il en se plaçant derrière le fauteuil roulant dans lequel vivait son ami depuis presque dix ans, qu’il poussa vers la chambre.
– Pourquoi tu n’irais pas acheter une bouteille et tu reviens ce soir ? lui proposa le Flaco Carlos.
– Je suis fauché, sauvage.
– Prends de l’argent dans la table de nuit.
– Écoute, demain je travaille de bonne heure, voulut protester le Conde, mais il vit le doigt comminatoire de son ami indiquant l’emplacement de l’argent.
Son bâillement vira en sourire et il sut alors qu’il ne pouvait pas se défendre :
– Il vaut mieux que je me rende, non ? Je ne sais pas, voyons voir, est-ce que je reviens ce soir ? Si je trouve le rhum. Il résistait encore pour sauver un peu de sa dignité aux abois. Bon, je descends.
Surtout n’achète pas de la saloperie, exigea Carlos. Et le Conde, déjà dans le couloir, lui cria :
– Vive les Serranos !
Et il courut pour ne pas entendre les insultes qu’il méritait.
Il sortit dans l’étuve de la mi-journée, une balance à la main et les yeux comme bandés. C’est ric-rac, pensa-t-il en soupesant son devoir et les besoins péremptoires de son corps : le rapport ou le pieu, bien qu’il sût que le verdict était prononcé en faveur d’une sieste aussi madrilène que le pot-au-feu, se disait-il en tournant au coin de la rue pour rejoindre la Calzada del 10 de Octubre. Et avant même de la voir, il l’avait pressentie.
L’expérience était quasi infaillible : quand il montait dans un bus, pénétrait dans un magasin ou dans un endroit très fréquenté, voire dans la pénombre d’un cinéma, le Conde mettait cette expérience-là en pratique et constatait avec plaisir qu’elle se vérifiait : un sens mystérieux d’animal exercé guidait toujours ses yeux vers la plus belle femme, comme si la recherche de la beauté faisait partie de ses exigences vitales. Et à cet instant précis, le magnétisme esthétique qui alertait sa libido ne pouvait pas avoir failli. Sous l’éclat du soleil, elle étincelait comme une vision d’un autre monde : la chevelure rousse, incendiée, frisée et souple, les jambes comme deux colonnes corinthiennes, terminées par tout ce qui est l’apanage des hanches et à peine couvertes d’un jean coupé et effiloché, le visage empourpré, à moitié caché par des lunettes de soleil rondes, sous lesquelles s’exhibait une bouche pulpeuse de jouisseuse vitale et convaincue. Une bouche faite pour tout caprice, fantaisie ou besoin imaginable. Putain, ce qu’elle était belle ! C’était comme si elle naissait de la réverbération du soleil, toute chaude et conçue à la mesure de désirs ancestraux. Il y avait longtemps que le Conde n’avait pas eu d’érection en pleine rue, les années l’avait rendu lent et trop cérébral, mais il sentit brusquement au creux de l’estomac, sous les couches protéiques du pot-au-feu madrilène, que quelque chose se déréglait et que les ondes provoquées par le mouvement convergeaient vers la protubérance imprévue qui commençait à se former entre ses jambes. Elle se tenait appuyée contre l’aile arrière d’une voiture et, en observant de nouveau ses cuisses de coureuse sans fond, le Conde découvrit la raison de son bain de soleil dans cette rue déserte : un pneu à plat et un cric hydraulique contre le rebord du trottoir expliquaient le désespoir qu’il lut sur son visage quand elle ôta ses lunettes pour nettoyer, avec une élégance affolante, la sueur sur son visage. Inutile de réfléchir, s’imposa le Conde en devançant sa paresse et sa timidité, et arrivé devant la femme il rassembla tout son courage et lui lança :
– Un coup de main ?
Ce sourire pouvait racheter tout sacrifice, y compris l’immolation publique d’une sieste. La bouche s’agrandit et le Conde en arriva à penser que l’éclat du soleil n’était pas indispensable.
– Vraiment ? douta-t-elle un instant mais pas deux. Je sortais pour aller faire le plein et voilà ce que je trouve, se plaignit-elle en montrant de ses mains maculées de cambouis le pneu blessé à mort.
– Les boulons sont durs ? demanda-t-il, histoire de dire quelque chose, et il essaya maladroitement de paraître habile en replaçant le cric au bon endroit. Elle s’accroupit près
de lui comme voulant témoigner de sa solidarité morale et
le Conde vit alors la goutte de sueur qui dévalait la pente mortelle de son cou et se précipitait entre deux petits seins, sans aucun doute bien plantés et libres sous le chemisier humide de transpiration. Ça sent la femme fatale et salutaire, avertit la persistante protubérance que le Conde s’efforçait de dissimuler entre ses jambes. Qui l’aurait cru, Mario Conde ?
Une fois de plus le Conde put vérifier la cause de ses éternelles mauvaises notes en travaux manuels et enseignement technique. Il lui fallut plus d’une demi-heure pour changer la roue, mais il put ainsi apprendre que les boulons se vissent de gauche à droite, et non l’inverse, qu’elle s’appelait Karina, avait vingt-huit ans, était ingénieur, qu’elle était séparée et vivait avec sa mère et un frère un peu fêlé, musicien d’un groupe de rock : Los Mutantes. Les Mutants ? Qu’avec la clé à boulons il faut y aller à coups de pied et que demain matin, très tôt, elle partait en voiture à Matanzas avec une commission technique pour travailler jusqu’à vendredi dans l’usine de fertilisants, mais si, je t’assure, elle avait vécu toute sa vie ici, en face, alors que lui, le Conde, passait par là tous les jours, dans cette rue, depuis vingt ans, et qu’elle avait lu un jour quelque chose de Salinger qu’elle trouvait fabuleux (il eut envie de rectifier : non, c’est dépouillé et émouvant). Et il apprit aussi que changer une roue pouvait être une des tâches les plus difficiles au monde.
La reconnaissance de Karina était joyeuse, totale et même tangible, car elle lui proposa, s’il l’accompagnait faire le plein, de le ramener chez lui, regarde, tu es en nage et tout barbouillé de cambouis, mon pauvre, lui dit-elle, et le Conde sentit son petit cœur tout chamboulé par les paroles de cette femme inattendue, qui savait rire et parlait très lentement.
En fin d’après-midi, après avoir fait la queue au poste à essence, appris que c’était la mère de Karina qui avait attaché la pièce de monnaie bénite au rétroviseur de la voiture, parlé de pneus crevés, de la chaleur et du vent, et pris un café chez le Conde, ils convinrent qu’elle l’appellerait à son retour de Matanzas : elle lui rendrait Franny et Zooey, c’est ce que Salinger a écrit de mieux, lui dit le Conde sans parvenir à contenir l’enthousiasme de Karina quand il lui tendit ce livre qu’il n’avait jamais prêté depuis qu’il l’avait volé à la bibliothèque de l’université. Comme ça ils continueraient la conversation. D’accord ?
Le Conde ne l’avait pas quittée des yeux un seul instant et bien qu’il reconnût avec honnêteté que cette fille n’était pas aussi belle qu’il l’avait cru (à vrai dire elle avait peut-être la bouche trop grande, de la tristesse quand elle baissait les yeux, et manquait un peu de rondeurs aux fesses, estima-t-il d’un œil critique), il était impressionné par sa joie décidée et sa capacité étonnante à faire se dresser en pleine rue, après le déjeuner et sous un soleil meurtrier, l’extrémité sans ailes ni jambes de sa virilité.
Karina accepta une deuxième tasse de café et c’est alors que se produisit la révélation qui allait finir de rendre fou
le Conde.
– C’est mon père qui m’a donné le vice du café, dit-elle en le regardant. Il buvait du café toute la journée, des litres.
– Et qu’est-ce qu’il t’a appris d’autre ?
Elle sourit et secoua la tête comme pour chasser des images et des souvenirs.
– Il m’a appris tout ce qu’il savait, et même à jouer
du saxo.
– Du saxo ? s’écria le Conde incrédule. Tu joues du saxophone ?
– C’est-à-dire, je ne suis pas musicienne, loin de là. Mais je sais « le souffler, comme disent les jazzmen. Mon père adorait le jazz et il a joué avec plein de gens, avec Frank Emilio, avec Felipe Dulzaides, la vieille garde…
Le Conde l’écoutait à peine parler de son père et des trios, quintets, septets auxquels il avait participé, des descargas
à la Gruta et à la Copa Room, et il n’avait même pas besoin de fermer les yeux pour imaginer Karina avec le bec du saxophone entre les lèvres et le cou de l’instrument dansant entre ses jambes. Est-ce que cette femme est bien réelle ? se demanda-t-il.
– Tu aimes le jazz ?
– Eh ben… je ne peux pas vivre sans ça, dit-il en ouvrant les bras pour montrer l’immensité de cet amour. Elle sourit, acceptant l’exagération.
– Bon, je m’en vais. Je dois préparer mes affaires pour demain.
– Tu m’appelles, alors ? dit le Conde d’une voix frôlant la supplique.
– Promis, dès mon retour.
Le Conde alluma une cigarette pour se remplir de fumée et de courage avant l’estocade décisive.
– A propos, qu’est-ce que tu entends par « séparée ? lâcha-t-il rapidement, avec un air de cancre.
– Cherche dans le dictionnaire, lui suggéra-t-elle en souriant et secouant la tête. Elle prit les clés de sa voiture et se dirigea vers la porte. Le Conde l’accompagna jusqu’au trottoir.
– Merci pour tout, Mario. Et après un instant de réflexion, elle demanda : au fait, tu ne m’as pas dit ce que tu faisais, non ?
Le Conde lança son mégot dans la rue et sourit en se sentant revenir en terrain sûr.
– Je suis policier, dit-il, et il croisa les bras comme un complément nécessaire à sa révélation.
Karina le regarda et se mordilla les lèvres avant de demander, incrédule :
– De la police montée du Canada ou de Scotland Yard ? Je m’en doutais, tu as une tête de menteur, dit-elle en s’appuyant sur les bras croisés du Conde qu’elle embrassa sur la joue. Salut, policier.
Le lieutenant enquêteur Mario Conde ne cessa pas de sourire même après que la Fiat polonaise eut disparu au tournant de la Calzada. Il rentra chez lui en sautant de joie et de bonheur à venir.
Mais il avait beau compter et recompter les heures qui le séparaient d’une nouvelle rencontre avec elle, ce n’était encore à peine que le mercredi des Cendres. Trois jours d’attente lui avaient suffi pour tout imaginer, mariage et gosses inclus, en passant, comme étape préalable, par des activités amoureuses sur des lits, des plages, des herbages tropicaux et des gazons britanniques, dans des hôtels diversement étoilés, des nuits avec ou sans lune et des Fiat polonaises, après quoi il la voyait encore nue placer le saxo entre ses jambes et en sucer le bec pour entamer une mélodie suave, tiède et dorée. Il ne pouvait qu’imaginer et attendre, et se masturber quand l’image de Karina, saxophone relevé, devenait insupportablement érogène.
Décidé à trancher de nouveau en faveur de la compagnie du Flaco Carlos et de la bouteille de rhum, le Conde remit sa chemise et ferma la porte de sa maison. Il sortit dans la poussière et le vent de la rue, et se dit que, malgré ce carême qui l’énervait et le déprimait, à cet instant il appartenait à l’espèce rare des policiers en passe d’être heureux.
– Tu vas me dire ce qui t’arrive, bordel ?
Le Conde sourit à peine et regarda son ami : qu’est-ce je lui raconte ? pensa-t-il. Chacun des cent cinquante kilos ou presque de ce corps vaincu lui faisait mal au cœur. C’était trop cruel de parler de bonheur potentiel à cet homme dont les plaisirs étaient à jamais réduits à une conversation imbibée d’alcool, une nourriture pantagruélique et un fanatisme maladif pour le base-ball. Depuis qu’il avait reçu cette balle en Angola et s’était retrouvé définitivement infirme, le Flaco Carlos, qui n’était plus maigre, s’était transformé en une plainte profonde, une douleur infinie que le Conde supportait avec un stoïcisme chargé de culpabilité. Quel bobard je lui sers ? A lui aussi je dois mentir ? pensa-t-il et il se remit à sourire amèrement tandis qu’il se voyait marcher devant la maison de Karina et s’arrêter pour essayer d’apercevoir, à travers les fenêtres qui donnaient sur le porche, l’impossible présence de cette femme dans la pénombre d’une pièce envahie de fougères et de feuillages aux cœurs rouges et orangés. Comment était-il possible qu’il ne l’ait jamais vue, alors qu’elle était de ces femmes qu’il flairait de loin ? Il termina son verre de rhum et dit au Flaco :
– J’allais te raconter un bobard.
– Tu as besoin de ça ?
– Je crois que tu te fais des idées sur moi, Flaco. Je ne suis pas comme toi.
– Écoute, mon pote, si tu as envie de raconter des conneries, tu le dis. Et il leva la main pour indiquer qu’il réclamait une pause le temps de boire un autre verre de rhum. Je me mets tout de suite au diapason. Mais avant, laisse-moi te dire une chose : tu n’es pas le meilleur type du monde, mais tu es le meilleur ami que j’aie au monde. Malgré tous tes bobards.
– Écoute, sauvage, j’ai rencontré une femme et je crois… fit-il en regardant le Flaco dans les yeux.
– Pute vierge ! s’exclama le Flaco Carlos en souriant. C’était ça ! C’était donc ça ! Et tu es mordu, hein ?
– Fais pas chier, Flaco, si tu la voyais. D’ailleurs tu l’as peut-être déjà vue, elle vit ici, un peu plus loin, dans l’autre rue. Je l’ai là, tu vois, dit-il en se pressant un doigt entre les sourcils.
– Putain, mais tu vas trop vite… Ralentis, doucement. Tu as baisé avec elle ?
– J’aimerais bien, soupira le Conde en affichant son air d’homme inconsolable. Il se resservit du rhum et lui fit le récit de sa rencontre avec Karina sans omettre un seul détail (toute la vérité, y compris que son derrière laissait à désirer, sachant la valeur que représentait un beau cul pour les jugements esthétiques du Flaco) ni un seul espoir (y compris l’espionnage d’adolescent attardé auquel il s’était livré pendant la nuit). Il finissait toujours par tout raconter à son ami, si heureuse ou terrible que fût l’histoire.
Le Conde vit que le Flaco se penchait sans pouvoir atteindre la bouteille et il la lui tendit. Le niveau du liquide se perdait déjà derrière l’étiquette et il calcula que la tournure de la conversation exigeait au moins deux litres, mais dénicher du rhum à La Víbora à une heure pareille risquait d’être une épreuve désespérante. Le Conde le regretta : en parlant de Karina, dans la chambre du Flaco, parmi tant de nostalgies tangibles et de vieilles affiches décolorées par le temps, il commençait à se sentir aussi bien qu’à l’époque où le monde, pour eux, tournait autour d’un beau cul, d’une paire de seins bien durs et, surtout, de cet orifice hallucinant et magnétique qu’ils évoquaient toujours en termes de moelleux, de profondeur, de densité capillaire et de facilités d’accès (non, mais non, mon vieux, regarde comme elle marche, si elle est vierge moi je suis un hélicoptère, aimait à dire le Flaco), sans trop se soucier de savoir à qui appartenaient ces clairs objets du désir.
– Tu ne changes pas, animal, tu ne sais même pas qui est cette femme et tu frétilles déjà comme un chien en chaleur. Rappelle-toi ce qui t’est arrivé avec Tamara…
– Non, vieux, ne compare pas…
– Arrête de déconner, tu es… Et elle habite vraiment par ici ? Dis donc, toi, tu ne me mènerais pas en bateau ?
– Mais non, vieux, non. Écoute, Flaco, cette femme il me la faut. Ou je l’ai, ou je me tue, ou je deviens dingue, ou je tourne pédé.
– Plutôt pédé que mort, l’interrompit l’autre en souriant.
– Je t’assure, sauvage. Ma vie part en couille. Il me faut une femme comme elle, je ne sais pas très bien qui elle est, mais il me la faut.
Le Flaco l’observait, l’air de dire : toi, tu ne changeras jamais.
– Je ne sais pas, mais j’ai comme l’impression que tu recommences à déconner… Ce que tu peux être lunatique… Tu es flic parce que ça te plaît. Ça ne te plaît plus ? Démissionne, mon gars, et envoie tout chier… Mais après ne viens pas me dire qu’au fond ce que tu aimais, c’était pourrir la vie des fils de putes et des salopards. Ne compte pas sur moi pour écouter ton baratin. Et ce qui t’est arrivé avec Tamara était déjà écrit en lettres de sang, mon pote : ce genre de nana, ça n’a jamais été pour des types comme nous, alors oublie-la une fois pour toutes et note dans ton autobiographie qu’au moins ça a cessé de te démanger et que tu as pu la tringler un bon coup. Et qu’ils aillent tous se faire foutre, sauvage. Donne-moi du rhum, allez.
Le Conde regarda la bouteille et déplora son agonie. Il avait besoin d’entendre de la bouche du Flaco des choses que lui-même pensait, et cette nuit-là, tandis que dehors le vent de carême soulevait les détritus, et qu’en lui une espérance en forme de femme battait des ailes, il ressentait comme juste et réconfortant d’être dans la chambre de son seul et plus cher ami, à parler de l’humain et du divin. Mais que va-t-il se passer quand le Flaco mourra ? pensa-t-il, brisant la chaîne qui conduisait à la paix spirituelle. Il opta pour le suicide alcoolique : il resservit du rhum à son ami, se versa une autre rasade et constata qu’ils avaient oublié de parler de base-ball et d’écouter de la musique. Plutôt la musique, décida-t-il.
Il se leva et ouvrit le tiroir des cassettes. Comme d’habitude, il s’alarma des goûts musicaux éclectiques du Flaco : il y avait de tout, des Beatles aux Mustangs en passant par Joan Manuel Serrat et Gloria Estefan.
– Qu’est-ce que tu aimerais écouter ?
– Les Beatles ?
– Chicago ?
– Formula V ?
– Los Pasos ?
– Credence ?
– D’accord, Credence… Mais ne viens pas me dire que Tom Foggerty chante comme un nègre, je t’ai déjà dit qu’il chante comme un dieu, pas vrai ? Et tous deux approuvèrent, oui, oui, faisant preuve de la plus radicale conformité : cet enfoiré chante comme un dieu.
La bouteille expira avant la version longue de Proud Mary. Le Flaco laissa son verre par terre et avança son fauteuil roulant jusqu’au bord du lit où était assis son copain policier. Il posa une de ses mains spongieuses sur l’épaule du Conde et le regarda dans les yeux :
– J’espère que tout ira bien pour toi, frérot. Les gens bien méritent d’avoir un peu de chance dans la vie.
Le Conde pensa qu’il avait raison : le Flaco était le meilleur des hommes qu’il connaisse et la chance lui avait tourné le dos. Mais cela lui parut d’un pathétique inacceptable et, s’efforçant de sourire, il répondit :
– Tu commences à dire des conneries, mon pote. Les gens bien, il n’y en a plus depuis longtemps.
Et il se leva avec l’intention d’embrasser son ami, mais il n’osa pas. Il y avait une foule de choses qu’il n’avait jamais osé faire.
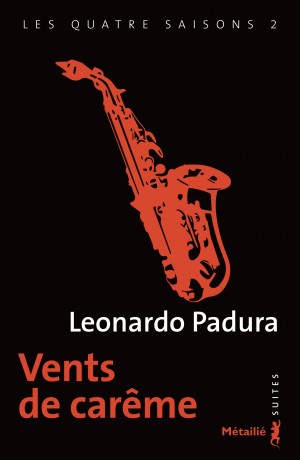






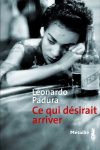

-100x150.jpg)