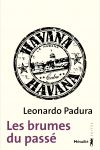En quelques mots, on y est. Cuba, La Havane, comme un regret sans fond, comme la musique d’un vieux boléro. Un doigt de rhum Carta Blanca (quand il en reste), soleil de plomb, solitude. Magie des décors qui n’ont pas besoin de description, ou si peu.
Les héros de Padura sont des tendres ; ils se heurtent à la société, au destin, au temps qui passe ; à ce désir qu’ont les choses, souvent, d’arriver contre notre gré, sans nous consulter. Ainsi, les toits qui s’effondrent, les pénuries de rhum, le départ intempestif d’êtres aimés.
On trouve de tout dans ce recueil de nouvelles, amours bêtement gâchées, soldat en fin de mission à Luanda, archange noir, nuits torrides, jeunes gens désœuvrés, fonctionnaires désabusés, souvenirs cuisants…
On trouve surtout le sel des romans de Leonardo Padura, sa marque de fabrique : l’humanité qui irradie à chaque ligne, la nostalgie des vies qu’on ne vit pas, et l’art suprême de nous plonger dans une île qu’on emporte toujours avec soi.
« La prose élastique et élégante de Padura nous entraîne à sa suite comme sur une piste de patinage. » Carlos Zanón, El País
-
"Par ce recueil de 13 nouvelles, Leonardo Padura confirme son talent de conteur. Il parvient à nous faire vivre le quotidien de Cuba. Ses nouvelles évoquent la pénurie, la défaite du socialisme, le désenchantement de toute une génération et finalement cette envie profonde de fuir désirant que quelque chose se passe. Un magnifique parcours à travers les époques et la somptueuse île de Cuba."
Sarah Ponzo -
"Imaginez Cuba, La Havane, un doigt de rhum, un soleil de plomb, la magie des décors …vous êtes prêts pour ces treize nouvelles superbes, qui évoquent pêle-mêle l'importance de l'Angola dans les itinéraires individuels des Cubains qui y furent envoyés, l'atmosphère de La Havane aux autobus bondés, où la chaleur et l'humidité dissolvent les énergies et les espoirs de ceux qui rêvent de partir sans oser franchir le pas. Des héros qui se heurtent à la société, au destin, au temps qui passe, aux choses qui arrivent contre notre gré, sans nous consulter. C’est le cas d’Ernesto qui doit choisir entre rentrer à Cuba chez son épouse ou rester à Luanda avec sa maîtresse ou l'étonnante aventure de Miguel, rêvant de voir Venise et rencontrant Valeria, qui l'emmène à Padoue, ou le suicide inexpliqué d’un cadre, ou le désespoir d’un homosexuel solitaire dans la nuit de la Havane.
Vous trouverez de tout dans ces nouvelles et surtout le sel des romans de Padura et sa marque de fabrique : l’humanité."
Mehdi -
"Une douce mélancolie.
A travers ses nouvelles, Leonardo Padura dresse un émouvant portrait de la société cubaine.
Avec une plume toujours poétique, il nous raconte la Havane avec le rhum et le Boléro, mais aussi le désenchantement d'une jeunesse aux espoirs déçus en parsemant ses récits de petites piques contre le régime cubain.
Un livre tout en finesse aux personnages attachants dans leurs doutes et leurs faiblesses..."
Camille -
"Ensorcelante Cuba ! Nouvelliste brillant autant que romancier inspiré, Leonardo Padura brosse un portrait contrasté de son pays en treize textes tour à tour sensuels, désenchantés, vibrants, tendres... toujours d’une grande et belle humanité."
-
"Le maître des Lettres cubaines nous ravit une fois de plus avec ce recueil de textes inédits. Les lecteurs qui le découvrent avec ce livre goûteront au charme de sa prose empreinte de nostalgie et de désenchantement, et ne manqueront pas de lire avec grand appétit toute son oeuvre!"
Amel Zaïdi
-
"Le roman a été un espace important pour révéler et fixer une réalité qui n'apparaît pas dans les médias officiels." Lire l'entretien ici
Entretien d'Yves GabayLa Dépêche du Midi -
"J'écris des romans à caractère social en employant le policier - la structure littéraire la plus convaincante pour le lecteur et la plus agréable pour l'écrivain" Lire l'article ici
Nadège DubessayL'Humanité dimanche -
"J'ai voyagé en France, je l'ai connue et j'ai commencé à l'aimer bien avant de poser le pied sur son territoire." Lire l'article ici
Propos recueillis par Alexis Lacroix, Marianne Payot et Delphine PerasL'Express -
"Toute l'humanité ou presque se dessine dans ces nouvelles écrites entre 1985 et 2009." Lire l'article ici
Jeanne FerneyLa Croix -
"D'une main de maître, Leonardo Padura imagine des êtres complexes, fragiles et sensibles, qui transportent à leur façon le souvenir d'un amour déçu, la nostalgie de séances de sexe torrides, des tonnes de regrets et d'espoirs éteints." Lire l'article ici
Christian DesmeulesLe Devoir -
"Des nouvelles absolument magnifiques, subtiles, sombres, sur les habitants de cette île si attachante." Lire l'article ici
L'Alsace -
"Atmosphères envoûtantes, portraits d'hommes et de femmes perdus, Padura excelle pour ferrer son lecteur en quelques phrases." Lire l'article ici
Frédérique HumblotLes Echos -
"Voici Cuba incarnée par des personnages cabossés mais jamais à terre." Lire l'article ici
Frédérique BréhautPresse Océan -
"Et si Cuba résumait notre relation ambiguë au changement? On le souhaite, on l'espère, maîs on le regrette déjà. C'est toute la beauté des nouvelles de Leonardo Padura, qui voguent entre hymne et élégie, fatalisme et glamour fané." Lire l'article ici
Marguerite BauxElle -
"Le boléro est la forme lyrique par excellence pour décrire les conflits amoureux." Lire l'entretien ici
Entretien de Kerenn ElkaïmLe Soir -
"D’une main de maître, Leonardo Padura imagine des êtres complexes, fragiles et sensibles qui transportent à leur façon le souvenir d’un amour déçu, la nostalgie de séances de sexe torrides, des tonnes de regrets et d’espoirs éteints." Lire l'article ici
Christian DesmeulesLe Devoir -
"Je croîs que la nostalgie, la mélancolie, la tristesse, sont des sentiments qui nous amènent plus directement à l'âme des choses." Lire l'entretien ici
Anne SérorFemme majuscule -
Entretien de Laure AdlerFrance culture "Hors-Champs"
-
"Les personnages de Padura restent, eux, avec leurs rêves inassouvis, quelques désirs éteints et des airs de boléros." Lire l'article ici
Dernières Nouvelles d'Alsace -
"Ces nouvelles, écrites entre 1985 et 2009, brossent un portrait tout en finesse de la société cubaine d’hier et d’aujourd’hui. Elles regroupent les thèmes chers à Padura, la nostalgie, l’exil, l’art, la sexualité." Lire l'article ici
Blog D'une berge à l'autre -
"On aimerait prendre la main de l'écrivain pour aller manger une glace chez Coppelia ou boire un verre de rhum Carta Blanca." Lire l'article ici
Christine FerniotLire -
"Pour Leonardo Padura, « si l'histoire est une vraie science, la littérature, elle, a la possibilité de la renverser sans pour autant trahir l'essence de ses processus.» " Lire le portrait ici
Portrait de Jacinta CremadesLe Magazine littéraire -
"Pour chacun de ces personnages l'enfance est désormais loin. Pas une nouvelle où elle ne resplendit pourtant comme un idéal, l'innocence, comme une utopie." Lire l'article ici et la chronique parmi les 100 qui comptent ici
Frédéric MercierTransfuge -
"Pour ceux qui ne connaîtraient pas encore Padura, ce recueil constitue une excellente entrée dans son univers." Lire l'article ici
Fred RobertZibeline -
"Il est à Paris pour présenter un recueil de nouvelles, Ce qui désirait arriver. Curieuse expression de Salinger, mais c’est bien ça, Cuba a vécu une longue adolescence civique, économique, sociale, où chacun baignait, baigne encore, dans «ce qui désirait arriver.»" Lire le portrait ici
Portrait de Philippe LançonLibération -
"Poétiques et sensuels, aux lisières parfois du fantastique, ces 13 récits entrent en résonance pour composer un hymne à l'humanité, tantôt mélancolique, tantôt allègre, toujours vibrant." Lire l'article ici
Laëtitia FavroLe Journal du dimanche -
"De sa plume à la fois subtile et puissante, Padura nous décrit la vie quotidienne d'une ile en détresse maîs gorgée de mémoire et de sensualité." Lire l'article ici
Esther SanchezQué tal París -
"Leonardo Padura brasse avec un immense talent tous les sentiments qui font basculer dans l'érotisme le plus cru ou la fatalité résignée : solitude, désillusion, tendresse, amitié, amour, crainte ou nostalgie habitent ces textes ciselés dont chacun aurait pu donner lieu à un roman - mais qui, condensés dans quelques pages tirées au cordeau, construisent un univers où hommes et femmes scintillent sous la plume d'un grand écrivain." Lire l'article ici et l'entretien ici
Entretien de Gilles HeuréTélérama -
"Ecrits entre 1985 et 2009, indépendants mais parents, ces neuf petits textes forment un tout cohérent et magnifiquement rythmé. Car Padura ne s’embarrasse pas de détours. Il fait confiance au lecteur." Lire l'article ici
Mireille DescombesL'Hebdo.ch -
"L’auteur déploie son talent pour nous conter ces destins aux rêves brisés, se mouvant lentement dans la moiteur des rues de La Havane." Lire l'article ici
Blog Une Pause littéraire -
"Le Conde est de la génération de l’auteur, né en 1955, celle des désillusions et de la lassitude." Lire l'article ici
Isabelle RüfLe Temps (Suisse) -
"« Cuba est, dans tous les sens, une île. Elle a sa logique et son évolution propre »." Lire l'article et l'interview ici
Interview de Karin CherloneixOuest France -
Alexandre POPLAVSKY et Pascal SALCIARINIL'Est républicain
-
"L'auteur cubain le plus lu dans le monde, père du détective Mario Conde, publie un recueil de nouvelles. Rencontre." Lire le portrait ici
Portrait de Thierry ClermontLe Figaro littéraire -
"A travers les amours interrompues, avortées ou purement imaginaires de Ce qui désirait arriver, Leonardo Padura esquisse une île qui ne change pas." Lire l'article ici
Anaïs HéluinLettres françaises -
Ecouter l'entretien ici
Caroline BrouéFrance Culture "La Grande Table" -
"Ce sont ces échos de moments lointains, ces impossibles retours en arrière, ces sentiments de trahison, ces cruels moments de décision qui donnent aux personnages cette mélancolie nostalgique et cette émotion." Lire l'article ici
Blog Sur la route Jostein -
"Leonardo Padura est à Nancy mercredi, une chance pour la Lorraine et le Centre Prouvé qui l’accueille, alors que Cuba est cette année le pays invité d’honneur de la Foire internationale de Nancy." Lire l'article ici
Pascal SalciariniL'Est républicain -
"Dans mes livres, un assassinat est amplement suffisant car l’enquête n’est qu’une facette de ce qui se passe. Mais ça ne marche pas pour la télé. On a dû doubler notre quota de morts!" Entretien ici
Constance JametTV mag - Site du Figaro -
"Chaque histoire est comme un bijou sorti du néant, serti par une lumière particulière." Lire l'article ici
Kerenn ElkaïmLivres hebdo
Il avait toujours entendu dire qu’à force de parler de malheurs, on finit par les attirer. Or, une fois de plus, le Jornal de Angola annonçait qu’une invasion sud-africaine était imminente. Cette information revenait toutes les semaines, étayée de certitudes et d’évidences indiscutables, de données logistiques et de déclarations du gouvernement et, même si au cours des vingt-trois derniers mois les Boers avaient franchi plusieurs fois la frontière de Namibie avec quelques rares avions menaçants et des tanks bien réels, l’invasion annoncée ne se concrétisait pas. Mais la lecture de cette nouvelle le faisait toujours frissonner. Ses jambes flageolaient sous l’effet d’une peur obscure et tangible qui naissait dans son estomac et il ne savait à quel saint se vouer afin que l’événement imminent ne se produise pas avant la fin février, quand il serait déjà bien loin de tout ça et que ses deux ans de mission en Angola appartiendraient dès lors à un passé irréversible.
Seulement cette peur pouvait avoir des effets immédiats. Il venait juste de lire les gros titres et quelques lignes du premier paragraphe qu’il dut sortir de son lit et presser le pas vers les toilettes où il déboutonna son pantalon, le journal sous le bras. Après tous ces mois, il connaissait les causes et les effets de ce sentiment découvert en Angola, incontrôlable et en partie ambigu, même pour lui, dont il jouissait avec la tranquille conviction que sa peur n’était pas précisément de la lâcheté. Assis sur la cuvette, il entreprit donc de déchirer soigneusement la partie de la première page, source de ses angoisses, disposé à se venger de la façon la plus scatologique et symbolique possible : il se torcherait avec cette nouvelle et, en attendant la fin de ce réflexe non conditionné, il retourna le morceau de journal où il découvrit sous un titre d’à peine dix points “TOUT VELASQUEZ”, une brève information annonçant qu’entre le 23 janvier et le 30 mars, le Prado présenterait l’exposition, dite du siècle, qui réunirait pour la première fois, depuis l’époque où ils avaient été peints, soixante-dix-neuf chefs-d’œuvre de l’artiste sévillan venus de tous les coins du monde pour compléter le fonds du grand musée espagnol.
Tout en s’essuyant consciencieusement avec la page sportive du journal, il se mit à penser à une autre de ses obsessions favorites. Il se dit que le monde était une vraie merde : moi en train de chier en Angola alors que les Madrilènes se préparent justement à voir une exposition unique de Diego Vélasquez. Cela faisait déjà presque deux ans qu’il avait quitté Cuba, pourtant cette façon de penser ne l’avait pas lâché un instant. Elle le hantait quand il écrivait à sa femme, deux fois par semaine, ces lettres interminables et déchirantes où il laissait éclater tout son désespoir ; et cette même pensée revenait le soir quand, de la fenêtre de sa chambre, il se mettait à observer le campement que plusieurs familles avaient installé dans un magasin abandonné par les Portugais en 1976 ; il voyait les hommes accroupis, mâchonnant des herbes, qui observaient eux aussi ces femmes fanées en train de faire bouillir sur un feu de bois le yucca et le poisson pour le funche, tout en allaitant des enfants morveux et apathiques qui ne connaîtraient peut-être jamais l’existence du mot bonheur. Cette pensée l’obsédait aussi quand il parcourait les rues de Luanda, esquivant les tas d’ordures à tous les coins de rues, se retournant sur le passage des innombrables mutilés d’une guerre interminable et bien réelle qui l’obligeaient à se demander pourquoi, putain, il y avait des gens condamnés à vivre ainsi, tandis que lui, justement lui, il pouvait déambuler, sans rien attendre mais sans souffrir de la faim, dans cette ville malade et inhospitalière qui ne se livrait pas à lui, qui ne se laissait pas comprendre et dont il ne parvenait pas à imaginer le destin final.
Depuis son arrivée, chaque matin correspondait à une croix sur les trois almanachs accrochés au-dessus de son lit. Le dernier se terminait de façon abrupte : on était seulement en janvier 1990 mais il ne lui restait désormais que huit chiffres à barrer.
– Eh, vieux, tu t’es shooté à quoi ? Rhum, marijuana, quoi encore ? T’es vraiment pas dans ton état normal, sur la tête de ma mère ! – Le directeur du journal semblait tellement convaincu qu’il fit aussi non d’un mouvement de la tête avant de sourire. D’habitude, tout ou presque le faisait rire mais, d’une certaine façon, cette fois il avait raison, se dit Mauricio qui pourtant insista.
– Écoute, Alcides, me prends pas pour un idiot. Ici, il y a une flopée de gens qui repartent par Berlin ou Madrid, et si tu m’appuies, je peux rentrer par Madrid.
– Et qu’est-ce que je dis ? Que tu veux voir des tableaux à Madrid ? Écoute, Mauricio, si je dis ça, dans le meilleur des cas on me vire de la mission pour avoir fait le con.
Dehors, une brise inattendue se leva et le directeur dut plaquer précipitamment ses papiers sur son bureau pour les empêcher de s’envoler. Il semblait que, pour la deuxième fois de l’été, il pleuvrait sur Luanda, et Mauricio désira voir tomber une averse dévastatrice.
– Pourquoi ? Parce qu’ils penseraient que je veux rester en Espagne ? Merde ! C’est dégueulasse, Alcides ! Même si on a passé deux ans à se crever en Angola, à en devenir bigleux à cause de la chloroquine, avec les tripes en compote à force de manger de la viande en boîte, il se trouve toujours un salaud pour penser que tu ne veux pas rentrer à Cuba. C’est charmant…
Le directeur finit de remettre ses papiers en place et alluma une cigarette. Il ne riait plus et passa une main sur son visage comme s’il tentait ainsi d’effacer toute la fatigue et les rides accumulées au cours des derniers mois. À Cuba, il n’était guère que le sous-directeur d’un journal de province, mais c’était aussi un cadre fiable, alors on lui avait confié la direction de l’hebdomadaire du contingent cubain en Angola où il faisait son travail avec le plus grand sérieux. De toute façon, c’était un homme aimable, intelligent de surcroît.
– Écoute, Mauricio, je crois te connaître, dit-il enfin sans sourire. Je pense qu’ici au fin fond de l’Afrique on connaît mieux les gens, mais ne demande pas aux autres de penser comme moi. Il y a une merde sur ta fiche et ça, tout le monde le sait, même le dingue qui se promène à poil place Kinanxixi. Et tu sais bien que tu ne serais pas le premier à rester en Espagne. En plus, il y a aussi ce foutu problème de billet…
– Alors, on va éternellement me ressortir ça, hein ? Ce qui est con, c’est que pour d’autres il n’y a aucun problème. Du moins pour ceux qui sont restés à l’étranger !
Le directeur sourit de nouveau, presque involontairement, et lança son mégot par la fenêtre sans se lever.
– Ne viens pas me faire du chantage, mon salaud… Alors, comme ça… une exposition de Vélasquez… Bon, je vais voir ce que je peux faire pour toi, mais rappelle-toi que si tu fais une folie, à moi, on me les coupe.
– Ce serait un bon prétexte, dit Mauricio en pensant que parfois la vie n’était pas si merdique que ça.
Pour Vélasquez, du moins, la vie n’avait pas été merdique. C’était, en quelque sorte, ce qu’Emma Micheletti tentait de démontrer dans le petit ouvrage sur le peintre que Mauricio avait trouvé dans l’une des trois librairies de Luanda au cours de ses premiers mois de mission, quand il fréquentait encore les musées et les librairies. Le petit livre Vélasquez, poussiéreux et taché, se trouvait sur une étagère du fond, près d’autres volumes insolites – La République de Platon en allemand, les Œuvres choisies d’Érasme en italien et quelques brochures sur le football américain en portugais –, et, bien qu’il fût vendu comme neuf, le livre avait déjà eu un propriétaire : María Fernanda, qui l’avait non seulement signé et daté (09/07/1974), mais qui avait aussi souligné plusieurs paragraphes et certaines phrases qui lui semblaient remarquables pour plusieurs raisons – ou même pour une seule. Peut-être du fait de son incapacité à dépasser l’aspect anecdotique ou de son manque d’habileté pour le dessin, Mauricio n’avait jamais été un connaisseur avisé en matière de peinture, mais depuis qu’il avait découvert les annotations de María Fernanda, ce volume no 26 de la collection “Les diamants de l’art”, publié par les éditions Toray de Barcelone en 1973, était devenu pour lui une plaisante énigme. Le fait que ce livre fût en vente constituait le premier élément de cette énigme et la personne de María Fernanda devint le second mystère, le plus excitant. Au début, il se dit que le livre avait dû appartenir à l’un de ces Portugais qui, en 1975 et 1976, avaient fui l’Angola en abandonnant leurs affaires, leurs maisons et même leurs chiens et leurs livres ; mais quand il parvint à mieux la connaître en suivant ses traces et ses obsessions, il décida que María Fernanda avait peut-être été une incorrigible amoureuse à qui l’amour avait toujours été refusé.
Deux marques sur le livre l’incitèrent à élaborer cette conviction poétique : à la page 5, dans le coin supérieur, la propriétaire initiale avait encadré au stylo à bille bleu, par deux traits parallèles dans chaque marge : “En 1624, il s’établit à Madrid avec sa famille, rue de la Conception. Sa relation avec le roi ne devait prendre fin qu’à la mort du peintre. Si parfois cette situation limita sa liberté, elle lui offrit en revanche la possibilité de mener une vie paisible, exempte de soucis financiers car, de plus, le souverain n’exerça jamais sur lui une pression exagérée en lui imposant des obligations ou des conditions.”
Trois pages plus loin, après l’épigraphe de “L’œuvre”, l’hypothétique amante infortunée avait souligné tout le premier paragraphe, cette fois à l’encre rouge, puis l’avait ponctué pour terminer d’un inconsolable point d’exclamation : “L’existence de Vélasquez, disait Emma Micheletti, suscitant la satisfaction ou le dépit de María Fernanda, fut décidément heureuse et, à la lumière de certains éléments, il est presque instinctif d’établir un parallèle avec celle de Rubens qui devint son ami, comme nous l’avons vu. Leur naissance dans la luminosité estivale du mois de juin semble augurer une vie aisée, heureuse, et une affirmation artistique précoce, sûre et glorieuse. Tous deux furent au service de souverains compréhensifs et généreux qu’ils servirent avec fidélité et amour ; tous deux moururent dans leur maturité encore vigoureuse, âgés d’à peine plus de soixante ans, une fois atteint l’objectif idéal de leur vie artistique, alors qu’ils ne pouvaient vraiment plus ajouter grand-chose à leur style et à leurs techniques les plus perfectionnées. Différents, ils le furent peut-être en esprit, par leur force expressive et émotive ; quant au caractère, Rubens était violemment vital, spontané et extraverti ; en observateur attentif, Vélasquez était calme et réfléchi.” (!)
Seul un esprit sensible et amoureux, avec une certaine tendance suicidaire, s’intéresse tant au bonheur et à la sécurité, se dit Mauricio, et il fut définitivement conforté dans cette idée par la trace la plus insolite laissée par María Fernanda dans ce livre qu’elle avait dû tant aimer. Il s’agissait de deux points, à peine perceptibles, sur le bord inférieur des illustrations 63 et 64 du catalogue des œuvres de Vélasquez qui occupait la seconde moitié du livre. Mauricio découvrit les points parce qu’il avait été attiré, lui aussi, par ces deux peintures moins célèbres que Les Buveurs, Les Ménines, La Vénus au miroir ou La Tunique de Joseph, mais singulières et fascinantes par leur thème et leur conception. Les références de ces œuvres indiquaient : “63 – VUE DES JARDINS DE LA VILLA MEDICIS. Huile sur toile, 48 x 42 cm. Madrid, Prado. Connu sous le nom de Le Soir. Avec son pendant, intitulé Le Milieu du jour, probablement réalisé en 1650. Les deux tableaux constituent une véritable exception dans la production du maître. Ils figuraient déjà dans les inventaires de l’Alcazar en 1666 et se trouvent au Prado depuis 1819.”
Dès lors, Mauricio rêva de María Fernanda et d’une visite au Prado pour voir ce diptyque éblouissant dans lequel Vélasquez abandonnait les espaces clos, les rois, les papes, les princes et les bouffons pour annoncer, avec désinvolture et deux siècles d’avance, Corot ou encore Van Gogh, Renoir, Monet et l’impressionnisme du XIXe. Surtout dans Le Soir : avec ces arbres que Mauricio décréta être des cyprès, bien qu’il n’en ait jamais vu un de sa vie, aux feuilles diffuses au-dessus des arcades d’une galerie Renaissance, dans la lumière tiède, imprécise mais franche, qui effaçait les contours des deux personnages sur le point de converser au premier plan, comme au fond, ceux de l’homme à la cape qui tourne le dos au spectateur et semble jouir du paysage de pins et de saules perdus dans le lointain. Ce soir magnifique dans le jardin des Médicis transmettait un élan vital et une jubilation que dut éprouver l’artiste tandis qu’il laissait courir sur la toile ses plus beaux coups de pinceau d’homme paisible, libre, et sans engagements envers des rois plus ou moins compréhensifs et généreux.
Au bout d’un certain temps, Mauricio n’eut plus aucun doute : Diego Rodríguez de Silva y Vélasquez avait été heureux au moins un soir de sa vie et María Fernanda était une femme éthérée et charmante qui allait par le monde avec ce livre qui la rendait folle de jalousie parce qu’elle ne s’était jamais sentie heureuse, ne serait-ce qu’un soir. Elle avait compris que le bonheur est un privilège trop difficile à apprivoiser pour ceux qui ne sont pas des rois et peut-être s’était-elle perdue dans la forêt africaine à la recherche de son propre royaume de solitude.
– Allez, va acheter une bouteille de rhum, tu me dois bien ça, lui dit Alcides.
Et, bien sûr, il sourit. Mauricio le fixa, sérieux, incrédule mais plein d’espoir.
– Te fous pas de ma gueule, Alcides.
– Tu pars le 3 pour Madrid. Tu arrives là-bas à quatre heures de l’après-midi et tu repars le 4 à dix heures du matin pour La Havane. Ça te laisse assez de temps, non ?
Mauricio alla chercher sept mille kwanzas dans sa chambre et descendit jusqu’au quatrième étage. Cela méritait bien le rhum que le directeur lui réclamait. Ortelio, le préposé au magasin central, en avait toujours pour lui et ses amis, c’était la devise de la boutique, pour les amis, sept mille kwanzas la bouteille de Havana Club trois ans d’âge – ainsi que d’autres petites choses tout aussi désirables, des cartouches de cigarettes par exemple.
Assis sur le balcon, ils débouchèrent la bouteille et Maurico ne put s’empêcher de porter un toast.
– À Vélasquez !
– À moi, déconne pas ! dit Alcides en effleurant le verre de son subordonné. Car sans moi, Vélasquez, c’était râpé !
Et ils burent. Ils burent plusieurs verres en parlant de la chaleur, du temps qu’il restait à Alcides et de ce que ferait Mauricio en arrivant à La Havane : baiser sa femme dix fois de suite, passer une semaine à la plage, manger une pizza sur La Rampa et ne plus jamais se branler de sa vie, car avec l’empreinte de ses quatre doigts, son membre ressemblait à un guidon de bicyclette. Et puis, surtout, marcher dans les rues la nuit, sans que personne le lui interdise ni qu’un ennemi invisible le guette dans l’obscurité.
– Et qu’est-ce que tu vas faire au journal ?
Mauricio termina son cinquième verre avant de répondre.
– J’en sais rien, j’espère qu’après ces deux ans on va me laisser sortir la tête de l’eau et qu’on m’autorisera de nouveau à écrire dans la rubrique culturelle.
Alcides jeta son mégot dans la rue.
– On t’a mené la vie dure, hein ?
– Dure, c’est peu dire ! D’abord, on m’a fait réécrire les articles des correspondants de province et après on m’a envoyé ici pour me mettre à l’épreuve.
– Moi, on m’a vraiment gonflé avec toi. On m’a prévenu que je devais te surveiller et tout et tout.
– Et c’est maintenant que tu me dis ça, mon salaud !
Alcides alluma une autre cigarette et but encore du rhum.
– Qu’est-ce que tu voulais ? Que je me jette dans tes bras sans savoir qui diable tu étais ? Fais pas chier, Mauricio.
Mauricio sourit et regarda le soleil disparaître derrière l’hôtel Trópico.
– Mais je suis content de t’avoir bien connu. Tu es le meilleur journaliste qui ait travaillé avec moi.
– Merci du compliment, chef.
– Pourvu que tout se passe bien pour toi et que tu ne restes pas en Espagne. Non pas pour moi, mais pour ceux qui t’ont baisé. Ne leur fais pas ce plaisir, ne leur donne pas raison.
– On dirait que je vais passer toute ma vie à l’épreuve, comme la navette Challenger.
– Donne-moi encore du rhum. On dirait qu’il va se mettre à pleuvoir.
– Tu te rends compte que je vais voir l’exposition du siècle, mon vieux ! Que je vais enfin admirer la Vue des jardins de la Villa Médicis…
Alcides sourit de nouveau et avala une autre gorgée de rhum.
– Tu vas finir fou ou pédé. Je te le parie.
Mais, sans sourire cette fois, il regarda Mauricio dans les yeux et dit :
– Tu crois qu’on se reverra à Cuba ?
Avec le rhum et la nouvelle de son voyage à Madrid, Mauricio se sentait légèrement euphorique et pensa faire une plaisanterie mais il se retint.
– Tu crois qu’une fois loin d’ici on sera encore amis ?
– J’aimerais bien, soupira Alcides qui semblait triste. L’alcool faisait généralement émerger ses nostalgies les plus intimes.
– Je crois que tu vas me manquer. Ça fait à peu près quinze mois que je vois ta tronche tous les jours.
– Pourvu qu’on puisse rester amis ! La guerre, n’importe laquelle, c’est une trop grande saloperie pour qu’on y perde finalement l’essentiel, non ?
– Un jour, j’irai te rendre visite et j’apporterai du rhum. Ça me ferait drôlement plaisir.
Mauricio regarda la rue qui s’obscurcissait sous les nuages de plus en plus bas et regretta la méfiance que cet homme lui avait inspirée durant plusieurs mois. À Cuba, peut-être qu’Alcides n’aurait jamais été son ami, peut-être n’auraient-ils jamais bavardé ensemble, mais ici, submergés par tant de nostalgies, de peurs et de solitude, tout pouvait être différent et définitivement indélébile : oui, il serait content de le revoir, avec ses trois stylos à bille dans la poche de sa saharienne, son insupportable sourire et ses manies d’homme prudent et trop responsable.
– J’attends le rhum, dit-il finalement.
– J’ai même envie de t’embrasser, dit l’autre.
– Toi aussi, tu vas finir dingue ou homo, dit Mauricio et il essaya d’imiter l’éternel sourire du directeur.
Il avait encore du mal à y croire. L’enchaînement des hasards qui l’avait conduit jusqu’à Madrid, ce 3 février 1990, était trop complexe pour être possible et encore moins réel. Il se dit qu’il aurait beaucoup aimé raconter tout ça à María Fernanda : depuis ses problèmes au journal jusqu’à la découverte de son livre, et lui demander de le guider vers le Prado pour voir avec elle les soixante-dix-neuf peintures du Sévillan et se persuader enfin que la propriétaire du livre était précisément cette femme qui l’avait cherché toute sa vie, sans même savoir qu’il vivait dans un quartier poussiéreux de La Havane où on aimait la castagne et dont il n’avait jamais imaginé, deux ans auparavant, à quel point il pourrait lui manquer… Quand il était très jeune et qu’il lisait des biographies de gens célèbres, Mauricio avait pris goût au déchiffrage des tours et des détours qui construisent peu à peu la vie des gens : une rencontre due au hasard, une décision inattendue, un acte fortuit ; pourquoi dans sa propre vie n’y aurait-il rien de ce genre ? Lui-même se considérait comme une erreur et son existence lui apparaissait comme une suite d’échecs et d’égarements qui l’avait amené à perdre toutes ses ambitions, tous ses rêves. Alors qu’il n’était pas un grand amateur de peinture et que jamais de sa vie il ne s’était attardé devant une reproduction de Vélasquez, pourquoi n’avait-il trouvé que ce livre et non la femme qui y avait laissé la trace de ses obsessions ? Dernièrement, il s’était mis à imaginer physiquement María Fernanda. Au début, elle n’était qu’un esprit, une voix, un mystère, mais elle lui apparaissait maintenant sous les traits d’une femme pâle et calme, avec de grands yeux très humides, qui souriait à travers un miroir en le voyant arriver. C’est ainsi qu’il la rencontra sur la reproduction 67 du livre, étendue et nue. Mais elle ne le verrait jamais arriver. Pour le moment, il devait se contenter de la Vénus de Vélasquez.
– S’il vous plaît, jusqu’à quelle heure le musée du Prado est-il ouvert ?
Le fonctionnaire de l’immigration regarda la photo sur le passeport avant de lever les yeux.
– À vrai dire, monsieur… répondit-il en haussant les épaules, désemparé et confus.
– Ça ne fait rien, dit Mauricio en reprenant ses papiers. Il se dirigea vers la salle de livraison des bagages et ne put s’empêcher d’être ébloui par la propreté étincelante de l’aéroport. Deux ans à marcher dans les rues de Luanda, uniquement lavées par le vent et les très sporadiques averses, deux ans à vivre dans un appartement avec trois autres hommes qui se relayaient pour ne pas balayer, étaient plus que suffisants pour que ce sol sans poussière ni mégots parvienne à l’enchanter.
Il jeta un regard à sa montre et soupira : quatre heures vingt-cinq. Personne autour de lui n’avait une tête à savoir à quelle heure fermait le musée. Il avait supposé qu’il serait ouvert jusqu’à neuf heures. Il sortirait de l’aéroport à cinq heures, passerait par son hôtel pour y déposer ses valises et, au plus tard à six heures, il serait au Prado avec assez de temps pour s’enivrer de Vélasquez.
Il alla aux toilettes et, pendant qu’il urinait, il regarda de nouveau sa montre : “Oui, je suis à Madrid, se dit-il, à quatre heures et demie de l’après-midi”, et il comprit en sortant qu’il était un homme heureux car sa valise naviguait dans le flot mécanique des bagages. Il sécha la sueur de ses mains et s’interdit de consulter de nouveau sa montre.
L’autobus le laissa à la Puerta del Sol. Pendant le trajet vers l’hôtel Diana, l’homme assis à ses côtés lui avait expliqué comment faire : “La rue d’Alcalá, c’est une des rues qui débouchent sur la Puerta del Sol. Tu la prends et, quand tu arrives à la Banque d’Espagne, tu es sur l’avenue du Prado, tu tournes à droite à la fontaine de Cybèle et là, mon vieux, tu aperçois le musée.” Il lui confirma le plus important : “C’est ouvert jusqu’à neuf heures.”
Il traversa la place et résista à toutes les tentations : les cafés, les boutiques, les colporteurs africains devenus vendeurs de rue offrant des lunettes, des boucles d’oreilles et autre pacotille de contrebande. Il souffrait maintenant d’une crise de nostalgie imprévue : depuis que son compagnon d’autobus lui avait parlé de l’avenue du Prado, les deux lions de bronze du Prado de La Havane s’étaient installés dans sa mémoire, ravivant son désir d’être enfin chez lui avec la femme, les chiens et les livres dont il avait tellement besoin pour vivre.
Le froid de Madrid était supportable ; un panneau lumineux près d’un feu rouge indiquait la température et l’heure : 13 degrés et 5:39 de l’après-midi. Alors Mauricio fut pris d’une envie de courir. Les gens marchaient vite, ils bavardaient sans s’arrêter et fumaient comme des sapeurs. Ils entraient et sortaient des bars en rajustant leurs manteaux de fourrure ou de laine. Ils regardaient les vitrines des magasins et cherchaient à savoir si les soldes de fin de saison étaient bien réelles. Ils se ruaient vers la bouche de métro à une allure capable de balayer n’importe quel obstacle humain. Mauricio se réjouissait à la pensée qu’aucune de ces personnes, cependant, ne pouvait avoir la moindre idée de qui il était et de ce qu’il faisait à Madrid avec son envie de courir, euphorique comme il ne l’avait pas été depuis longtemps. Ses mains ne transpiraient plus et il voulait seulement s’arrêter pour boire un café, mais il ne s’autorisa pas ce luxe. Il avait seize dollars pour toute fortune et il avait avalé bien assez de café en Angola.
L’avenue du Prado le surprit : elle était là, devant lui, unique, malgré l’absence des lions de bronze. Il s’arrêta parmi les gens qui attendaient au feu rouge. Sans se donner le temps de contempler la si célèbre Cybèle, il traversa la rue et tourna à droite sur le terre-plein central de l’avenue planté d’arbres, peut-être des cyprès, dénudés et sombres. Il se trouvait à moins de deux cents mètres du musée ; enfin, il lui sembla que oui, que c’était vrai, et l’espace d’un instant le souvenir d’Alcides, souriant, lui traversa l’esprit. Alors il se mit à courir vers le soir paisible de la Villa des Médicis.
Quand le gardien lui expliqua que l’exposition fermait le lundi et ouvrait le mardi à neuf heures et qu’il était désolé qu’il soit venu d’Angola, “c’est du côté du Congo ça, non ?” et qu’il reparte le lendemain, mais que lui, il ne pouvait rien y faire, que “c’était fermé, fermé, monsieur”, Mauricio fut convaincu que la vie était une vraie merde, même un 3 février devant les portes du Prado, à seulement un mur de distance des soixante-dix-neuf chefs-d’œuvre de l’aimable Diego Vélasquez. Surtout si c’était un lundi.
Un lundi sa mère était morte, se souvint-il. Un lundi l’UNITA avait attaqué le convoi dans lequel se trouvait son grand copain le photographe Marquitos, seul mort de l’escarmouche ; un lundi, la direction de son journal l’avait appelé pour lui passer un savon et même bousiller sa vie. Il s’était également marié un lundi et il pensa qu’il n’avait aucune constance, même dans la malchance.
La fontaine de Cybèle lançait ses jets d’eau sur le char de marbre et Mauricio ne put s’empêcher de sourire devant le genre d’attention dont les Européens pouvaient être capables : un petit écriteau indiquait que les tulipes rouges, jaunes et pourpres plantées autour du monument étaient un cadeau de la mairie d’Amsterdam à celle de Madrid. Il s’arrêta au début de cette avenue du Prado dépourvue de lions, et se sentit exténué et vide. Il pensa rentrer à l’hôtel, se cacher la tête sous l’oreiller et dormir pour tout oublier, mais un panneau dans la rue et une chanson l’obligèrent à changer de direction : quand il vit un nom, PORTE D’ALCALA, et une flèche indiquant la droite, il se mit à chanter cette mélodie que deux ans auparavant il avait fini par détester lorsque son frère avait fait une copie de la cassette d’Ana Belén et que toute la famille s’était vue condamnée à entendre, à plein volume et environ dix fois par jour : “Regarde-la, regarde-la, regarde-la / la Porte d’Alcalá / regarde-la, regarde-la, regarde-la…” Et puis merde ! Il la regarderait.
Mauricio constata en la regardant qu’il y avait eu assez de tulipes hollandaises pour fleurir aussi la Porte d’Alcalá, la monumentale entrée du vieux Madrid, que Carlos III fit construire par Sabatini en son propre honneur de roi éclairé et victorieux. Sous ces cinq arcs de triomphe, maintenant interdits au public à cause des massifs de tulipes, avaient couru durant bien des années les meilleurs taureaux de combat destinés à mourir sur le sable de l’arène, et des rois et des armées, des porteurs d’eau et des mendiants y étaient aussi passés. Son ineffable María Fernanda avait peut-être regardé un jour ce monument sévère après s’être délectée, au Prado, des lumières et des couleurs si délicates de Vélasquez et avoir acheté à la boutique du musée le petit livre que le destin mettrait un jour entre les mains d’un obscur journaliste cubain sanctionné, accusé de ne pas avoir la fermeté idéologique suffisante pour éclairer les masses populaires, comme l’affirmait sa fiche… Qu’avait-elle eu à l’esprit tandis qu’elle contemplait le monument ? Mauricio voulut imaginer ce que pensait María Fernanda mais il finit par revenir à lui : aurait-il dans sa vie une seconde chance pour séjourner à Madrid et franchir, enfin, les portes du Prado ? Qu’allait-il faire de ses seize malheureux dollars : essayer de se soûler et de faire, à sa manière, Le Triomphe de Bacchus, manger un pot-au-feu à la madrilène ou acheter à sa femme les soutiens-gorges qu’elle lui avait demandés ? Que se passerait-il quand il reviendrait au journal, purifié et enfin racheté par son séjour plein d’abnégation en Angola, évalué comme exceptionnellement positif sur le plan professionnel, idéologique, militaire et politique par Alcides et visé par les responsables du Parti et la direction de la mission ? Mauricio réfléchissait tout en contemplant la Porte d’Alcalá. Il en oublia même la chanson et Vélasquez et se décida pour le pot-au-feu à la madrilène quand, juste dans la ligne que traçait son regard sous l’arc principal de la porte, il vit l’homme vêtu d’un élégant costume gris à l’autre bout de la rue Alcalá, en train d’observer intensément les statues qui couronnaient le monument. L’homme abaissa alors son regard qui suivit en sens inverse le même parcours que celui de Mauricio : il passa au-dessus des tulipes, à travers la porte, évita le trafic de la rue et le vit aussi. “C’est pas possible !” dirent au même instant Mauricio et l’homme au costume gris, de part et d’autre de la Porte d’Alcalá.
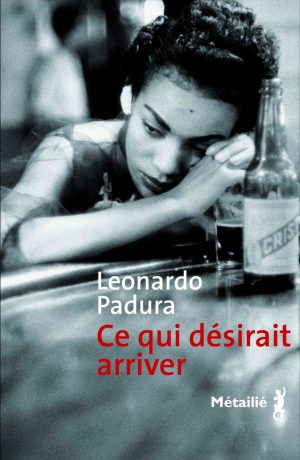







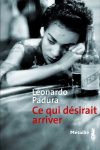

-100x150.jpg)